La diététique recèle de vérités qui, comme toutes les vérités, présentent de dérangeants contre‑exemples. On parle de paradoxes à chaque fois que des grandes enquêtes épidémiologiques viennent contrarier des données qui semblaient définitivement acquises. Par malheur, cela arrive assez souvent. Dans cet article, nous développons quatre de ces paradoxes, ainsi que les théories nouvelles auxquels ils donnèrent naissance.
LE PARADOXE ASIATIQUE
Les Asiatiques mangent peu de produits laitiers et assimilent par conséquent peu de calcium. Or on sait que ce minéral joue un rôle primordial dans le renouvellement de la trame osseuse. Logiquement, on devrait s’attendre à ce que les Asiatiques se caractérisent par un squelette fragile. Pas de chance, ils font plutôt moins de fractures spontanées que nous. Que ceux qui y comprennent quelque chose lèvent la main.
L’os n’est pas un matériau inerte. Notre squelette se trouve en phase de restructuration permanente sous l’action de cellules qui le rongent (ostéoclastes) et de cellules qui le reconstruisent (ostéoblastes). Un rapport adéquat doit toujours exister entre les protéines qui forment la charpente de l’os et les sels minéraux qui viennent s’y fixer. Cet équilibre dépend de nombreux facteurs, liés au sexe, à l’activité physique, à l’âge ou à l’hérédité. L’alimentation aussi joue un rôle essentiel dans ce curieux jeu de go. Les apports en calcium se révèlent même cruciaux. En effet, ce minéral intervient dans la formation des minuscules cristaux d’hydroxyapatite qui constituent le ciment principal de l’os. De nombreuses études soulignent une relation entre la solidité osseuse et la consommation de produits laitiers. Cela se vérifie à tous les âges, mais surtout pendant l’adolescence, période charnière de la vie qui voit s’élever très nettement les besoins calciques. Des doses d’environ 1200 milligrammes de calcium par jour devraient être assimilées, ce qui est malheureusement loin d’être systématiquement le cas. Selon une étude publiée en 1994, 13% des garçons et 20 à 30% des filles de notre pays ne couvrent pas leurs besoins journaliers (7). Face à ce constat, les autorités médicales encouragent la consommation de laitages. Malgré ces campagnes de prévention, on compte toujours davantage de problèmes osseux aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en Suède plutôt qu’en Chine où pourtant, on ignore les produits laitiers. Voilà qui tombe plutôt mal…
L’OSTÉOPOROSE, C’EST DU CHINOIS!
Ce paradoxe asiatique fut relevé lors de deux grandes études menées dans la population chinoise. La plus ancienne concernait 1200 femmes réparties dans une soixantaine de régions. Pour la moitié d’entre elles les apports calciques se situaient en dessous de 400 milligrammes par jour, soit à peine 50% des apports recommandés en Europe ou aux USA. La raison? Ces femmes ne consommaient quasiment pas de produits laitiers qui chez nous délivrent les trois quarts du calcium alimentaire. Ces conclusions furent confirmées lors d’une autre étude conduite plus récemment auprès de 2 160 femmes chinoises, âgées de 45 à 75 ans. L’analyse portait sur leur alimentation, leur niveau d’activité et leur densité osseuse. Elle cherchait aussi à mettre en évidence des particularismes régionaux. Six régions étaient étudiés, dont deux zones montagneuses peuplées d’ethnies « étrangères », à savoir des Mongols ou des Kazakhs -férus de laitages- qui constituaient une base de comparaisons fort instructives. De plus, pour affiner l’analyse, on avait séparé les apports calciques provenant des denrées animales (lait, viande) et des denrées végétales (fruits, légumes), plus difficiles à assimiler. Enfin, on avait tenu compte de la teneur en protéines de la ration qui affecte, elle aussi, la fixation du calcium (voir encadré). Résultat : on s’est aperçu que, dans les régions rurales chinoises, aucune femme ne couvrait ses besoins en calcium, alors que chez les Mongols et les Kazakhs, un petit tiers seulement y parvenait (23). Les données concordent pour dresser le tableau d’une situation fort préoccupante. Très logiquement, on s’est donc interrogé sur la solidité osseuse de ces populations. Dans un premier temps, les craintes se confirmèrent. Chez les femmes chinoises, la baisse progressive de la masse osseuse débute vers 35‑40 ans, soit bien plus tôt qu’en Europe ou aux USA. On remarque en plus que la vitesse de déminéralisation s’accélère après 50 ans. A cet âge-là, l’immense majorité des Chinoises présentent des densités osseuses inférieures à 0,35 g/cm², c’est-à-dire la valeur critique en dessous de laquelle les fractures surviennent spontanément. Mais, contre toute attente, on enregistre en Chine un pourcentage étonnamment faible de fractures ostéoporotiques (à peine 3%), bien inférieur en tout cas aux statistiques en cours dans nos pays. L’explication serait peut-être génétique. Le point critique qui correspond à la fracture osseuse semble se situer, chez les Asiatiques, à un niveau inférieur à celui des Européens. On savait déjà que des différences d’ossature étaient liées à l’origine ethnique des populations. Les Noirs jouissent d’une masse osseuse supérieure de 10% à celle des Blancs (15). On s’aperçoit ici que des critères de solidité, autre que la densité osseuse, interviennent pour préserver le squelette. A densité égale, les Chinoises sont donc plus robustes que les Européennes.
LE TRAITEMENT QUI MARCHE
Une autre explication du paradoxe asiatique fait référence à l’activité physique plus importante en Chine que chez nous. On sait en effet que les sollicitations musculaires renforcent l’ossature. Une étude récente a révélé, de façon amusante, que les bras dominants des tennismen présentent une masse osseuse supérieure d’un tiers à l’autre (8). De la même façon, on s’aperçoit que les Chinoises, mais aussi les Bantoues et les habitantes de Hong-Kong développent peu de fractures spontanées de la hanche, en raison probablement des heures de marche qu’elles effectuent chaque jour. Il existe encore d’autres preuves du rôle positif de l’activité physique sur le statut osseux. Lors des vols spatiaux, le manque d’effort que procure une vie en apesanteur produit une importante déminéralisation osseuse qui entraîne un tassement vertébral lors du retour sur terre et une diminution de la taille qui peut atteindre jusqu’à 10 centimètres (10). Ainsi, la résolution du paradoxe asiatique repose sans doute sur des phénomènes conjoints d’hérédité et d’activité physique, sur lesquels on est encore loin d’avoir fait toute la lumière.
QUAND LA CHINE S’ÉVEILLERA…
L’abus de viande complique l’assimilation du calcium. Celui-ci se trouve retenu au niveau des reins, probablement en raison de l’acidité importante due au catabolisme des protéines animales (riches en acides aminés soufrés). Cette observation ne date pas d’hier. Il y a 30 ans déjà, Schwartz déterminait les besoins en calcium chez les adolescents en se basant sur leur consommation de viande. Cette observation participe sans doute à l’explication du paradoxe asiatique. En effet, on sait que la ration traditionnelle chinoise est assez pauvre en protéines. Le calcium se trouve donc mieux utilisé que dans nos pays. Cela permet de réviser à la baisse les apports classiquement recommandés. Evidemment, une amélioration des conditions de vie – et donc une augmentation de la consommation de viande – exposerait ces populations à subir de nouvelles carences. Cette remarque fit d’ailleurs l’objet d’une vérification en laboratoire. Une étude consistait à apporter un supplément de 40 grammes de protéines de blanc d’œuf à une alimentation traditionnelle chinoise. Chez les sujets, cela a provoqué illico une élévation significative des pertes de calcium par les urines (21). Il vaut mieux être pauvre et solide que riche et fragile.
ARTICLES CONSULTÉS – BIBLIOGRAPHIE
(1) ANDON J (1991) : Am. J. Clin. Nutr., 54: 927‑9.
(2) BOUR H (1990) : Cah. Nutr. Diét., 25(1): 18‑23.
(3) FAN HU J, ZHAO X & Coll (1993) : Am. J. Clin. Nutr., 58: 219‑27.
(4) GANONG W (1977) : « Physiologie médicale », MASSON Ed.: 665 p.
(5) HEANEY R (1987) : Clin. Obstetr. Gynecol., 50: 833‑59.
(6) HEGSTED D (1986) : J. Nutr., 116: 2316‑9.
(7) HERBETH B, SPYCKERELLE Y & Coll (1994) : Cah. Nutr. Diét., 24(4): 215‑20.
(8) JACOBSON P, BEAVER C & Coll (1984) : J. Orthop. Res., 2: 328‑32.
(9) LAU E, DONNAN S & Coll (1988) : Brit. Med. J., 297: 1441‑3.
(10) LANE H, LE BLANC A & Coll (1992) : J. Nutr., 122: 13‑8.
(11) LANE H, LE BLANC A & Coll (1993) : Am. J. Clin. Nutr., 58: 583‑8.
(12) LANE H, SCHULZ L (1992) : Ann. Rev. Nutr., 21: 257‑78.
(13) LEDOUX S, CHOQUET M (1991) : « Les 11‑20 ans et leur santé. I. Les troubles des conduites alimentaires ». INSERM Doc: 73 p.
(14) LESTER G, ANDERSON J & Coll (1990) : J. Orthop. Res., 8: 220‑6.
(15) ORTIZ O, RUSSELL M & Coll (1992) : Am. J. Clin. Nutr., 55: 8‑13.
(16) POLLITZER W, ANDERSON J (1989) : Am. J. Clin. Nutr., 50: 1244‑55.
(17) POLOCK C, EISMAN J & Coll (1987) : J. Clin. Invest., 80: 706‑10.
(18) RICHE D (1990) : « Equilibre nutritionnel et sports d’endurance », VIGOT Ed.: 420 p.
(19) ROSS P, NORIMATSU H & Coll (1991) : Am. J. Epidemiol., 133: 801‑9.
(20) STILLMAN R, LOHMAN T & Coll (1986) : Med. Sci. Sports Exerc., 18: 576‑80.
(21) WANG X, ZHAO X (1989) : Abs. Conf. New. Res. Food: 45.
(22) YANO K, HEILBRUN L & Coll (1985) : Am. J. Clin. Nutr., 42: 877‑88.
(23) ZHAO X, CHEN X (1992) : Nutr. Rev., 50 (12): 395‑7.





LE PARADOXE DU MARATHONIEN
Entre le culturiste taillé comme un Hercule et le coureur au corps décharné qui, croyez-vous, possède les besoins en protéines les plus élevés? Cette question soulève ce que les spécialistes désignent comme le « paradoxe du marathonien ».
Pendant des années, les recommandations en matière de consommation de protéines ont fait l’objet d’interminables débats d’experts. Aujourd’hui pourtant, un consensus se dégage. On évalue les besoins d’un adulte sédentaire à +/- 0,8 grammes de protéines par kilo de poids. Normalement, une alimentation saine et équilibrée apporte sans problème ces doses quotidiennes de protéines. La question d’une supplémentation ne se pose pas. En revanche, les données relatives aux besoins des sportifs sont loin de faire l’unanimité. Pourquoi? Parce que, contrairement au sédentaire chez qui les protéines de l’alimentation assurent essentiellement des fonctions « plastiques », chez le sportif, les protéines participent aussi aux filières de production énergétique. En clair, elles sont brûlées à l’effort et il faut tenir compte de ces pertes lors de l’estimation des besoins. Actuellement, il ne fait guère de doute que les besoins en protéines des sportifs dépassent ceux des sédentaires. Dans quelle mesure? On se heurte là à des problèmes quasiment insolubles. En effet, tout dépend du type d’entraînement, du type de sportif et de son adaptation à l’effort sur le plan hormonal, nerveux, enzymatique, etc.
MANGER DU MUSCLE
Les premiers à se soucier d’une élévation de l’apport protéique furent logiquement les culturistes. De façon assez imagée, ils se mirent à consommer des concentrés de protéines dans l’idée de gagner du muscle. Pourtant, les premiers arguments scientifiques justifiant cette démarche ne provenaient pas de disciplines axées sur la force et la puissance, mais paradoxalement d’une étude roumaine conduite auprès de coureurs à pieds caractérisés au contraire par leur extrême minceur. Les auteurs démontrèrent que plusieurs jours d’entraînement intensif donnaient lieu chez ces athlètes à un bilan azoté négatif, autrement dit à une perte de protéines corporelles non compensée par l’alimentation (4). On s’aperçut ensuite que des processus identiques se produisaient chez les pratiquants des sports de force, mais à un degré moindre, ce qui étonne en regard de la masse musculaire -et donc protéique- très nettement supérieure. Des travaux plus récents qui comparaient l’alimentation d’haltérophiles et de marathoniens ont permis de mieux comprendre cette curieuse réalité. Chez les premiers, l’augmentation des besoins protéiques ne résulte que d’une seule cause : l’activation des synthèses protéiques, c’est-à-dire des filières qui permettent de « faire du muscle ». Ceci ne se produit que lorsque trois conditions sont remplies. D’abord, il faut un surplus de protéines. Ensuite, il faut beaucoup s’entraîner. Enfin, il faut un environnement hormonal propice, avec notamment des taux élevés de testostérone, d’insuline et d’hormone de croissance élevés.
Chez les sportifs d’endurance, le tableau se révèle tout différent. Des acides aminés, notamment ceux qualifiés de « ramifiés » subissent une oxydation en cours d’exercice. En d’autres termes, ils se trouvent détournés des sites de synthèse pour intégrer divers métabolismes et contribuer aux processus énergétiques. Par ailleurs, lors des exercices de longue durée surviennent des processus de dégradation des fibres musculaires que traduisent l’élévation des taux sanguins de CPK. Certaines cellules sanguines sont également détruites et nécessitent d’être remplacées. Enfin des altérations hormonales apparaissent après un effort de longue durée, particulièrement l’élévation du taux de cortisol qui contribue à la dégradation des protéines jusqu’à trois jours après l’effort. Sans apport protéique adapté, la fonte musculaire survient.
Si de surcroît, à l’image d’un Richard Virenque ou d’une Anne Briand, l’adepte d’une discipline d’endurance intègre régulièrement de la musculation à sa préparation, les besoins protéiques augmentent encore. Les spécialistes préconisent donc des apports proches de 1,2 à 1,6 g par kilo et par jour pour les sports de force, tandis que pour les sports d’endurance les recommandations atteignent 2 g par kilo et par jour, et ce en dépit d’une plastique n’ayant rien à voir avec celle d’un « Monsieur Univers ».
DE LA POUDRE AUX YEUX
Les sportifs en endurance possèdent effectivement des besoins accrus en protéines. Faut-il pour autant s’en remettre aux préparations hyperprotéinées très en vogue dans les salles de musculation? Non. Disons-le d’emblée. A moins qu’ils se soumettent à un régime amaigrissant, ces sportifs n’ont nul besoin de ces produits. Il faut simplement veiller à ce que différentes catégories d’aliments figurent à leurs menus. Prenons le cas d’un athlète de 60 kilos. Pour trouver ses 120 grammes de protéines journalières, il lui faudra boire un quart de litre de lait, manger 2 yaourts, 40 grammes de fromage, une portion de 150 grammes de viande et un oeuf. Cette ration comprend déjà 78 grammes de protéines. Avec celles contenues dans les végétaux -on trouve 10 grammes de protéines dans 150 grammes de pain, 200 grammes de pâtes ou 100 grammes de légumes secs- et celles que renferment différents produits annexes comme les pizzas, les quiches, les biscuits secs, les müeslis ou les oléagineux, on arrivera facilement au total demandé. Un gros appétit ira même aisément au-delà. Les complexes de protéines ne sont alors d’aucune utilité. Une exception toutefois : l’apport spécifique d’acides aminés ramifiés se justifie par le fait qu’aucune protéine alimentaire n’en apporte aux teneurs requises. Mais c’est tout.
ARTICLES CONSULTÉS – BIBLIOGRAPHIE
(1) BOOTH F, WATSON P (1985): Fed. Proc., 44: 2293‑2300.
(2) DARMAUN D & Coll (1988): Am. J. Physiol., 255: E366‑73.
(3) DEVLIN J & Coll (1990): Am. J. Physiol., 258: E249‑55.
(4) GONTZEA I & Coll (1975): Nutr. Rep. Int., 11: 231‑6.
(5) GUEZENNEC C.Y (1994): Cah. Nutr. Diét., 29(5): 272‑8.
(6) HOOD D, TERJUNG R (1990): Sports Med., 9(1): 23‑35.
(6′) KRAEMER W (1988): Med. Sci. Sports Exerc., 20(5): S152‑7.
(7) KREIDER R, MIRIEL V & Coll (1993): Sports Med., 16(3): 190‑209.
(8) LARITCHEVA H & Coll (1978): « Nutrition, physical fitness and health », Univ. Park Press: 155‑63.
(9) LEMON P (1987): Med. Sci. Sports Exerc., 19(5): S179‑90.
(10) RADHA E, BESSMAN P (1983): Bioch. Med., 29: 96‑100.
(11) RICHE D (1994): « Guide nutritionnel des sports d’endurance », VIGOT Ed.: 420 p.
(12) TARNOPOLSKY M & Coll (1988): J. Appl. Physiol., 64: 187‑93.
(13) TORUN B & Coll (1977): Am. J. Clin. Nutr., 30: 1983‑93.




LE PARADOXE ESQUIMAU
Les maladies cardio‑vasculaires à l’origine d’un tiers de décès apparaissent comme le véritable fléau des temps modernes. Parmi les facteurs de risques, on cite classiquement la part trop importante des graisses d’origine animale dans notre alimentation. Les études statistiques relèvent effectivement une bonne corrélation entre l’excès de viande et les infarctus. Il existe toutefois une exception à cette règle : les Esquimaux. Ces « mangeurs de viandes crues » ne développent pratiquement jamais de maladies cardiaques. Y a un truc?
Il est toujours très difficile d’établir de façon formelle une relation de causalité entre un mode de vie et une maladie. Beaucoup de paramètres contribuent à brouiller les pistes. Il faut tenir compte du niveau de vie des populations, de l’accès aux soins de santé, des habitudes alimentaires, de la consommation des drogues, de l’alcool, du tabagisme, et d’une multitude d’autres facteurs de confusion. Puis, une bonne corrélation, tout statisticien le sait, ne décrit pas forcément une relation de causalité. Malgré cela, on a pu établir de façon formelle qu’une ingestion excessive de graisses favorisait la survenue de maladies cardio‑vasculaires. Dans les pays d’Europe, les courbes de mortalité coronarienne s’alignent assez précisément sur les moyennes de consommation des graisses. Une exception notable à cette règle : les Esquimaux. Ces hommes du Nord mangent en moyenne 300 à 400 grammes de poisson par jour, ce qui correspond à 45‑60 grammes de graisses, soit beaucoup plus que ce qu’on recommande classiquement pour la bonne santé des artères. En outre, les Esquimaux sont quasiment privés de fruits et de légumes. Mis à part le lichen à moitié digéré qu’ils prélèvent dans les intestins des animaux et dont ils se nourrissent, ils manquent des doses élémentaires de vitamines et de fibres dont on connaît le rôle préventif important sur les maladies cardio-vasculaires. Or, à l’instar des Japonais eux aussi très ichtyophages (qui se nourrissent essentiellement de poissons), les Esquimaux présentent des taux de mortalité coronarienne très bas. Bien sûr, l’absence de tabagisme et un mode de vie supposé peu « stressant » sous les igloos expliquent partiellement ces chiffres. Mais cela ne suffit pas à satisfaire les épidémiologistes. Pour eux, ils devaient y avoir une autre raison. Des études portèrent donc sur l’aliment de base du régime esquimau, c’est-à-dire le poisson. On s’est donc demandé s’il avait des vertus particulières et, au-delà des notions de quantité, s’il ne fallait pas mieux prendre en compte l’origine des graisses animales dans les recommandations de santé
SOUS LE SIGNE DU POISSON
Il y a une dizaine d’années, un travail important a été lancé pour tester l’hypothèse d’un rôle protecteur des graisses de poisson. Ses auteurs démontrèrent que la mortalité par infarctus diminuait de moitié si l’on prenait soin de consommer chaque jour 30 grammes de poisson. Cette étude avait l’avantage de reproduire le protocole classique employé en pharmacologie, produit contre placebo (5).
Quelques années plus tard, une autre étude apportait des conclusions identiques. Un régime modérément riche en poisson (2 portions par semaine) entraînait une baisse des taux sanguins du mauvais cholestérol et des graisses dans le sang, deux facteurs essentiels dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Ce profil est même meilleur que celui que l’on observe avec un régime végétarien, comme quoi l’exclusion de toute chair animale n’a pas que du bon, surtout pour les Esquimaux qui sinon mourraient de faim!
Restait à identifier les constituants impliqués dans cet effet bénéfique. Cela n’a pas traîné ; on a pu l’attribuer à deux familles particulières d’acides gras polyinsaturés, celles de l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et de l’acide docosohexanoïque (DO). Ces acides gras se transforment dans nos tissus en une famille de composés très importants : les prostaglandines. Entre autres fonctions, ces composés stimulent le système immunitaire et, sous certaines conditions(*), exercent même une action anti‑cancérigène. Depuis cette découverte, les nutritionnistes recommandent de prévoir au moins deux plats de poissons gras par semaine. En hommage aux Esquimaux.
(*) En effet, les prostaglandines possèdent une structure chimique, très réactive, ce qui les rend notamment très fragiles face aux radicaux libres. Pour préserver leurs propriétés, on conseille donc d’associer des sources de vitamine C et de vitamine E aux aliments marins.
ARTICLES CONSULTÉS – BIBLIOGRAPHIE
(1) FRICKER J (1986): La Recherche, 17 : 1265‑6.
(2) FRICKER J (1993): « Le guide du bien maigrir‑ en gardant la santé », O.Jacob Ed.: 433 p.
(3) FRITSCHE K, JOHNSTON P (1987): Fed. Proc., 46: 1172.
(4) GLOMSET J (1985): N. Eng. J. Med., 312: 1253‑4.
(5) KROMHOUT D & Coll (1985): N. Eng. J. Med., 312: 1253‑4.
(5′) LEIBOVITZ B, SIEGEL B (1980): J. Gerontol., 35: 45‑56.
(6) MEYDANI S & Coll (1988): J. Nutr., 118: 1245‑52.
(7) PHILLIPSON B & Coll (1985): N. Eng. J. Med., 312: 1210‑6.
(8) PICLET J (1987): Cah. Nutr. Diét., 22(4): 317‑36.
(9) RICHE D (1994): « Guide nutritionnel des sports d’endurance », VIGOT Ed.: 420 p.





LE PARADOXE FRANÇAIS
Les Esquimaux ne sont pas les seuls à se soustraire aux statistiques de mortalité coronaire. Nous autres, Français, jouissons aussi d’un coeur en meilleure santé que ne l’aurait a priori laissé supposer notre alimentation. Dès 1981, une équipe de l’INSERM avait attiré l’attention sur ce nouveau paradoxe. Les infarctus sont plus rares chez nous que dans les pays Anglo‑Saxons ou l’Europe du Nord. Bizarre, car nous ne lésinons pas sur les viandes, le beurre et les fromages, c’est-à-dire des sources importantes d’acides gras saturés, qui d’ordinaire font plutôt plonger les statistiques.
Depuis lors, d’autres études ont confirmé ce résultat, en particulier ceux de « l’Etude Prospective Parisienne » en 1987. Pour expliquer le « paradoxe français », on a envisagé le rôle de différentes catégories d’aliments. On passa au crible notre consommation de fruits, de légumes, de céréales, de vin et de graisses. Très vite, on repéra d’importantes différences régionales. En fait, on recréait en France, les frontières culinaires qui séparent les pays du Nord -où l’alimentation s’articule autour de denrées comme la bière, le beurre, les viandes- des pays du sud -où l’on consomme davantage de vin, d’huile ou de poissons-. Or on sait en effet que le profil d’une alimentation de type nordiste est beaucoup plus préjudiciable aux artère que celle de type sudiste. Les chiffres de mortalité coronaire en France reflètent d’ailleurs assez précisément ce distinguo. On meurt plus d’infarctus à Lille et à Strasbourg qu’à Marseille ou à Toulouse. Bref, tout cela est finalement assez conforme aux théories. Deux régions pourtant échappent aux expectatives : il s’agit de la région parisienne et des régions de l’ouest où la mortalité coronaire reste faible, en dépit d’une alimentation riche en graisses saturées. En vérité, le « paradoxe français » se résume à la situation particulière de ces zones de population assez denses et donc très influentes au niveau statistique.
LE VIN D’HONNEUR
Parmi toutes les explications avancés, une hypothèse trouve souvent un écho attentif de la part du grand public et se découvre même certains panégyristes dans le corps médical. Selon celle-ci, notre bonne santé artérielle trouverait son origine dans notre consommation importante de vin. Dans un pays producteur comme le nôtre, l’hypothèse possède évidemment des retombées économiques évidentes. Mais attention à l’excès de zèle. Rappelons tout de même que nous détenons les tristes record de mortalité par « cancers » par « cirrhose et autres maladies du foie » et par « accidents, violence et suicides » qui paient un lourd tribut à l’intempérance. De façon générale, l’alcool tue encore beaucoup plus sûrement qu’il ne guérit. Mais une consommation modéré paraît néanmoins susceptible d’abaisser les risques d’accidents cardiovasculaires.
En fait, l’alcool lui-même n’agit pas. L’effet protecteur du vin serait dû à quelques uns des 2000 congénères qui entrent dans sa composition. Parmi eux, ceux d’une famille bien précise, les tanins phénoliques, semble porteurs d’une activité biologique protectrice. On les retrouve principalement dans les vins rouges vieillis dans les fûts en chêne. Et déjà aux Etats-Unis, on commercialise des pilules à base de vin rouge en prévention à l’infarctus. Tout cela est évidemment très exagéré. Lorsqu’on abandonne le tohu-bohu médiatique entretenu sur les vertus thérapeutiques du vin, on s’aperçoit que les scientifiques accordent finalement plus d’importance à notre façon de manger qu’à nos penchants alcooliques. Les repas en France procèdent encore et toujours d’un cérémonial que l’on ne retrouve pas dans les autres pays européens où l’on est plus enclins à grignoter un sandwich sur un coin de table. Or l’art de manger en prenant du temps et du plaisir contribue aux bons processus de digestion et d’assimilation des nutriments. Mais, bien sûr, cela ne s’achète pas en pharmacie.
ARTICLES CONSULTÉS – BIBLIOGRAPHIE
(1) ARTAUD‑WILD S & Coll (1993): Circulation, 88: 2271‑9.
(2) CRIQUI M & Coll (1994): Lancet, 344: 1719‑23.
(3) DUCIMETIERE P (1995): Cah. Nutr. Diét., 30(2): 78‑81.
(4) FRANKEL E, KANNER J & Coll (1993): Lancet, 341: 454‑7.
(5) RENAUD S, DE LORGERIL M (194): Lancet, 339: 1523‑5.
(6) RICHARD J & Coll (1981): Presse Med., 10: 1111‑4.
(7) RICHARD J (1987): Arch. Med. Coeur, N° spécial avril: 17‑21.
(8) RUIDAVETS JB & Coll (1993): Cah. Nutr. Diét., 28: 105‑9.
(9) TUNSTALL PEDOE H (1988): B.M.J., 297: 1559‑60.
Denis Riché pour Sport & Vie – 2009
Photos : MCC
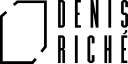
0 commentaires