A une époque on parlait de « sucres rapides » ou « sucres lents ». Cette notion a depuis été peu à peu abandonnée au profit de concepts plus complexes comme l’index glycémique. C’est au tour des protéines de se caractériser par leur vitesse d’utilisation…
LA VIEILLE HISTOIRE DES SUCRES LENTS :
Revenons un instant sur cette vieille histoire qui, pour une majorité d’acteurs du milieu sportif, pas aussi bien informés que nos lecteurs, continue à faire office de référence. L’idée était de savoir si, en fonction de leur nature chimique et de leurs structures, les différentes familles de glucides étaient utilisées de manière similaire par notre organisme ; rappelons en effet qu’on en distingue de plusieurs sortes. D’abord les sucres « simples », mono ou disaccharides, constitués d’une ou deux molécules de base. Il s’agit par exemple, dans le cas des monosaccharides, du glucose, du fructose ou du galactose et, dans celui des disaccharides, du lactose, du sucrose ou du maltose. Leur structure chimique ne nécessitant pas d’action enzymatique, ou une unique intervention très rapide, on a pensé, jusqu’au début des années 80, que leur arrivée dans le sang était brutale, immédiate, et donc perturbait fortement la glycémie. D’où l’analogie « simple » et « rapide ». Une autre famille de glucides, eux aussi pouvant être intégralement digérés, existe par ailleurs. C’est celle des amidons, dénués de saveur sucrée, contrairement aux précédents. Il s’agit de chaînes ramifiées (c’est-à-dire comprenant des bras latéraux) de plusieurs milliers de molécules de glucose mises bout à bout et côte à côte pour certaines. Comme dans le cas précédent, ces molécules ne peuvent être utilisées par notre organisme qu’après avoir été scindées en éléments simples. En l’occurrence, ceux-ci consistent en molécules de glucose. Là où précédemment un seul passage de l’enzyme suffisait, le temps de quelques millisecondes, une multitude d’assauts s’avéraient nécessaires. D’où l’idée que leur digestion puis leur assimilation devaient demander un laps de temps conséquent, ce qui leur a valu d’être baptisés « sucres lents ». Au début des années 80, avec l’amélioration des techniques biologiques et l’entrée dans l’ère de l’informatique, il a été possible de suivre en continu, dès l’ingestion des aliments, l’évolution de la glycémie qui y fait suite. Le protocole, modélisé dès les premiers travaux, consistait à avaler une portion de l’aliment testé définie de façon à ce qu’elle délivre exactement 50 g de glucides (8). Ceci correspondait à 100 g de pain, 50 g de sucre, ou 400 g de pomme, par exemple. Leur déglutition complète ne demandait pas le même temps, et on devine déjà que les résultats allaient s’en ressentir. L’enregistrement de la glycémie à intervalles réguliers permettait de tracer la courbe de glycémie. L’espace compris entre celle-ci et l’axe horizontal décrit une surface en forme de chapeau melon ou, dans d’autres cas, de montagne jurassienne. En comparant ces surfaces à celle du glucose on pouvait en déduire un paramètre qui, aujourd’hui, est entré dans le langage courant, « l’index glycémique ». Par exemple, si la surface correspondant aux variations de la glycémie après prise de glucose correspond, arbitrairement, à 100, et si le calcul (par intégration) montre que pour un aliment X elle est seulement de 66, on dira que l’aliment en question possède un index de 66. Plus le chiffre est faible, plus l’ingestion de l’aliment considéré perturbe peu la glycémie, et inversement (4).
DES RESULTATS ETONNANTS :
Les résultats obtenus ont évidemment beaucoup étonné à l’époque, car ils contredisaient largement les idées préconçues, et largement popularisées qu’on avait sur la question. Si nous nous y attardons un court instant, c’est par ce que les enseignements qui en ont été tirés vous nous resservir plus loin dans cet article. Revenons donc à nos glucides ; bien loin de se présenter en deux familles très distinctes comme on le pensait, il est en fait apparu que leurs index se rangeaient dans un continuum ininterrompu, et la caractérisation « sucres lents », « intermédiaires » ou « rapides » devenait alors une simple affaire de convention et de choix arbitraire de frontières. Mais là n’est pas le plus instructif. On a surtout constaté que certains aliments ne se situaient pas là où on les attendait. Ainsi, le pain blanc est quasiment comparable au sucre blanc. Pourtant quoi de plus différent, a priori, qu’un assemblage d’amidon d’un côté, et de saccharose de l’autre ? On a encore vu que, selon la forme sous laquelle on l’amène, l’index d’un aliment donné varie beaucoup. Par exemple avec la pomme. A quantité de sucre égale, le jus provoque une élévation de la glycémie plus importante que la pomme entière. Ce constat, qu’on retrouve aussi par exemple avec la pomme de terre (qui cuite à la vapeur modifie beaucoup moins la glycémie que consommée en purée), amène à penser que des caractéristiques de structure moléculaire ou de texture jouent beaucoup plus, sur les modalités d’absorption de certains nutriments, que le fait qu’il s’agissent d’amidon ou de sucre. Le plus bel exemple de cette tendance curieuse nous est fourni par le riz. Il peut renfermer deux types d’amidon qui se nomment l’amylose et l’amylopectine (12, 13). Extérieurement, rien ne distingue vraiment deux variétés de riz où ces deux types d’amidons apparaissent à des taux différents. Mais l’amylose, à cause du maillage de sa molécule, est plus difficile d’accès pour les enzymes digestifs, de sorte que les types de riz- comme le basmati- où il abonde, présentent des index glycémiques très bas. Pour résumer, des particularités structurelles font que, en dépit de compositions vraiment très proches, deux aliments riches en glucides, voire deux variétés d’un même aliment, peuvent avoir des effets métaboliques radicalement différents.





LES PROTEINES LENTES, UNE RECENTE DECOUVERTE :
Curieusement, le même phénomène existe avec les protéines. Cette découverte récente ne manque pas d’étonner (6). Usuellement, le choix d’une source de protéines plutôt qu’une autre reposait sur d’autres critères, tels que la « qualité ». Rappelons de quoi il s’agit ; les protéines se présentent comme des chaînes constituées de plusieurs milliers d’éléments simples, nommés les « acides aminés ». Il en existe 20 sortes différentes, qui constituent en quelque sorte l’alphabet de base à partir duquel on construit les protéines, le roman de la vie. Onze d’entre eux sont apportés à la fois par notre ration et élaborés par notre organisme. Ainsi, en-dehors de certaines situations pathologiques où certains, comme la glutamine, peuvent devenir « semi-essentiels », du fait de besoins fortement et transitoirement accrus (5), leurs apports ne posent pas de problèmes précis lorsqu’on s’intéresse à l’équilibre protéique à l’échelle de la journée. Par contre, neuf autres ne peuvent pas être élaborés par nos tissus. Ils sont donc pour cette raison qualifiés d’essentiels et, de ce fait, nous dépendons exclusivement de notre assiette pour assurer la couverture quotidienne de nos besoins en ceux-ci. Les acides aminés essentiels sont tirés des aliments que nous consommons, mais toutes les denrées ne les délivrent pas à des taux équivalents ni suffisants. Cette hétérogénéité explique que tous les aliments, sur ce plan, ne sont pas égaux, et ce constat a conduit à l’apparition du concept de « qualité » ou de « valeur biologique » des protéines. Une protéine sera dite de « haute valeur biologique » si les acides aminés essentiels y apparaissent à un taux pouvant assurer la satisfaction d’une fraction importante de nos besoins. Ces éléments sont assez largement connus. Ce sont eux qui ont conduit à présenter la protéine du blanc d’œuf (l’ovalbumine), comme la protéine de référence, dans le sens où les différents acides aminés essentiels y apparaissent à des taux qui assurent la couverture optimale des besoins des sédentaires. Chez le sportif, de nombreux arguments suggèrent que la protéine de référence serait non pas ce blanc d’œuf, mais une ovalbumine qui aurait été enrichie en trois acides aminés particuliers, nommés les « ramifiés » (9). Inversement, les protéines végétales présentent toutes des facteurs limitants, c’est-à-dire un ou plusieurs acides aminés essentiels apparaissant à des taux trop faibles, ce qui a favorisé les associations alimentaires entre céréales et légumes secs ou céréales et laitages. De ce fait, leurs manques respectifs se compensent, comme lorsqu’on prend un jeu de cartes sans cœur, et un autre sans pique, pour en constituer un avec lequel on puisse jouer.
Cette notion de « qualité » est indissociable de l’aspect quantitatif, dans la mesure où un apport protéique globalement trop faible ou une restriction énergétique chronique conduisent au détournement partiel des acides aminés. Ils vont moins participer aux synthèses protéiques et davantage prendre part à des rôles annexes, notamment à finalité énergétique (16). Cet ensemble d’éléments revêt un caractère éminemment complexe, mais d’un point de vue pratique, la manière d’organiser la prise alimentaire dans le but d’optimiser les apports en protéines est désormais l’objet d’un consensus global (7). On les a déjà largement développées dans ces colonnes.
Les particularités du métabolisme protéique ont en outre nécessité de s’intéresser à la chronologie optimale des apports. Chez un sportif doté d’un importante masse musculaire et s’entraînant au moins 4 fois par semaine, la répartition du besoin protéique, de l’ordre de 1 à 1,5 g/kg.j, conduira à envisager trois repas quotidiens renfermant chacun un minimum de 20 g de protéines. Ceci conduit à une réforme conceptuelle du petit déjeuner, comme on l’a vu au numéro précédent. Cela oblige aussi à réfléchir aux conditions les plus opportunes pour optimiser la disponibilité des acides aminés au niveau cellulaire. Quelques travaux (3, 10, 21), ont insisté sur l’intérêt potentiel d’une prise très rapide de protéines associées à des glucides le plus tôt possible après la fin de l’activité, ceci afin d’optimiser les synthèses protéiques, notamment dans les masses musculaires précédemment sollicitées. Apporter un repas plus riche en protéines immédiatement après l’effort semblerait alors une réponse logique, mais deux écueils se présentent ; le premier est lié à l’importante limitation qui résulte des perturbations des fonctions digestives, consécutives à l’exercice, et qui peuvent se poursuivre bien après l’arrêt de l’activité (17). Ceci a pour conséquence d’obliger à privilégier les protéines apportées sous forme de boissons en récupération. Or cette option introduit le second écueil. Il a trait au temps requis pour que les sources de protéines, suite à leur digestion, libèrent leurs acides aminés constitutifs et qu’ils arrivent dans les cellules. C’est en travaillant sur ce dernier point que des auteurs ont récemment mis en évidence des différences de cinétique très nettes d’une protéine à l’autre ; protéines lentes contre protéines rapides. Avec des répercussions pratiques encore difficiles à apprécier.
CASEINE CONTRE ALPHA-LACTALBUMINE :
La mesure des taux des différents acides aminés juste après un repas montre que ceux-ci peuvent fortement varier suivant les modalités d’ingestion. Ainsi, lorsqu’on avale un repas uniquement constitué de protéines (ce qui n’est pas une situation « habituelle »), on observe une augmentation brutale mais transitoire de leur teneur (1, 19). Par contre, lorsque les mêmes protéines sont données en continu, par petites doses, de façon à copier un processus d’absorption lente, l’élévation des taux sanguin d’acides aminés est moins nette, mais plus durable (20). Ces différences ont peut-être des répercussions concrètes. En effet, on sait que les acides aminés peuvent moduler la synthèse protéique, mais aussi leur dégradation ou leur oxydation. Pour cette raison, des différences d’aminoacidémie, liées à des modalités d’ingestion différentes, pourraient en théorie influer sur la balance azotée (2). Ceci, évidemment serait intéressant dans le cadre de la pratique sportive, que ce soit en relation avec la casse musculaire à réparer, ou avec l’objectif de gain de masse. Cette hypothèse a intéressé une équipe de chercheurs français, qui a décidé de jeter son dévolu sur deux protéines issues du lait. La première, l’alpha-lactalbumine, est une molécule soluble, alors que la seconde au contraire coagule dans l’estomac, ce qui ralentit son passage de l’estomac vers les intestins et, vraisemblablement, conduit à une libération retardée de ses acides aminés constitutifs (11). Ces deux protéines considérées isolément seraient donc l’archétype des protéines « rapides » pour l’une, et « lentes » pour l’autre. Les volontaires les ingéraient sous la forme d’un repas unique, à la suite duquel, grâce à l’utilisation de la leucine marquée au carbone 13, il était possible de suivre minute après minute, le devenir métabolique des acides aminés constitutifs. Qu’a-t-il été constaté ? Que la prise d’alpha-lactalbumine provoque une élévation importante, mais modérée des taux d’acides aminés plasmatiques, suivie d’une augmentation importante, immédiatement après ce « repas », de la synthèse protéique (+ 68%). Dans le cas de la caséine, le paramètre sanguin s’élevait moins, tout comme la synthèse protéique (+ 31%). Cela signifie-t-il « avantage » à l’alpha lactalbumine » ? Pas forcément. Si on prolonge la durée d’observation et qu’on prend également en compte l’oxydation des acides aminés (comme carburants d’urgence), on note qu’avec l’alpha lactalbumine, l’oxydation est également accrue. De ce fait, à l’échelle de la journée, la balance protéique était davantage positive après ingestion de la protéine « lente ».
Dans une autre étude (6), une stratégie un peu différente a été déployée par la même équipe, faisant toujours appel aux mêmes protéines. Outre les deux situations précédentes, deux autres ont été inventées pour l’occasion ; la première a consisté à donner une solution d’acides aminés correspondant à celle qu’on obtiendrait, au niveau intestinal, après dégradation de la caséine par des enzymes digestifs. Ceci visait à rendre « rapide » la protéine lente, en court-circuitant l’étape gastrique et enzymatique. La seconde a consisté à donner de petites fractions d’alpha lactalbumine toutes les 20 mn, ce qui apportait à l’organisme des acides aminés d’une façon qui correspond à une protéine « lente ». Ainsi, cet artifice ralentissait la protéine rapide. Ces quatre situations étant testées, il est apparu que, dans tous les cas, l’arrivée rapide des acides aminés dans le sang provoquait une augmentation immédiate plus importante des synthèses. Ceci était vrai quelle que fût la protéine de départ, caséine trafiquée ou alpha lactalbumine normale. Par contre là aussi, avec un recul de sept heures, l’équilibre protéique était meilleur si l’apport était réalisé sous forme de « protéines lentes ».
La caséine n’est pas la seule protéine alimentaire à coaguler. Voyez par exemple les variations d’aspect des protéines d’œuf, selon les modes de cuisson retenus. De plus, l’atténuation de la vidange gastrique des protéines peur être liée à d’autres facteurs. La présence simultanée de graisses, de tissu conjonctif, l’ingestion de légumes riches en fibres avec la viande ou le poisson y contribuent aussi. Ceci peut expliquer que si la chair de poisson maigre quitte l’estomac en un peu plus d’une heure, celle du maquereau, quant à elle, peut séjourner neuf heures dans l’estomac avant de le quitter. Il s’agira alors de protéines très lentes (16).





QUE FAIRE DE TOUT CECI ?
Le contexte de cette expérience a amené à isoler un facteur qui, considéré séparément, est capable d’influer sur la synthèse protéique. Or, deux autres éléments comptent plus encore que l’apport protéique ou le type d’acide aminé qui prédomine ; ce sont d’une part l’activité musculaire, et la forme de travail choisie, et d’autre part le contexte hormonal (7). L’adaptation du métabolisme protéique en réponse aux apports alimentaires pendant la phase de récupération est une question qui a suscité de très intéressants travaux (18). Par exemple, un exercice de force accompli à jeun produit un bilan protéique négatif ; en clair on perd du muscle dans ces conditions (14) A l’inverse, si le taux d’insuline augmente fortement après un exercice de ce type, les acides aminés et le glucose entrent conjointement plus vite dans le muscle (21). Ceci indique que, si tôt l’activité terminée, une prise mixte de protéines et de glucides (avec idéalement un ration de 3/1) optimise à la fois les synthèses protéiques et la reconstitution du glycogène. Ceci est vrai chez des sujets jeunes dotés d’un capital hormonal correct. Chez eux, l’association protéines « rapides »- glucides dans un premier temps (ce que proposent beaucoup de « weight gainers » sur le marché, qui contiennent des protéines du « petit lait »), puis un apport protéique régulier par la suite, optimisent la récupération musculaire et les adaptations attendues à la suite d’un travail de force. Par contre chez les sujets plus âgés, éventuellement concernés par la sarcopénie, la prise de « protéines lentes » telles que la caséine semble à privilégier. Pourquoi ? Tout simplement parce que chez eux la contribution des acides aminés à la stimulation des synthèses sera, compte tenu de la diminution des sécrétions hormonales anabolisantes, plus importante (6).
Chaque aliment contient différentes protéines, toutes dotées de caractéristiques propres. En fait, le protocole utilisé ici est assez artificiel, dans le sens où, hormis sous forme de préparation en poudre, il est très rare de trouver un seul type de protéine, de surcroît isolée, dans un aliment donné. Aussi, ceux qui se montrent réfractaires aux protéines en poudre peuvent envisager de contourner ces difficultés en associant, dans un premier temps, protéines laitières et glucides (par exemple yaourt à boire, jus de fruit, fruits secs). Ce laitage apportera, entre autres, à la fois l’alpha-lactalbumine et la caséine, c’est-à-dire protéines « rapides » et protéines « lentes ». Il apportera aussi du sucre et des graisses, pour un résultat final assez difficile à prédire, mélange d’effet « rapide » et d’action « retard », sans doute. Ensuite, la consommation d’aliments riches en protéines de qualité sera favorisée au cours du repas suivant l’entraînement. Le souci de favoriser le maintien de l’équilibre acide-base dans ces conditions, surtout si l’effort a été intense, amènera alors à favoriser les œufs et les laitages (15).
Ceci, évidemment, sera conditionné par la bonne tolérance du sujet à ces aliments. En outre, d’éventuels perturbations de l’écosystème digestif, consécutives au processus d’ischémie- reperfusion et aggravées par l’absence de prise de boisson au cours de la session de musculation, peuvent favoriser le passage de protéines alimentaires dans la circulation et leur conférer un pouvoir antigénique qui, chez certains individus, peut revêtir, à terme, un caractère potentiellement néfaste ; or, en phase de récupération, l’irrigation des viscères tarde à revenir à la normale, et cette période immédiatement consécutive à l’exercice demeure un moment à risque sur le plan intestinal. Des protéines alimentaires peuvent passer dans la circulation et se comporter comme des antigènes. Parmi celles souvent en jeu reviennent régulièrement, justement, les protéines de lait (17). Ces phénomènes peuvent donc conduire à privilégier, à ce moment-là, non pas la consommation d’aliments renfermant des protéines entières, mais plutôt des boissons associant peptides et glucides. Les peptides sont en effet des fragments de protéines, comprenant moins de 20 acides aminés, et dénués de caractère antigénique. De par leur scission préalable, ces peptides se comportent, comme dans les deux expériences décrites, comme des protéines « rapides ». On leur fera succéder des protéines alimentaires, prises dans le contexte du repas, qui seront pour leur part des « protéines lentes ».
En-dehors du champ du monde sportif, cette découverte mettant en évidence différentes catégories de protéines sur la base de leur vitesse d’absorption, va avoir de très importantes retombées dans le domaine des pathologies. Auprès des personnes âgées, par exemple, chez des brûlés, ou encore à la suite d’interventions chirurgicales ou de périodes d’immobilisation forcée… pour lesquelles, là aussi, les sportifs trouveront des applications concrètes à ce nouveau concept. Rendez-vous dans quelques années pour faire le point !
ENCADRE 1 : PETIT LAIT POUR GROS BICEPS !
L’alpha-lactalbumine, la protéine « rapide » des travaux évoqués ici, est abondamment présente dans le petit lait, et les adeptes du culturisme ou de la musculation peuvent en disposer depuis plus de dix ans sous forme de mélanges de poudre riches en « whey proteins », terminologie anglaise de cette molécule. Empiriquement, ils avaient observé qu’elle favorisait nettement la synthèse protéique en post-effort (3).
Cette protéine présente une autre caractéristique, sa richesse en tryptophane, à nulle autre pareille dans la grande famille des protéines (2). Quel avantage cela représente-t-il ? Potentiellement celui d’apporter rapidement au cerveau, et dans un rapport très favorable relativement aux acides aminés concurrents, le précurseur de la sérotonine. Celle-ci participant au contrôle des pulsions et son déficit pouvant favoriser l’installation des addictions, l’idée est venue à certains auteurs de tester l’intérêt d’un complément riche en alpha-lactalbumine dans l’aide au sevrage tabagique et les pulsions sucrées. Pour en optimiser les effets, il est recommandé d’éviter au cours du même repas les aliments riches en protéines animales, car ils renferment de grandes quantités de tyrosine et d’acides aminés ramifiés. Or, tant au niveau des entérocytes que de la barrière hémato-méningée, ce sont els concurrents directs du tryptophane. Cette « alimentation adaptée » est donc supposée optimiser la synthèse de sérotonine chez les sujets déficitaires. De fait, les premiers résultats, en cours de publication sont très encourageants (1, 2).
(1) : CHOS D (2004) : « La vérité si je mange », JF Laffont Ed.
(2) : COUDRON O (2001) NAFAS, 5 : 13-8.
(3) : KLEINER S, GREENWOOD ROBINSON M (1999) : « Alimentation musclée » (trad. D.Riché), Vigot Ed.
ENCADRE 2 : LA RATION PROTEIQUE EN PRATIQUE :
En pratique, l’optimisation des apports protéiques reposera, dans la mesure où on respecte les tolérances individuelles aux aliments, sur la proposition de répartition suivante :
- un œuf ou une tranche de jambon, un yaourt et 40 à 50 g de müesli ou 80 g de pain le matin. Ceci représente un apport protéique équilibré de l’ordre de : 17 à 20 g de protéines.
- Dès la fin de l’entraînement,, une boisson énergétique enrichie en acides aminés ou un yaourt à boire et un tétrabrik de jus de fruit, de façon à assurer un apport protéique optimal (rapport glucides/protéines = 3/1) et de manière à respecter le confort digestif). Total de cet apport : 10 g de protéines.
- Le midi : privilégier la volaille ou le poisson (moins acidifiants que la viande rouge). Après une séance de musculation, compter 200 g poids cuit, auxquels s’ajoutent une portion de pain et une demi-assiette de féculents, suivis d’un laitage. Total de l’apport : 45 à 50 g.
- L’après-midi : Lait de soja aux céréales ou 40 g de fromage frais avec du pain. Total de l’apport protéique : 10 g.
- Le soir : 150 g de poisson, une demi-assiette de légumes secs, une portion de pain (plus les légumes verts et le fruit) : TOTAL : 50 g.
Total de la journée : environ 140 g, ce qui permet de satisfaire les recommandations optimales de 1,5 g/kg de poids et par jour de la majorité des sportifs.
BIBLIOGRAPHIE :
(1) : BERGSTRÖM J, FÜRST P & Coll (1990) : Clin.Sci.,79 : 331-7.
(2) : BOIRIE Y, DANGIN M & Coll (1997) : Proc.Natl.Acad.Sci. USA, 94 : 14930-5.
(3) : BRENNER B, MEYER T & Coll (1982) : New Eng.J.Med., 307 (II) : 652-9.
(4) : BURKE LM, COLLIER GR & Coll (1998) : Int.J.Sport Nutr., 8 : 401-15.
(5) : CYNOBER LA (2001) : Can.J.Appl.Physiol., 26 (Suppl.) : S 36-44.
(6) : DANGIN M, BOIRIE Y & Coll (2001) : Am.J.Physiol.Endocrinol.Metab., 280 : E 340-8.
(7) : DECOMBAZ J (2004) : Sci.Sports, 19 : 228-33.
(8) : JENKINS DJA, WOLEVER TMS & Coll (1981) : Am.J.Clin.Nutr., 42 : 604-17.
(9) : KIEFFER F (1988) : Méd.Hyg., 46 : 2213-21.
(10) : LEVENHAGEN DK, GRESHAM JD & Coll (2001) : Am.J.Physiol. Endocrinol. Metab., 280 : E 982-93.
(11) : MAHE S, ROOS N & Coll (1996) : Am.J.Clin.Nutr., 63 : 546-52.
(12) : MESTRES C, COLONNA P & Coll (1988) : J.Food Sci., 53 (6) : 1809-12.
(13) : MILLER JB, PANG E & Coll (1992) : Am.J.Clin.Nutr., 56 : 1034-6.
(14) : PHILLIPS SM, TIPTON KD & Coll (1997) : Am.J.Physiol. Endocrinol. Metab., 273 : E99-107.
(15) : REMER T & Coll (1995) : J.Am.Diet.Ass., 96 : 791-7.
(16) : RICHE D (1998) : « Guide nutritionnel des sports d’endurance- 2e version », Vigot Ed.
(17) : RICHE D (2004) : NAFAS, 2 (3) : 17-29.
(18) : TIPTON KD, WOLFE RR (2004) : J.Sports Sci., 22 : 65-79.)
(19) : WAHREN J, FELIG P & Coll (1976) : J.Clin.Invest., 57 : 987-99.
(20) : WOLEVER TMS (1994) : Am.J.Med.Sci., 307 : 97-101.
(21) : ZADAWSKI K, YASPELKIS III B & Coll (1992) : 72 : 1854-9.
Denis Riché. pour Sport et Vie – 2005
Photos : MCC
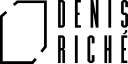
0 commentaires