La mise en cause d’Alberto Contador sur la base de la présence de phtalates dans ses urines l’expose sans doute à une sanction des instances sportives. Et peut-être à la stérilité…
TRAHI PAR L’EMBALLAGE :
La récente publication de l’équipe du Groupe de Recherche de Bioanalyses de l’Hôpital de Barcelone n’a pas fait de ses auteurs de grands patriotes. En effet, ces spécialistes de la toxicologie ont voulu répondre à une question qui les taraudait depuis un bon moment. Et en y parvenant ils ont mis Alberto Contador sur la sellette dès la parution de leurs travaux. Ils se posaient pourtant une question à l’origine très éloignée des préoccupations du monde de la Petite Reine : Les patients hospitalisés, régulièrement transfusés dans leur service, se trouvaient-ils soumis à une forme de pollution « iatrogène » qui leur serait préjudiciable (22) ? Pourquoi une telle question ? On sait que les poches plastiques servant à stocker le sang avant transfusion contiennent des dérivés de plastique dont certains, comme le DEHP (abréviation de « di-(2-ethylhexyl)phtalate », peuvent diffuser dans le sang. Or, depuis le début de ce siècle, les écrits se multiplient pour rendre de plus en plus crédible l’hypothèse selon laquelle ces molécules se solubiliseraient lentement dans les poches plastiques (et seraient de ce fait administrées aux patients lors des transfusions).Ces substances seraient dotées d’effets néfastes qui inquiètent les épidémiologistes. Ainsi, on les accuse de provoquer des perturbations endocriniennes, d’être cancérigènes (22) et enfin de réduire la fertilité des hommes (29). Rien que çà ! Les dérivés du DHEP, produits au niveau du foie, sont excrétés dans les urines. Cela permet de les y doser et de déterminer le niveau d’exposition des populations occidentales. Cela pourrait aussi servir à toute autre chose, comme de repérer les sportifs qui auraient eu recours à des auto-transfusion, par exemple. En effet cette pratique, jusque là indétectable par des techniques classiques, aurait un point faible. La conservation du sang dans sa poche, avant la réinjection dans l’organisme du tricheur, peut durer plusieurs mois, ce qui en théorie pourrait constituer un délai suffisant pour que les dérivés du DHEP diffusent dans le liquide qui y serait conservé. Ils seraient alors réinjectés avec le sang, de là, seraient retrouvés dans les urines où il suffirait alors de les doser. Tout le problème, bien sûr, est de savoir si les taux rencontrés laisseraient une place au doute.
« PLASTIC AGE » :
Le doute existe en effet ; comme le chantaient les Buggles il ya 30 ans, nous sommes entrés dans l’ère du plastique. Bouteilles, emballages, films protecteurs, récipients de conservation (avec les réunions « Tupperware » initiées aux USA auprès des ménagères « modernes »), appareils électro-ménagers, pièces d’automobile… la liste est longue. On considère aujourd’hui que la dissémination de dérivés non dégradables devient inquiétante. De fait, il est quasiment impossible de rencontrer un individu de plus de 30 ans chez qui lequel on ne retrouverait aucune trace de DEHP (17). Pour autant, les taux varient-ils significativement suivant les modes de vie et les niveaux d’exposition ? C’est là que l’étude menée par l’équipe du professeur Jordi Segura s’avère précieuse. Ces chercheurs catalans ont constitué, au sein de la population venant consulter dans leur service, trois cohortes distinctes. La première englobait 15 hommes et 15 femmes, volontaires, constituant le groupe contrôle. Ils étaient représentatifs du niveau d’exposition « moyen » de la population générale. Pour le second, ils avaient enrôlé 25 sujets qui s’étaient rendus dans leur service pour y subir une transfusion sanguine. Le dernier était composé de 39 sujets, ayant été mis au contact de matériaux plastiques durant leur séjour hospitalier (catether, tubes, aiguilles, nutrition parentérale), mais n’ayant pas subi de transfusion (22). Parallèlement, à la demande d’acteurs de la lutte anti-dopage, le même travail fut mené auprès de 127 sportifs de haut niveau, dont des échantillons d’urine avaient préalablement été recueillis. Parmi eux figuraient 46 cyclistes, 22 rameurs, 18 nageurs et 41 footballeurs. Pour l’ensemble de ces sujets, Ventura et ses collègues procédèrent au recueil d’urines (dans des récipients sans DHEP) sur 24 ou 48 heures, pour y mesurer les taux de DHEP et de ses deux dérivés, et pour voir les cinétiques d’élimination. C’est l’ensemble constitué par le DHEP et ses dérivés qu’on nomme « les phtalates ». Qu’ont-ils tiré comme informations ? Ils trouvèrent des différences très marquées entre les trois groupes (voir le tableau 1). Pour chaque cohorte, les valeurs tendaient à se répartir selon une courbe de Gauss. Nous vous livrons dans le tableau la moyenne, la valeur correspondant au 90ème percentile (c’est-à-dire celle sous laquelle se trouvent 90% des effectifs) et les valeurs maximales de chaque groupe.
Les chiffres de l’équipe catalane en sont très proches des autres valeurs mentionnées dans la littérature médicale. En effet, la moyenne des valeurs du groupe contrôle se situe à 74, et celle des sportifs à 44. Or, les données d’observation publiées ces dernières années à partir d’effectifs assez importants, représentatifs de la population générale, font état de valeurs moyennes proches de 50 ng/ml (16-7). On note également que la mise en contact récente avec du matériel médical contenant du plastique favorise une élévation de la teneur urinaire de phtalates, puisque chez les sujets hospitalisés (et non transfusés), on note un pic urinaire le surlendemain du séjour hospitalier, correspondant environ au double de la valeur moyenne du groupe « contrôle ». On peut considérer que, en l’espace de quelques jours, la valeur se normalisera totalement. Dans l’ensemble, en tout cas, ces pratiques médicales ne modifient pas particulièrement le niveau d’exposition des patients. Il n’en va pas de même chez les sujets transfusés. Dans leur cas, en effet, on observe des valeurs bien plus importantes. La moyenne obtenue est de 5 à 9 fois plus que celle du groupe « contrôle ». Quant aux maximas, ils peuvent être plus de cent fois supérieurs à la moyenne. Ces données semblent justifier les craintes du professeur Jordi Segura et de ses confrères quant au risque de pollution « iatrogène ».
Qu’en est-il de la population sportive ? Chez elle, on trouve une distribution comparable à celle du groupe « contrôle », hormis pour 4 échantillons qui, à l’instar d’Alberto Contador, sortent clairement de la courbe. Ils présentent en effet des valeurs comprises entre 240 (pour l’un) et 450 ng/ml (pour les trois autres), soit dix fois la valeur moyenne du groupe de sportifs ici testés ou du groupe « contrôle ». La moyenne mesurée chez les patients hospitalisés et transfusés se situe à 666 (pour les premières 24 h) et 376 ng/ml (le surlendemain de la manipulation). De là à penser que ces quatre sportifs se soient fait réinjectés du sang juste avant d’être contrôlés…
En l’absence de chiffres précis, il ne nous appartient pas de commenter le cas d’Alberto Contador, si ce n’est pour rappeler qu’il présenterait des « taux beaucoup plus élevés » que la normale », selon les auteurs de ce travail. Cette anomalie risque de le mettre hors jeu un moment, pour cause de suspension. Deux ans qu’il pourrait consacrer à méditer. Mais sans doute pas, hélas pour lui, à faire des enfants…
TABLEAU 1 : TAUX DE PHTALATES (en ng/ml)
|
POPULATION |
MOYENNE |
90ème percentile |
Maxima |
|
Groupe « contrôle » |
74,1 |
167,5 |
244 |
|
Patients transfusés (0- 24ème heure) |
666 |
2469 |
11.010 |
|
Patients transfusés (24ème– 48ème heure) |
376,4 |
1752 |
3602 |
|
Patients non transfusés (0-24ème heure) |
61 |
188 |
976 |
|
Patients non transfusés (24ème-48ème heures) |
130,6 |
340 |
661 |
|
Sportifs (*) |
44 |
120 |
Voir texte |





LE PLASTIQUE FAIT CAPOTER LE PROJET :
Rappelons qu’initialement Jordi Segura ne s’était pas réveillé en pleine nuit, poussant des « Eureka ! », convaincu qu’il allait apporter une pierre nouvelle à l’édifice de la lutte anti-dopage. Sa préoccupation état celle d’un toxicologue, régulièrement présent sur les congrès où, de plus en plus, il a entendu parler de la pollution liée aux dérivés de plastique. Certains auteurs, s’emparant de ces faits, n’hésitent plus, dans leurs écrits, à pointer le risque de cancer associé à une exposition chronique aux phtalates (27). Qu’en penser vraiment ?
Dans le domaine de la toxicologie, plusieurs erreurs sont fréquemment commises. La première consiste à considérer que toute trace d’un produit potentiellement dangereux dans un de nos aliments ferait de ce dernier une denrée toxique impropre à la consommation. On rencontre par exemple ce type de raisonnement avec les produits marins, que beaucoup ne mangent plus au prétexte qu’ils renferment des métaux lourds. Au point d’en oublier la richesse micronutritionnelle de leurs chairs. Comme le signalait récemment avec malice le professeur Philippe Legrand dans les colonnes du journal « Le Monde » : « Par l’application stricte du principe de précaution on finit par avoir peur de tout, et l’éviction d’un nombre croissant d’aliments va nous faire mourir de faim, mais en bonne santé (*) ». Il en va de même avec le phtalate. En trouver des traces dans nos urines, consécutivement à leur ingestion avec nos aliments, signifie-t-il que nous sommes en danger ? Les avis sont partagés. On a pourtant besoin d’un avis clair. La seconde consiste à confondre exposition aigüe et exposition chronique. Une forte dose de quelques substances peut tuer instantanément, mais quelle petite dose quotidienne suffit à nous faire mourir à petit feu ? Cette question suscite de permanents débats d’experts, où s’affrontent les optimistes et les pessimistes. La dernière erreur est liée aux effets cumulés (5, 13). En gros, la toxicité d’un produit n’est pas seulement liée à sa présence exclusive à un niveau « seuil ». Sa nocivité peut aussi s’exprimer lors de la combinaison de plusieurs toxiques dont les effets peuvent s’ajouter, voire se multiplier. Comme lors de ces tentatives de suicide où on mélange les somnifères à l’alcool pour potentialiser les dangers des deux toxiques. Ainsi, chez l’Homme, l’exposition au DEHP et à ses dérivés s’ajoute à celle due à d’autres molécules qualifiées de « xénobiotiques » et dont les effets, selon les toxicologues les plus pointus, s’ajoutent les uns aux autres (8).
Malgré tout, les données s’accumulent dans deux directions précises. Celle qui décrit les niveaux d’exposition croissant de la population aux phtalates. Et celles des études menées directement chez l’animal et qui dérivent les effets délétères directs de ces substances. Seul souci de cette approche : L’extrapolation à l’homme des valeurs sanguines obtenues chez l’animal comporte toujours une part d’incertitude (32). L’histoire de la pharmacologie comprend trop de fâcheux précédents pour se contenter de cette attitude.
DU SPERME EN BERNE :
D’abord, voyons ce que nous apprend l’épidémiologie. Les données accumulées ces dernières années donnent une idée du contexte. Les taux mesurés au sein des populations augmentent au fur et à mesure que les dates de parution se rapprochent de 2010. Aujourd’hui, les moyennes avoisinent 50 ng/ml (4, 12, 13, 16) et la répartition des taux, au sein des différentes populations testées, épouse la forme d’une courbe de Gauss. Pour autant, cela signifie-t-il qu’il s’agit d’une situation normale ? Les épidémiologistes optimistes pensaient encore, il y a deux ans, que c’était le cas (**). Hélas, ils ont dû réviser leur opinion à la lumière de faits récents. Une étude initiée par l’équipe du professeur John Wirth, du Département d’épidémiologie de l’Université du Michigan, et publiée en 2008, a consisté à mesurer le taux de phtalates dans les urines de 45 hommes qui s’étaient rendus au préalable dans une clinique traitant les problèmes de fertilité (31). Simultanément, la qualité du sperme (morphologie des spermatozoïdes) et leur nombre furent évalués. Il ressort de cette étude que le taux urinaire et les anomalies du spermogramme étaient corrélés. L’an dernier, une équipe polonaise a porté le coup de grâce. Cette publication, réalisée par l’équipe du professeur Bonde de l’Université de Lodz (15), a décrit les mêmes anomalies, « à des taux de phtalates habituellement rencontrés par la population » (***). Autrement dit, la présence phtalates dans l’organisme de jeunes hommes peut potentiellement affecter leur fertilité. Et cet été des auteurs indiens sont allés dans leur sens. Des mesures ont été effectuées dans une région industrielle de leur pays. Elle a permis de constater que, là aussi, la présence de phtalates (à des taux très voisins que ceux trouvés dans l’étude américaine), donnaient lieu à d’importantes perturbations des spermatozoïdes au sein de cette population masculine jeune (de 21 à 40 ans) (24). Ces données obtenues chez l’Homme confirment hélas tout ce que les travaux fondamentaux laissaient présager ; ainsi, le travail conduit au sein du laboratoire de Gamétogénèse et Toxicité de Fontenay aux Roses a décortiqué l’impact de ces toxiques sur des cellules fœtales de testicule mises en culture. Roger Habert et ses collègues ont constaté que, à n’importe quelle dose, ces dérivés de plastique affectaient le bon déroulement de la spermatogénèse (18). Ils ont notamment observé une apoptose accrue des cellules germinales. Si Woody Allen tournait un remake de : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe… » en 2010, il aurait besoin d’un nombre de figurants nettement réduit, par rapport à la version originelle. Et il lui faudrait aussi sans doute davantage d’hommes de couleur !




LE PLASTIQUE SUFFIT-IL ?
Les données du professeur WIRTH, sont donc troublantes, puisqu’elles suggèrent que le niveau d’exposition aux phtalates de l’ensemble de la population masculine fait de chaque jeune homme un individu risquant de devenir stérile. Au point de se demander pourquoi ils ne le sont pas tous. Certes, selon des statistiques pudiquement passées sous silence, c’est pas moins d’un couple sur 6 qui en France, en 2009, avait des difficultés de procréation, et un sur dix qui entreprenait des démarches en vue d’une procréation assistée (10). C’est une statistique très inquiétante… mais encore rassurante. En effet, cela signifie que, à niveau d’exposition égale (et suffisante pour rendre stérile une fraction importante des jeunes hommes), 82% d’entre eux ne rencontrent encore aucun problème pour procréer. Alors ? Alors cela indique, évidemment, qu’il ne s’agit pas d’un problème monofactoriel. La toxicologie, mais aussi la nutrition expliquent la diversité des réponses des mâles à un environnement devenu très hostile. Les experts mettent au banc des accusés un autre polluant très présent dans notre assiette : le cadmium. Ce triste représentant des métaux lourds participe à ce que les médecins appellent pompeusement « l’asthénozoospermie » (c’est-à-dire les difficultés rencontrées par des spermatozoïdes devenus paresseux et rares)(23). Les rations qui en délivrent le plus seraient celles qui, par ailleurs, apportent davantage de fibres (donc de légumes) et de fruits de mer (3, 14). Curieux paradoxe que celui qui nous propose de choisir entre moins de toxiques et moins de micronutriments, ou plus de toxiques et d’éléments protecteurs !Le fait est encore plus évident chez les fumeurs, à cause de la présence du cadmium dans le tabac. Et n’en déplaise aux esprits facétieux, avec la pipe ce n’est pas mieux !
Divers déficits peuvent contribuer à entraver le bon déroulement de ce long et complexe processus qui aboutit à la fabrication d’un spermatozoïde valide. Le plus documenté, sans conteste, est celui qui touche la vitamine B9 (encore connu sous le terme général de « folates »). Cette déficience est associée à une augmentation du nombre d’atteintes de l’ADN des futurs spermatozoïdes (7). Le taux de folates sanguin est également inversement corrélé à « l’indice de fragmentation », critère qui décrit une fragilité accrue de l’ADN du spermatozoïde et sert de critère prédictif à une mauvaise procréation (6). La vitamine B12, qui comme la précédente participe à la lecture des gènes et à l’épigénèse, est également requise, faute de quoi son déficit favorise le développement anormal des cellules souches (7). Ces déficits favorisent en outre l’accumulation d’un intermédiaire très toxique, l’homocystéine, qui favorise la survenue d’un important stress oxydatif (11). Cette agression par les radicaux libres peut aussi s’exercer à l’encontre des mitochondries, ce qui va affecter la production d’énergie au sein des spermatozoïdes, qui vont caler davantage au milieu du parcours les menant à l’ovaire (9). L’attaque des membranes des spermatozoïdes est également amplifiée sous l’effet du stress oxydatif, et une fraction importante de ces cellules se déforment alors, quand elles ne se délitent pas carrément, et ces atteintes des lipides constituent un autre facteur de fragilisation des cellules mâles (1)
Plusieurs travaux ont envisagé l’impact du stress oxydatif sur le bon déroulement de la spermatogénèse, et l’intérêt éventuel d’un apport en anti-oxydants sur la protection des gamètes mâles (30).Un travail de compilation paru cet été, à une époque où les spermatozoïdes sont particulièrement appelés à se mouvoir, a analysé les conclusions de 17 études, ayant porté sur 1665 hommes (26). Il ne semble guère y avoir d’équivoque. Dans leur grande majorité, les résultats suggèrent l’influence favorable d’une complémentation anti-oxydante sur des critères aussi variés que la qualité du sperme, sa motilité ou… le taux de grossesse dans les centres où on complémentait les patients avant la tentative de procréation. Les caroténoïdes, la vitamine C, la vitamine E, le zinc et le sélénium sont les substances les plus fréquemment proposées avec succès.
Ces deux derniers toutefois, ne sont pas seulement utiles en tant qu’anti-oxydants (25). Ils possèdent en effet un rôle comme adjoints des enzymes qui permettent l’affinage des futurs spermatozoïdes. Autrement dit, en plus de leur rôle protecteur ils assurent des fonctions d’assembleurs (28). Leurs déficits contribuent donc à majorer le risque de ce que les spécialistes nomment pudiquement « l’infertilité masculine » (25). La densité du sperme est d’ailleurs corrélée au taux plasmatique de ces deux micronutriments (33).
(*) : « Le Monde », 30/08/2010 : «Les recommandations nutritionnelles doivent évoluer ».
(**) : Avant cela, les seuls à redouter la stérilité étaient les rats de laboratoire. Pas de quoi verser une larme, quand on connaît la facilité de cette espèce animale à se reproduire. Ainsi, chez cet animal, des travaux avaient-ils relié des taux urinaires de phtalates élevés à la survenue plus fréquente de cryptorchidie ou d’oligospermie (20).
(***) : Ces auteurs ont établi un autre fait, encore plus troublant. La fréquence d’utilisation des téléphones mobiles est elle aussi corrélée aux anomalies du spermogramme chez ces jeunes hommes.
BIBLIOGRAPHIE :
(1) : AGARWAL A, MAKKER K & Coll (2008) : Am.J.Reprod.Immunol., 59 (1) : 2-11.
(2) : BALERCIA G, BULDREGHINI E & Coll (2009) : Fertil.Steril., 91 (5) : 1785-92.
(3) : BENOFF S, HAUSER M & Coll (2009) : Mol.Med., 15 (7-8): 248-62.
(4) : BLOUNT BC, SILVA MJ & Coll (2000) : Env.Health Perspec., 108 : 979-81.
(5) : BONDE JP (2010) : Asian J.Androl., 12 (2) : 152-6.
(6) : BOXMEER JC, SMIT M & Coll (2007) : J.Androl., 28 (4) : 521-7.
(7) : BOXMEER JC, SMIT M & Coll (2009) : Fertil.Steril., 92 (2) : 548-56.
(8) : DELBES G, LEVACHER C & Coll (2005) : Med.Sci., 21 (12) : 1083-8.
(9) : DOLINOY DC, HUANG D & Coll (2007) : Proc.Natl Acad.Sci.USA, 104 (32) : 13056-61.
(10) : DONNADIEU A, PASQUIER M & Coll (2009) : Cah.Nutr.Diét., 44 : 33-41.
(11) : FORGES T, MONNIER-BARBARINO P & Coll (2007) : Hum.Reprod.Update, 13 (3) : 225-38.
(12) : FROMME H, BOLTE G & Coll (2007): Int.J. Hyg. Env. Health, 210 : 21-33.
(13) : HOLGER M, KOCH H & Coll (2007) : Environ.Res., 93 : 177-85.
(14) : JÄRUP L, BERGLUND M & Coll (1998) : Scand.J.Work Env.Health, 24 (Suppl.1) : 1-51.
(15) : JUREWICZ J, HANKE W & Coll (2009): Int.J.Occup.Med.Environ.Health, 22 (4) : 305-29.
(16) : KATO K, SILVA MJ & Coll (2004) : Environ.Health Perspec., 112 : 327-30.
(17) : KOCH H, DREXLER H & Coll (2003) : Int.J.Hyg.Environ.Health, 206 : 77-83.
(18) : LAMBROT R, MUCZYNSKI V & Coll (2009) : Environ.Health Persp., 117 (1) : 32-7.
(19) : MANCINI A, DEMARINIS L & Coll (2005) : Biofactors, 25 (1-4) : 165-74.
(20) : MARTINO-ANDRADE AJ, CHAHOUD I (2010) : Mol.Nutr.Food Res., 54 (1) : 148-52.
(21) : MAY-PANLOUP P, CHRETIEN MF & Coll (2004) : 20 (8-9) : 779-83.
(22) : MONFORT N, VENTURA R & Coll (2010) : Transfusion, 50 : 145-9.
(23) : OMU AE, DASHTI A & Coll (1995) : Nutrition, 11 (5 Suppl.) : 502-5.
(24) : PANT N, PANT AB & Coll (2010) : Hum.Exp.Toxicol., June 15, ahead of print.
(25) : RICHE D (2008) : “Micronutrition, santé et performance”, De Boeck Ed.
(26) : ROSS C, MORRISS A & Coll (2010) : Reprod.Biomed., 20 (6) : 711-23.
(27) : SERVAN SCHREIBER D (2010) : “anti-cancer”.
(28) : SIVKOV AV, OSHCHEPKOV V & Coll (2009) : Urologia, 6 : 59-62.
(29) : SWAN SH (2008) : Environ.Res., 108 (2) : 177-84.
(30) : TREMELLEN K (2008) : Hum.Reprod.Update, 14 (3) : 243-58.
(31) : WIRTH JJ, ROSSANO MG & Coll (2008): Syst.Biol.Reprod.Med, 54 (3) : 143-54.
(32) : WITTASSEK M, WIESSMÜLLER GA & Coll (2007): Int.J.Environ.Health, 210 : 319-33.
(33) : XU B, CHIA SE & Coll (1993) : Reprod.Toxicol., 7 (6) : 613-8.
Denis Riché, pour « Sport & Vie » – 2010
Photos : MCC
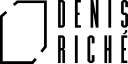
0 commentaires