Avec la frénésie collective et l’angoisse de mort généralisée liée à la pandémie, le port des masques, le nettoyage systématique des mains, l’usage immodéré du gel hydroalcoolique semblent constituer des gestes « barrière » efficaces. Mais avez-vous déjà observé des barrières justement, notamment celles qu’on met en place, le long des routes, pour filtrer les spectateurs et rendre inaccessible la chaussée.? Qu’il est facile de les contourner, de les déplacer et de pouvoir prononcer cette phrase maintes fois entendues : « Chérie, je suis sur la route! » Est-ce si bénéfique de craindre les microbes? On sait depuis le début de ce siècle que vouloir à tout prix éliminer le moindre microbe augmente fortement le risque de développer une allergie… Cet article de 2002 faisait le point sur une situation…. qui n’a fait qu’empirer. Attachez vos ceintures!
TROP D’HYGIENE TUE L’HYGIENE.
Dans l’esprit de beaucoup de nos concitoyens, la maladie est perçue comme étant le résultat d’un combat défavorable entre le microbe et son hôte. La stratégie proposée pour prévenir les risques d’infection repose de ce fait, depuis les travaux princeps de Louis Pasteur, sur la recherche de moyens de plus en plus sophistiqués permettant de neutraliser le plus grand nombre possible d’ennemis potentiels. Et si on se trompait ?
DES ENNEMIS OMNIPOTENTS :
Ce dossier met l’accent sur l’existence de moyens de défense très sophistiqués au sein de notre organisme. Cette défense est organisée par le cerveau, aussi bien face au stress que face aux agents infectieux. Dans le premier cas, il s’agit de déclencher les mécanismes qui permettent de répondre aux agressions, par le choix de comportements appropriés, fuite, lutte, inhibition de l’action, associés à des manifestations physiologiques préparant à la lutte ou à la fuite : accélération du pouls, élévation de la tension artérielle, mydriase, vasodilatation périphérique… La façon dont le comportement s’organise lors de cette situation de stress a été décrite en 1936 par le canadien Hans Selye. Parmi les éléments figurant dans son concept, il est apparu que l’exposition répétée à une situation donnée finit par nous y habituer. Le « stress » perçu chute alors. Par contre le stress aigü, ou la répétition de sollicitations trop intenses peuvent déborder les capacités de réponse du sujet. Dans le domaine du sport, ceci conduira le champion à perdre ses moyens, à gamberger, à « déjouer ». L’une des réactions spontanément adoptées consiste à se mettre le plus possible à l’abri des situations stressantes. C’est une tendance qui se généralise. Ainsi, il n’étonne plus grand monde, aujourd’hui, de voir les plus grandes équipes de foot mondiales vivre recluses à l’abri du monde à l’occasion des grandes compétitions. Pour échapper à la « pression », dit-on, celle-là même que leurs joueurs déclarent, lors d’interviews calibrées, affectionner en compétition. D’autres s’y préparent, à l’inverse, en se plaçant dans des conditions pires que celles qu’ils vivent en compétition. Comme les cyclistes de l’équipe danoise de CSC, qui en tout début de saison, chaque année, participent à un stage commando, ou des descendeurs de l’équipe de France masculine de ski qui, à une époque, allaient passer une semaine au CNEC de Collioure au milieu des troupes d’élite et s’adonnaient aux parcours de combat. On voit donc se dégager deux tendances radicales, soit l’éradication maximale des situations fragilisantes, soit au contraire la mise en situation, dans un contexte supposé plus dur que celui qu’on s’attend à rencontrer en compétition. Comme une sorte de « vaccination » préalable au stress finalement. D’où cette question ? Vit-on plus heureux et devient-on plus fort dans un univers aseptisé de tensions, ou au contraire doit-on recherche leur confrontation pour s’aguerrir ?
Le débat est actuel. Ainsi, certains auteurs considèrent que l’absence de stimulus abaisse à un seuil anormalement bas la tolérance du sujet à toute forme ultérieure d’agression. La volonté de mettre le sujet à l’abri des situations de stress pourrait alors, selon eux, aboutir à une situation paradoxale, celle d’une vulnérabilité accrue aux émotions négatives.
Cette logique de protection maximale prévaut aussi dans le domaine de l’immunité. Si on établit un parallèle avec les émotions « stressantes », les microbes représentent une autre forme d’agression. Elle aussi déclenche une série de mécanismes adaptés : rougeur, chaleur, tuméfaction et douleur, que le cerveau perçoit, à l’égal de l’accélération du pouls, par exemple, qu’on relève en phase aigüe de stress. On se trouve donc, dans les deux cas, en état d’alerte vitale.
En 2006, l’existence de microbes dans notre environnement est un fait acquis et admis de tous. Même pour des enfants de maternelle pour qui ce concept est familier. Pourtant, avant 1870 et les travaux de Louis Pasteur (1822-1895), leur existence était ignorée de tous. La notion de « microbe », à l’échelle de l’histoire de l’humanité, est donc quasiment contemporaine ! Louis Pasteur découvrit plusieurs d’entre eux, en particulier le staphylocoque et le streptocoque, et consacra l’essentiel de son temps à se battre pour démontrer que divers microbes étaient responsables de la propagation des infections. Il défendit également l’idée selon laquelle il était indispensable de recourir à l’asepsie. Ce terme traduit la volonté d’éliminer tout agent bactérien de notre organisme. Cette éradication totale étant rapidement perçue comme impossible, Pasteur imagina d’y pallier avec l’invention des vaccins qui, rappelons-le, consistent à inoculer des microbes dont la virulence est atténuée, afin de donner le temps à l’organisme de développer des défenses optimales. Toujours est-il que l’œuvre de Pasteur a marqué durablement la pensée médicale. Aujourd’hui encore, l’émergence d’une infection, en particulier dans le cadre hospitalier, est vécue comme une erreur, voire une faute professionnelle, et la crainte des maladies nosocomiales aboutit à des mesures d’hygiène de plus en plus draconiennes. II suffit de commander un sandwich dans un hall de gare, ou de tenter d’expédier un camembert au lait cru à des cousins d’Amérique pour prendre la mesure de l’évolution de nos moeurs en matière d’hygiène alimentaire.
UNE APPROCHE DE TERRAIN :
Des pensées alternatives, y compris dans le monde médical, se sont cependant élevées en faux contre ce dogme de l’asepsie. Dans ce courant, on porte un regard plus large sur la question de l’infection. Comme dans le cas du stress, l’infection est présentée comme un combat entre l’agresseur et le défenseur. L’infection survient seulement lorsque l’agresseur prend le dessus. De la même manière qu’un événement stressant donné n’est pas vécu de la même manière par tout le monde, il existe une forte variabilité de la vulnérabilité aux infections d’un sujet à l’autre. Des faits étonnants nous sont parvenus à travers les siècles. Quand on se remémore les épidémies dévastatrices, comme avec la peste qui toucha la ville de Marseille au XVIII, on garde en tête les milliers ou millions de victimes causées par l’épidémie, et on oublie que, au mépris des dangers encourus, certains voyageurs traversèrent l’Europe, les quarantaines, les villes décimées, sans contracter la maladie. Plus proches de nous, les vagues de grippe laissent sur le flanc les plus faibles d’entre nous, et justifient la vaccination systématique des seniors. Or, à côté d’eux, des sujets alertes peuvent rester plusieurs années sans avoir la moindre idée de ce qu’est une poussée de fièvre.
Ces observations intrigantes ont tellement suscité la curiosité de certains acteurs de santé, qu’une philosophie radicalement différente a peu à peu émergé, plaçant la réponse du sujet (c’est-à-dire ses défenses) au cœur de la problématique. Une phrase résume parfaitement cette manière d’envisager la prévention des infections : « le microbe n’est rien, le terrain est tout ». Hérétiques ou iconoclastes, les tenants de cette approche comptent pourtant un allié de choix dans le monde scientifique en la personne de l’auteur de cette phrase : Louis Pasteur lui-même, qui l’exprima à la fin de sa vie, remettant finalement en cause le sens profond du travail effectué durant quarante ans. Un tel revirement, qui s’est progressivement dessiné, mérite d’être expliqué.
NECESSITE D’UN BRUIT DE FOND :
Depuis une quarantaine d’années, les statisticiens s’affolent devant l’envolée des cas de pathologies résultant de « dysfonctions immunitaires », c’est-à-dire de maladies où notre système immunitaire déclenche une réponse de défense alors même que n’existe pas d’agression microbienne. Il s’agit d’allergies, de la Maladie de Crohn ou de toutes les pathologies auto-immunes, dans lesquelles nos sentinelles attaquent par erreur des cellules du « soi » comme s’il s’agissait de corps étrangers, bactéries, virus ou champignons. Cette incidence accrue a laissé quelque temps le monde médical perplexe (*). Aujourd’hui, une explication se dessine, remettant en cause beaucoup d’idées reçues en matière d’immunité. On incrimine tout simplement l’asepsie !
(*) : « Le Point », 22/02/02, n° 1536, p 58.
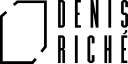
0 commentaires