La dysbiose au coeur du problème :
Beaucoup de publications récentes abordant en 2021 la question des pathologies psychiatriques font référence au terme de « dysbiose ». Celui-ci, employé pour la première fois il y a environ une dizaine d’années, concerne évidemment le « microbiote ». La « dysbiose », selon le consensus des experts, désigne «le déséquilibre quantitatif et qualitatif de l’écosystème bactérien, présent dans et sur le corps d’un organisme, notamment le corps humain, et plus particulièrement le microbiote intestinal humain ». Mais une fois ceci posé que faut-il comprendre ? Lorsqu’il est question de « dysbiose », la nature-même du problème rencontré reste floue, et la vision médicale actuelle serait de considérer qu’elle proviendrait de l’absence de certaines familles bactériennes ou d’un déséquilibre quantitatif se manifestant par des taux exagérément bas ou élevées de certaines lignées. A l’appui de cette manière de voir, notons que de nombreux travaux décrivent effectivement les différences relevées entre le microbiote de sujets sains et ceux, au contraire, de patients présentant un trouble ou une pathologie particulière. Plus largement, le manque de diversité de la flore intestinale revient dans beaucoup de conclusions, et ce dans un champ qui sort largement de celui de la psychiatrie ou de la neurologie. Mais que comprendre à tout cela ?
En fait, se référer à la dysbiose évoque un peu la situation suivante, celle d’une maman qui entrouvrant la porte de la chambre de son adolescent s’exclamerait en la refermant aussitôt : « quelle dysbiose là-dedans ! » sans oser s’aventurer au-delà du bazar sans nom qu’elle a entrevu et qu’elle ne veut même pas décrire. Derrière l’idée de déséquilibre à laquelle renvoie cette notion, on pourrait trouver de multiples anomalies. Or, au cœur de ce lien entre intestin et cerveau, un phénomène va jouer un rôle crucial : c’est celui de l’hyperperméabilité intestinale !
Un ėcosystème sans harmonie :
Grâce à l’émergence de nouvelles techniques apparues avec ce siècle, il a été possible de pousser l’analyse de la composition du microbiote. Sans surprise, il a été constaté de notables différences entre celle de personnes souffrant d’anorexie, et celle de sujets ne présentant pas ce trouble (2, 11). Ainsi, une variété particulière de bactérie prédomine dans l’intestin des premières. Il s’agit de Methanobrevibacter smithii. Celle-ci possède la capacité à optimiser la transformation des nutriments et à rendre le métabolisme très économe, de sorte que l’organisme s’adapte à des niveaux d’apports extrêmement bas et parvient à survivre avec des apports qui feraient mourir de faim la majorité des individus(1). La question qui se pose est toujours la même : Cause, conséquence ou ni l’un ni l’autre ? Des études menées plus récemment ont confirmé à la fois l’existence d’un manque de diversité du microbiote des anorexiques, et la présence de populations dominantes distinctes de celles du reste de la population (18). De surcroît, une tendance dépressive cohabiterait souvent avec ces troubles du comportement alimentaire, sans qu’il fût possible là non plus de trancher sur la nature du lien existant entre ces deux troubles. Gardons cependant à l’esprit que la synthèse de la sérotonine, molécule importante pour le contrôle du stress, et dont le déficit favorise la dépression, voit sa synthèse fortement altérée par les processus inflammatoires tels qu’on en rencontre souvent en cas de dysbiose chronique (5). Le lien observé n’a donc rien d’étonnant, mais ne nous éclaire pas davantage sur ce qu’il serait possible d’entreprendre pour ces patientes.
Ces différences de composition du microbiote se répercutent par ailleurs sur la teneur d’acides gras à chaîne courte, ces molécules volatiles élaborées par la flore intestinale à partir des fibres végétales. De sensibles différences existent, comparativement aux sujets de poids normal. Quand on sait que ces molécules possèdent l’aptitude à moduler la synthèse de peptides en jeu dans l’appétit, ce microbiote d’anorexique pourrait également contribuer, par ce biais, à l’altération de la faim. Mais ce n’est pas tout ; ces différences se manifestent à un autre niveau, encore plus déterminant, celui de la synthèse des neurotransmetteurs. A la grande surprise des scientifiques, des travaux récents ont permis de découvrir que le microbiote permettait de fabriquer plusieurs de ces messagers, notamment la sérotonine évoquée plus haut (21). La dysbiose de ces patientes se répercute sur la disponibilité de ces messagers, et le sommeil, l’humeur, l’appétit, tous en pâtissent. Un écosystème en harmonie module également la synthèse de la molécule chargée de contrôle l’anxiété, à savoir le GABA. A l’inverse, le désordre rencontré dans la flore de ces sujets favorise un état anxieux d’autant que, par ailleurs, le contrôle du stress apparaîtra moins efficace, ce qui contribuera à l’instauration d’un authentique cercle vicieux.
Pour résumer la relation entre la dysbiose et l’anorexie, il est aujourd’hui admis par les experts qui étudient la question que des désordres initiaux, peut-être transgénérationnels, favorisent la mise en place d’un métabolisme économe ce qui, en lien avec une fréquente constipation provoquée par cette dysbiose, renforce les déséquilibres du microbiote. Ceci aggrave les déséquilibres se jouant au niveau de la synthèse des neurotransmetteurs.
L’immunité intestinale est sans doute le facteur clef :
En dépit de leur caractère novateur et prometteur, ces différentes découvertes négligent complètement un point pourtant fondamental : c’est celui de l’intervention d’une autre catégorie d’opiacés, non pas les « endorphines » qu’élaborent nos neurones, et évoqués dans un paragraphe précédent, mais celle constituée d’éléments formés au cours de la dégradation partielle de certaines protéines, en l’occurrence la gliadine, constitutive du gluten, et une forme de caséine propre au lait des vaches Holstein (8, 14, 20). Leur ressemblance avec les premiers fait qu’on parle d’ « exorphines », dont les délits qu’ils provoqueraient vont bien au-delà du comportement alimentaire. Comment agissent-elles ? Elles possèdent l’aptitude à se lier aux récepteurs des opiacés « endogènes », en raison d’une forte analogie structurelle avec ceux-ci. Dès lors qu’elles se lient aux récepteurs cérébraux des opiacés, des réponses anarchiques surviennent, tantôt plus marquées que celle dûe aux endorphines (par exemple en ce qui concerne les addictions) tantôt par le biais d’actions opposées à celles de nos endorphines. On les incrimine ainsi dans le cas d’autres troubles, tels que la dyslexie, l’hyperactivité, la schizophrénie, les douleurs, voire les vertiges (21). Les plaintes peuvent être chroniques ou tenaces : Elles n’ont rien de lésionnel. Un point important est à souligner : C’est uniquement dans le contexte d’un phénomène d’hyperperméabilité intestinale chronique, favorisé par la « dysbiose », que ces interférences pourront survenir.
A ceci s’ajouterait un autre facteur, dont l’intervention nous paraîtra fort logique en regard d’une dysbiose quasi permanente chez les anorexiques : Il s’agit de profondes perturbations immunitaires, apparues sans doute dès la naissance. Comme on l’a vu plus haut, elles sont très souvent associées à un manque de diversité ultérieure du microbiote. Mais ce n’est pas ce manque de diversité qui constitue le problème. En effet, en lien avec cette dysbiose « transgénérationnelle », on relève l’existence d’une réaction du système immunitaire, dirigée initialement contre une bactérie. Manque de chance, une séquence protéique caractéristique de cette bactérie présente des analogies avec une molécule élaborée par notre organisme, ce qui occasionne la survenue d’une réaction croisée… Celle-ci s’exerce à l’encontre d’une hormone circulante, l’alpha-MSH qui, produite par l’hypothalamus stimule normalement la faim (9). En abolissant l’action de cette hormone, le système immunitaire contribuerait à pérenniser l’anorexie ! Cela permet de comprendre l’absence d’appétit chez les patientes anorexiques, en dépit de l’élévation compensatoire des messagers qui stimulent la faim, tels que la ghréline ou la leptine. Cela accentuerait également l’anxiété (23), et ce phénomène apparaîtrait principalement dans le contexte d’hyperperméabilité intestinale (6)… Or, les psychiatres notant la fréquente présence de troubles anxieux chez les anorexiques, se demandent régulièrement si ceux-ci précèdent celle-là ou si, au contraire, c’est l’inverse qui se passe. A la lumière de ces récents éléments, force est d’admettre qu’aucune des deux hypothèses n’est juste. C’est comme si on se demandait si c’est à cause du pare-brise cassé que le pare-choc est abîmé, ou si l’hypothèse inverse est la bonne… Anorexie et anxiété sont en fait deux conséquences d’une perturbation profonde de l’écosystème intestinal, en partie constituée en période fœtale puis durant les premiers mois de la vie..
A un degré moindre, cela pourrait également expliquer les comportements aberrants, de plus en plus souvent rencontrés, chez de jeunes enfants qui n’aiment aucun fruit, ni aucun légume, ou seulement ceux d’une forme particulière, ou encore rejettent tout poisson sauf celui qui est pané (« et en rectangle pas en carré si possible !»). Ces situations, plutôt que mettre en exergue la carence maternelle, semblent plutôt exprimer les profondes altérations affectant le « logiciel » du comportement alimentaire (16). Cela, en général, n’a rien à voir avec un problème éducatif ni un quelconque souci affectif, comme on tend trop souvent à l’avancer. Et ces troubles ne relèvent surtout en rien d’un traitement psychanalytique, n’en déplaise aux élèves de feu Hilda Bruch !
Sur ce sujet, l’avenir nous apportera sans doute des thérapies à base de probiotiques, ou plus précisément de « psychobiotiques » (21). S’agit-il d’une idée saugrenue ? Loin de là ; dès 1984, dans la revue « La Recherche », Pierre Raibaud et Robert Ducluzeau, agronomes et chercheurs, avançaient un point de vue avant-gardiste dans un article intitulé : « les bactéries du tube digestif ». « Demain, écrivaient-ils, on pourra sans doute disposer d’une nouvelle génération de médicaments à base d’extraits de microbes. Ils pourront prendre le relais des antibiotiques, mais offriront certainement d’autres perspectives en regard de la diversité de cellules présentes dans l’intestin, qu’il s’agisse des neurones ou des cellules endocrines ». Chiche ?
Encadré 1 : l’anorexie, une maladie vieille de trois siècles.
Comme le décrit la psychiatre Hilda Bruch dans l’ouvrage de référence des années 70 « Les yeux et le ventre », l’anorexie mentale est revenue une entité clinique sur la base des comptes-rendus que firent, sans s’être concertés, Gull en Angleterre (12), dans un papier paru en 1874 dans « The Lancet », et Lasèque en France en 1873 (17). Elle entrait dans la grande famille des « hystéries ». Mais comme l’écrivait Hilda Bruch en des termes qui en disent long sur l’imprégnation de la pensée médicale par la psychanalyse au coeur du XXème siècle : « on peut cependant trouver des références occasionnelles à ce type d’inanition auto-infligée dans une littérature antérieure. » Ainsi Richard Morton, dont l’ouvrage « Phtisiologia, or a treatrise of consumption » a été publié à Londres en 1689, passe pour être l’auteur du premier document relatif à l’anorexie médicale de toute la littérature médicale (19). C’est Gull qui inventa le terme « anorexia nervosa », et c’est sous ce nom qu’on s’y réfère dans les pays de langue anglaise, en Allemagne et en Russie.
Concernant le poids et l’alimentation, l’anorexie a également intrigué les endocrinologues. Dès la fin du XIXème siècle, l’hypothèse d’un dérèglement hypophysaire avait été envisagée. Il aurait corroboré l’idée dominante de l’époque : un dysfonctionnement du métabolisme qui, devenu très économe, ne pouvait que rarement contribuer à la survenue de la faim. Cette piste s’inscrivait logiquement dans le contexte des connaissances du moment. Plus tard, au cœur des années 70, le regard s’est focalisé sur les estrogènes, la progestérone ou encore la LHRH, messager hypothalamique qui commande la sécrétion de l’hormone de croissance (3, 11). Les acteurs considérés avaient évolué, mais le concept était demeuré le même : l’anorexie résulterait d’un dysfonctionnement hormonale. Sans grand succès là non plus. La recherche d’anomalies portant sur d’autres messagers a ouvert de plus intéressantes perspectives. Ainsi, des données plus récentes indiquent-elles l’existence de taux plus élevés de neuropeptide Y (molécule impliquée dans le rassasiement) ou encore de ghréline, hormone en provenance de l’estomac, et qui a comme propriété de stimuler l’appétit. Mais pourquoi ? Ces données, purement descriptives, ne permettent pas de le savoir… Toujours est-il que ces anomalies auraient comme conséquence d’associer les circuits de la récompense (évoqués dans cet article) et la maigreur. Inversement, une chute des taux d’ocytocine, de leptine et de quelques autres peptides, qu’on a simultanément relevés, contribuerait à une persistance anormale de la satiété chez ces patientes (24). N’y avait-il aucune autre manière de se représenter cette pathologie ? Si. A la fin du XIXe, Lasègue a posé un regard plus global sur cette pathologie. Bien que le vocabulaire auquel il fit appel se trouvât largement emprunté au monde psychiatrique, il fut le premier à évoquer de possibles perturbations de la sphère digestive, en relation avec cette pathologie. Ainsi considérait-il les symptômes de départ comme un « dérèglement hystérique au niveau de la sphère digestive ». Il aura fallu 140 ans pour reparler de cette partie du corps, mais selon un concept radicalement différent.
Encadré 2 : L’anorexie selon le « DSM » :
Selon le consensus des psychiatres tel qu’il apparaît dans le « DSM 5 », cette maladie se définit selon six critères, décrits ci-dessous :
- Un refus, une peur de maintenir ou d’atteindre un poids minimum normal pour l’âge et la taille.
- Une perte de poids de plus de 15% avec un poids inférieur, chez l’adulte, à un IMC de 18,5 kg/m², ou chez l’adolescent inférieur au 10e percentile.
- Une peur intense de devenir obèse ou trop gras, alors même que l’IMC se situe sous la norme.
- Une perturbation de l’image corporelle et un excès d’influence du poids sur l’estime de soi.
- Un déni de la gravité de l’état nutritionnel
- Une aménorrhée de plus de trois mois.
- Certains des critères exposés, par leur caractère chiffré, semblent donner une base rationnelle et clinique à cette pathologie. Mais notons que des expressions telles que « peur intense » ou « excès d’influence », introduisent une part de subjectivité dans l’appréciation du thérapeute, qui possède lui-même sa propre histoire et son rapport au poids et à l’alimentation, et ne décrit nullement les facteurs qui contribuent à la présence de ce profil mental particulier chez les malades.
BIBLIOGRAPHIE
- Armougom F & Coll (2009) : PlosOne, 4 (9) : e7125.
- Borgo F & Coll (2017) : PlosOne, 12 (6).
- Boyar R & Coll (1974) : N.Eng.J.Med., 291 : 861-5.
- Bruch H (1978) :” Les yeux et le ventre”. Payot Ed.
- Capuron L & Coll (2011) : Pharmacol.Therap., 130 (2) : 226-38.
- Coquerel O & Coll (2012) : Psychoneuroendocrinology, 34 : 413-9.
- Cowdrey FA & Coll (2011) : Biol.Psychiatry, 70 : 736-43.
- Dubynin VA & Coll (1998) : Bull.Biol.Med.Exp., 125 (2) : 153-7.
- Fettissov SO & Coll (2008) : Nutrition, 24 : 348-59.
- Foppiani (1998) : Eat.Weight Disorders, 3 (2) : 90-4.
- Gorwood P & Coll (2016) : Front.Neurosci., 00256.
- Gull WW (1888) : The Lancet, 1 : 516-7.
- He Z & Coll (2010) : J.NeuroImmun., 15 (298) : 153-9.
- Kaminski S & Coll (2007) : J.Appl.Gen., 48 (3) : 189-98.
- Kaye WH & Coll (1982) : Am.J.Psych., 139 : 643-5.
- Kottler LA & Coll (2001) : J.Am.Acad.Child.Adoles.Psych., 40 : 1434-40.
- Lasèque C (1873) : Med.Times and Gaz., 2 : 265-6.
- Morita C & Coll (2012) : PlosOne, 10 (12).
- Morton R (1689) : “Phtisiologica or a treatise of consumptions.”
- Reichelt K & Coll (2012) : Microb.Ecol.Health Dis., 23.
- Riché (2021) : “Comment le microbiote gouverne notre cerveau”, De Boeck Ed.
- Rigaud D, Brindisi MC & Coll (2011) : Troubles du comportement alimentaire ». in : Nutrition clinique pratique », Elsevier Masson.
- Sinno MH & Coll (2009) : Psychoneuroendocrin., 34 : 140-9.
- Tortorella A & Coll (2014) : Eur.Eat.Disorder Rev., 22 : 307-20.
- Wang K & Coll (2011) : Mol.Psychiatr., 16 : 949-59.
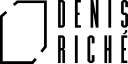
0 commentaires