L’anorexie est-elle une maladie digestive ? Première partie
Bien que décrite depuis 1689 (19), cette pathologie qui se caractérise par le refus de s’alimenter, recèle encore une grande part de mystère. Pourquoi survient-elle ? Des générations de psychiatres se sont épuisées à trouver en vain la cause de cette pathologie. De récentes avancées, en lien avec notre microbiote, pourraient apporter une réponse tout à fait surprenante à cette énigme.
L’impasse de la psychiatrie:
Si l’on procédait à un sondage auprès d’un échantillon représentatif de professionnels de la santé, nul doute qu’une immense majorité des personnes interrogées rangerait l’anorexie parmi les maladies psychiatriques. Elle est d’ailleurs parfaitement caractérisée par le « DSM 5 », (« Diagnostic and statistical manual of mental disorders », que l’on pourrait traduire par « Manuel diagnostic et statistique des désordres mentaux »). Rappelons qu’il s’agit du registre présentant la classification des maladies mentales, élaboré sous l’égide de l’Association des psychiatres américains (A.P.A.). Attardons-nous sur ce « DSM » ; un terme semble incongru lorsqu’il s’agit d’aborder le terrain de la psychiatrie : c’est celui de « statistique ». Que vient-il faire là ? Concrètement, la caractérisation des pathologies qu’il évoque, repose sur la « « sémiologie », c’est-à-dire l’ensemble des signes qui se retrouvent simultanément au sein d’un groupe de patients. Dans leur grande majorité, ils présentent le même tableau, qui va dès lors constituer une maladie à part entière. Cette manière de voir les choses est-elle cohérente ? Pas si sûr ; elle s’apparente à la situation suivante. Imaginons plusieurs véhicules accidentés, qui seraient supervisés par un expert. Celui-ci trouvera « statistiquement », qu’un grand nombre d’entre eux ont un pare-brise qui a volé en éclat, un pare-choc enfoncé, une portière rayée, et que l’airbag est sorti de son compartiment. L’ensemble de ces éléments, communs à la plupart des véhicules, permet de poser le diagnostic d’accident. Mais pourquoi le conducteur est-il sorti de la route, et risque-t-il que cela se reproduise ? Il n’est pas en mesure d’y répondre, tout expert qu’il est…
L’approche qui repose sur l’outil statistique pour caractériser une pathologie présente le même écueil. Revenons à l’anorexie pour mieux le comprendre ; dans l’ouvrage « Nutrition clinique pratique », Daniel Rigaud et ses collègues (22) décrivent comment le consensus du monde de la psychiatrie la définit (voir l’encadré 2). Ils exposent également les données épidémiologiques qui s’y rapportent. Mais d’où vient-elle ? Pas une ligne à ce sujet. Dans un autre domaine, la psychiatre Hilda Bruch, dans son ouvrage de référence « Les yeux et le ventre », paru en 1978 (4), l’aborde davantage sous l’angle psychanalytique. Les hypothèses en lien avec des dynamiques familiales toxiques et la place des événements traumatisants s’y trouvent abondamment développées, ouvrant une voie royale vers un accompagnement accordant une large place aux entretiens sur le divan. En dépit de ce vernis rationnel les résultats, aujourd’hui encore, ne garantissent pas plus de 50% de succès (10). Et encore convient-il de savoir sur quels critères on considère la guérison acquise. En effet, le plus souvent, ceux pris en compte sont une reprise de poids ou le retour des règles, en accord avec les éléments figurant sur le DSM 5 (voir l’encadré 2). Cela suffit-il à considérer que la patiente est guérie ? Peut-on garantir qu’à l’occasion d’un nouvel événement traumatisant le problème ne reviendra pas ?
En quelque sorte, en partant des conséquences, sans remonter jusqu’à la cause, on table sur l’atténuation des symptômes pour guérir la pathologie. Ainsi, les anxiolytiques seraient le nouveau pare-brise, et les anti-dépresseurs pourraient s’apparenter au pare-choc neuf. Du fait que ces réparations ne préviennent en rien de nouvelles sorties de route, et qu’à chaque fois les mêmes dégâts se reproduisent, on en vient à placer des pare-brise blindés et des pare-chocs incassables. L’analogie s’impose avec tous ces cas où on cumule les médicaments, faute d’en voir un seul calmer les troubles, et où on monte les doses pour apaiser le patient, tout en lui expliquant qu’il ne faudra jamais qu’il arrête d’en prendre sous peine de rechuter. Effectivement, les faits donnent raison aux thérapeutes : Si les traitements effacent temporairement les symptômes, dès qu’on réduit les doses en période d’embellie, les facteurs à l’origine de la sortie de route s’expriment de plus belle. Et on en revient toujours au même point : Pourquoi devient-on anorexique ?
« Tu as un gros cul, c’est pour cela que tu ne cours pas vite ! »
D’après la vision « classique » de la psychiatrie, il existe des facteurs favorisants, qui semblent mettre le feu aux poudres. Ainsi, dans le domaine qui nous intéresse, beaucoup de jeunes athlètes racontent être devenues anorexiques à la suite d’une remarque pas très avenante à propos de leur poids. Ceci justifie que la psychothérapie vise à favoriser une forme de « résilience » par rapport à ces faits déclencheurs. Cela vous paraît logique ? Alors regardons-y de plus près. Imaginons qu’un entraîneur un peu sexiste et mal embouché ait la mauvaise manie d’invectiver les coureuses de son équipe de cross, qu’il ne trouve jamais assez légères. S’il balance cette phrase délicate à dix de ses athlètes, que peut-on s’attendre à observer ? Trois d’entre elles lui répondront sur le même ton ou hausseront les épaules. Deux iront chercher leur père qui fera les gros bras devant le coach soudain silencieux ; deux autres feront un peu plus attention à leur alimentation pendant quelques semaines, alors qu’une paire d’athlète ira balancer sur les réseaux sociaux tout le bien qu’elles en pensent. Enfin, l’une d’elles deviendra anorexique, et adoptera une alimentation exagérément restrictive, allant bien au-delà des ajustements alimentaires habituellement proposés pour retrouver une ligne d’athlète. Ce n’est donc ni le régime ni la brimade qui expliquent l’anorexie. Pas plus que ce serait l’alcool ou les soucis qui rendraient alcooliques. La question de la vulnérabilité individuelle, finalement, reste entière, et se trouve occultée dès lors qu’on s’intéresse à l’anorexie par le prisme de l’épidémiologie. Et où se trouve cette vulnérabilité ? Cela n’est jamais expliqué. C’est au moment où l’énigme semblait devoir rester irrésolue qu’un joker est sorti de la manche : le microbiote !
Pour te récompenser, tu n’auras rien !
L’une des voies les plus abondamment explorées ces dernières années est celle d’anomalies qui toucheraient les circuits de la récompense, circuit neuronal particulier qui provoque une sensation gratifiante, telle qu’elle survient après un bon repas, une nuit d’amour, une sortie de sport, ou une combinaison de ces options. Or, l’imagerie cérébrale a permis de confirmer, chez des femmes souffrant d’anorexie, que l’activité de ces voies était altérée. Tout se passe comme si la privation procurait du plaisir, là où, normalement, ce sont les aliments qui procurent cette sensation ! Au cœur de ce phénomène, on retrouve des messagers fabriqués au cœur de nos neurones, et qui présentent une forte analogie avec les opiacés. Parmi ces messagers « endogènes » figure notamment la famille des « endorphines », que les sportifs connaissent bien, pour en libérer en cours d’activité et dans les heures qui y font suite, et qui leur procurent alors un état de bien-être. Il semble, dans le contexte de l’anorexie, que ces endorphines puissent favoriser cette forme d’addiction à l’abstinence.
Ces anomalies touchant le circuit de la récompense se manifestent également dans le cadre de l’activité physique, pratiquée à l’excès chez près de 80% des anorexiques (21). Comment le comprendre ? Au début de ce siècle, au summum des travaux consacrés à la thérapie génique et au séquençage du génome humain, un grand nombre d’études furent consacrées à la recherche de gènes qui pourraient être associés à un risque accru de développer l’anorexie nerveuse. Un candidat a focalisé l’attention des chercheurs. C’est celui de la calcineurine (il s’agit d’une protéine qui contribue à lier le calcium à certains éléments du neurone). Quelles particularités présente donc ce gène? Il contribue à la fois à une plus grande capacité à l’effort et à une meilleure tolérance à celui-ci (13). Autrement dit, ce serait la même prédisposition qui favoriserait à la fois ce trouble du comportement alimentaire et la débauche d’énergie qui l’accompagne et qui, évidemment, contribue à renforcer le contrôle de la maigreur. Ceci conduira à une chronicité de la pathologie.
La génétique a également montré une autre particularité : une expression plus importante de gènes codant pour les récepteurs de la dopamine et surtout ceux des opiacés (25), ce qui donne un support biologique à ces anomalies touchant le circuit de la récompense. Pour résumer cette piste, l’anorexie nerveuse résulterait d’une dysrégulation de l’équilibre entre les entrées (régies par la faim) et les sorties (avec un excès d’exercice). Cela résulterait de perturbations épigénétiques touchant les gènes en lien avec les neurones dopaminergiques. Ceci modulerait à la fois les circuits de la récompense et ceux de la faim, créant une authentique dépendance au jeûne.
(*) : En 1982 Kaye : a montré que l’activité opioïde mesurée dans le liquide cérébro-spinal de sujets anorexiques, affectées d’un poids insuffisant, se situait largement au dessus de celle relevée chez des sujets exempt de pathologies. Cela correspond-il à un bien-être majeur associé à l’abstinence d’apports alimentaires ? C’est vraisemblable. Mais surtout, les endorphines possèdent une propriété peu connue ; elles s’avèrent très utiles dans un contexte de survie, dans la mesure où elles abaissent le métabolisme et permettent de préserver l’eau et les nutriments dans l’organisme dans des conditions délicates telles que celles où les apports sont fortement réduits (15).
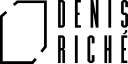
0 commentaires