Micropénis, ambiguïtés sexuelles, puberté précoce, les malformations et anomalies génitales semblent être de plus en plus nombreuses chez les enfants. On incrimine certaines molécules, entrées dans notre organisme, et susceptibles d’interagir avec les récepteurs des œstrogènes. Qu’en est-il de cette affaire ?
UNE HISTOIRE BANALE AU DÉPART :
Ambre a 18 mois. Née au début de ce siècle dans le sud de la France, elle grandit harmonieusement, entourée de l’amour des siens. Issue d’une famille comportant, comme de plus en plus souvent aujourd’hui, des sujets allergiques, elle a longtemps été allaitée, avant de passer au lait maternisé qui, dès les premières goulées, lui a occasionné des maux de ventre, des régurgitations et des problèmes cutanés. Sur les conseils du pédiatre qui la suivait, les parents décidèrent, vers ses 6 mois, de remplacer ce premier lait par une variante à base de soja. Les biberons passèrent à nouveau sans mal, les glouglous intempestifs que faisait entendre son petit ventre dès qu’elle avalait du lait de vache se turent, et la diversification alimentaire commença en douceur. Tout allait bien, sauf… sauf ce petit détail qui, commença simplement par intriguer un peu sa mère puis finit, au fil des semaines, par inquiéter réellement ses parents. De quoi s’agissait-il ? De l’apparition de petites protubérances mammaires, d’abord discrètes, mais qui s’affirmaient un peu plus de jour en jour, au point de les inciter à aller consulter à nouveau le pédiatre. Spécialement pour cela. Lui aussi troublé, il conseilla à la famille de prendre rendez-vous avec le professeur Charles Sultan à Montpellier, chef du Service d’endocrinologie pédiatrique du CHU Arnaud de Villeneuve. L’homme, affable et très patient, est réputé, bien au-delà les limites du Languedoc, voire de l’Hexagone, pour son travail sur les dérèglements hormonaux. Il les reçut gentiment et commença un méticuleux interrogatoire.
Au début, on évoluait en terrain connu. « Votre fille a-t-elle consommé du lait de soja ? Quelle quantité boit-elle par jour, approximativement, et depuis quand ? » Ses parents, qui lisaient beaucoup et ne manquaient pas de s’informer sur internet ont tout de suite compris que l’homme grisonnant à l’accent chantant qui s’adressait à eux cherchait à déterminer le niveau d’exposition à certains dérivés de soja. Et leurs réponses, confirmant un recours régulier à cette plante, leur laissaient la désagréable impression d’avoir peut-être provoqué une possible anomalie, à l’origine de leur venue à Montpellier en ce froid jeudi de mars. Ils étaient loin du compte…
UNE SERRURE QU’OUVRENT PLEIN DE CLÉS :
Pour comprendre la suite de l’histoire, il est nécessaire de faire un petit détour par de la physiologie simple, celle concernant la réponse hormonale. En effet, pour régler et ajuster le niveau de fonctionnement de certains tissus, notre corps dispose de molécules « messagers » de différentes natures. Les plus connues sont les hormones qui sont libérées dans le sang à partir d’une glande en réponse à un stimulus. Elles gagnent alors le sang, mais pour exercer leurs effets physiologiques, elles doivent ensuite se lier à un récepteur, comme une clef ouvre une serrure. Cette image de la clef et de la serrure est souvent employée en cours d’endocrinologie, pour insister sur le caractère très spécifique et unique de cette liaison. On ajoute souvent que, toutefois, cette unicité de la liaison entre l’hormone et son récepteur n’est pas si parfaite que cela. Il arrive que des molécules, structurellement assez proches de l’hormone, puissent aussi interagir avec le récepteur, avec plus ou moins d’efficacité. On peut alors les comparer à des passe-partout. De tels « agonistes » (comme disent les pharmacologues lorsqu’ils désignent ces presque « sosies » qui en copient les effets, ou « antagonistes » dans le cas contraire) existent pour un grand nombre de constituants. Notamment les œstrogènes. Certains des agonistes des œstrogènes sont aujourd’hui très connus. Il s’agit de ce qu’on appelle les « phytoestrogènes ». Par définition, il s’agit de molécules extraites des végétaux dotées de propriétés synergiques ou antagonistes des œstrogènes « endogènes ». Les phytoestrogènes regroupent différentes classes de molécules répondant au nom plus large de « polyphénols » :
- les isoflavones (identifiées dans les légumineuses et notamment le soja) dont les principales molécules sont la génistéine, la daidzéine et son métabolite actif l’équol. Ce sont à la fois les plus actives et les plus connues.
- les lignanes qui, bien que concentrées dans la graine de lin et de sésame, sont relativement ubiquitaires dans les céréales, les fruits et les légumes (les principaux sont le sécoïsolaricirésinol, le maltaïrésinol et leurs métabolites, l’entérodiol et l’entérolactone).
- les coumestanes (coumestrol) qui, majoritairement retrouvés dans les fromages, ne représentent que peu d’intérêt en nutrition humaine (*).
(*) :Pour les puristes ou les amateurs de chimie, on doit préciser que c’est en raison de la présence d’un noyau phénolique et de groupements hydroxyles, dans une position stéréochimique analogue à celle 17b-estradiol, qu’ils possèdent la capacité de se fixer sur les récepteurs œstrogéniques.
UN MÉTABOLISME COMPLIQUÉ :
Deux autres caractéristiques viennent compliquer l’analyse, en particulier lorsque on tente d’établir un niveau d’exposition et de caractériser des effets physiologiques dus à ces molécules. D’une part, d’une isoflavone à l’autre, il existe de nettes différences de métabolisme. Elles peuvent contribuer à des variations d’exposition des consommateurs, selon le type de soja consommé. Cette variété se retrouvera au niveau des effets physiologiques. Il semblerait de plus que la flore intestinale joue un rôle prépondérant dans le métabolisme des isoflavones puisqu’elle est responsable de la production d’équol pour lequel la combinaison d’une meilleure action œstrogénique, d’un pouvoir antioxydant accru et d’une demie-vie plus longue que celle de son précurseur (daidzéine) laisse présumer d’effets biologiques supérieurs à ceux de tous les autres dérivés du soja.
D’autre part, il existe plusieurs formes de récepteurs aux œstrogènes, certains activant, d’autres au contraire freinant, l’effet attendu de ces hormones. En règle générale, les concentrations plasmatiques en phytoestrogènes sont très supérieures aux taux circulants d’estradiol (10 à 500 pg/ml suivant le statut physiologique), puisqu’elles varient de 10 ng/ml chez les non consommateurs de soja à 600 ng/ml chez les Japonais. En revanche, comparativement à l’hormone endogène, les isoflavones présentent une moindre affinité pour le récepteur œstrogène. Autrement dit, la clef ouvre moins bien la porte. Cet écart s’exprime par un facteur de 100 à 1000 pour l’isoforme a et de 10 à 100 pour b. Les tissus exprimant majoritairement le récepteur a, tels que la glande mammaire ou l’utérus, seront donc plus sensibles à l’estradiol, les organes à dominance b (squelette) étant plus réceptifs aux phytoestrogènes, d’où leur action aujourd’hui reconnue sur la prévention de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées. A l’inverse, bien que les récepteurs aux œstrogènes soient environ 100 à 1000 fois moins exprimés dans les organes périphériques, les deux types (a et b) ont été décelés au niveau osseux, que ce soit sur les ostéoblastes ou sur les ostéoclastes.
Il est évident qu’en fonction des caractéristiques de notre alimentation, nous allons consommer en quantité variable ces différentes familles de molécules. On sait ainsi que, de par leur abondante ingestion de dérivés du soja, les Asiatiques avalent quotidiennement de 50 à 100 mg d’isoflavones. En revanche, dans les pays occidentaux, la consommation est très réduite. Les différentes molécules sont modifiées ou transformées après être entrées dans notre organisme. A la sortie, déduire de la seule composition des aliments leur impact possible sur notre corps et l’effet « ostrogène-like » qui s’ensuit est assez illusoire. C’est pourquoi, en dépit des efforts de caractérisation qui ont été menés (voir le tableau), mieux vaut mesurer directement les taux des différents dérivés dans le sang ou les urines.
BIENVENUE CHEZ SUZI WAN :
Voyons néanmoins les chiffres de consommation dont on dispose : Il est admis que les adultes Occidentaux consomment environ 5 mg d’isoflavones par jour (1). L’exposition des nouveaux-nés et des nourrissons aux phytoestrogènes dépasse nettement celle de leurs parents, puisqu’elle se situerait entre 32 et 47 mg/j. La consommation des Asiatiques est estimée quant à elle entre 50 et 100 mg/jour. Globalement, une alimentation asiatique traditionnelle riche en soja peut comporter de 50 à 60 fois plus d’isoflavones qu’une ration occidentale typique. Or, des études épidémiologiques ont montré une moindre incidence des cancers du sein en Chine et au Japon. Ainsi, selon certains auteurs, le risque de cancer du sein serait 5 à 8 fois moindre chez les Japonaises que chez les Européennes (1). Les études prospectives, pour leur part, montrent globalement un effet protecteur contre le risque de cancer du sein, même si une étude menée sur 29 femmes consommant 45 mg d’isoflavones par jour pendant 14 jours a montré une augmentation de la prolifération de cellules épithéliales mammaires. Une autre a ajouté au trouble : Conduite sur 24 femmes ayant consommé 38 mg de génistéine pendant 6 mois, elle a montré une augmentation de la fréquence de cellules hyperplasiques mammaires (1).
Cette chimie très complexe rend sans doute très difficile l’émission d’un avis tranché sur l’innocuité du soja, et justifie la position prudente de l’AFSSA à ce sujet. Pour elle, le risque de cancer reste débattu, et justifierait une relative prudence vis-à-vis du soja lors de la grossesse (*). Par contre, la possibilité que l’exposition aux phytoestrogènes puisse contribuer aux malformations sexuelles n’est pas envisagée par les experts…
(*) : Tous les praticiens ne partagent pas cet avis, loin s’en faut. Actuellement, 2% des enfants sont nourris au lait de soja, à en croire les chiffres avancés dans le « Généraliste » du 22 juin dernier. Ce chiffre ne choque pas le pédiatre Lionel Rossant, bien au contraire. Selon lui, la position de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) serait discutable. « Les préparations infantiles à base de soja utilisées depuis des siècles en Asie et plus de 40 ans aux Etats-Unis, par des millions de nourrissons n’ont eu aucune conséquence particulière sur leur croissance et leur développement endocrinien. » Il ajoute que « les taux en phytoestrogènes sont suffisamment bas pour ne pas poser de problème ».






UNE SUITE ÉTONNANTE :
Le Professeur Sultan proposa logiquement aux parents d’Ambre de procéder à un bilan sanguin et urinaire permettant de mesurer les taux de génistéine, de daidzéine et d’equol, ces molécules aux noms barbares dérivant de la transformation des phyto-oestrogènes de soja par notre organisme (1). « Je ne pense pas que le lait de soja soit en cause », lâcha-t-il pourtant. Ce qui n’eut pas le don de rassurer les parents. Mais ils n’eurent pas le temps de réfléchir davantage, car l’entretien se poursuivit immédiatement, prenant une tournure inattendue. « Etes-vous agriculteurs, ou avez-vous de la famille dans ce métier ? » attaqua-t-il. Malgré la réponse négative des deux parents, il poursuivit : « Vivez-vous ou avez-vous vécu à proximité d’une vigne ou d’un champ ? Buvez-vous de l’eau en bouteille ? Lavez-vous vos fruits et légumes avant de les manger ? » Non ils ne vivaient pas à côté de vignes. Mais oui l’eau en bouteille faisait partie de leur quotidien alimentaire. La précision de l’entretien suscita une interrogation légitime. En quoi la proximité des vignes pouvait-elle jouer un rôle si défavorable ?
Depuis la fin de l’année 2002, l’équipe du Pr Sultan s’est étonnée de la fréquence élevée de malformations et anomalies génitales observées chez les petits garçons dans leur consultation. Selon le responsable de ce service, la responsabilité en incomberait aux polluants environnementaux et, notamment, aux pesticides épandus sur les cultures. Douze mois plus tard, les chiffres lui donnaient déjà raison. En l’absence de registres nationaux, seules les statistiques recueillies dans le cadre de sa consultation viennent alimenter le débat. Diverses malformations génitales infantiles étaient répertoriées : testicules non descendus dans les bourses (cryptorchidie), malformation de l’urètre dont l’orifice s’ouvre plus ou moins loin du gland (hypospadias), micropénis, ambiguïtés sexuelles. Dans certains cas extrêmes, le sexe de l’enfant n’a pas pu être déterminé à la naissance ! L’un des membres de son équipe, le Dr Claire Jeandel, endocrinopédiatre, a ainsi examiné les 995 enfants de sexe masculin nés entre janvier 2002 et janvier 2003. Les résultats sont inquiétants : « Nous avons enregistré, note-t-elle, un taux anormalement élevé de malformations génitales, avec 25 cas ce qui, avec une fréquence de 25 pour mille, correspond à dix fois plus que ce que nous attendions. » Les questionnaires utilisés au sein du service ont permis de constater que, sur les 25 bébés touchés, 8 touchaient des enfants d’agriculteurs ou vivant dans un environnement pollué. « En comparaison des 50 cas contrôles, reprend le professeur, nous avons trouvé que les enfants nés de parents dans un environnement exposé aux pesticides, fongicides ou herbicides ont 4 fois plus de risque de malformations génitales ».
LE POISON PANÉ :
De nombreuses substances peuvent potentiellement être impliquées. Elles peuvent exercer à la fois des effets estrogéniques et anti-androgéniques. Ainsi, les ambiguïtés sexuelles constatées chez le garçon seraient surtout à mettre sur le compte d’une action anti-androgénique de certains polluants, effets s’exerçant au cours de la grossesse. En conséquence, le garçon est insuffisamment virilisé. Mais les effets néfastes ne s’arrêtent pas là ; chez les filles, ils peuvent se manifester par des pubertés précoces, probablement liées à l’ingestion de substances dotées d’un effet « estrogen-like », comme disent les physiologistes. Un travail récent a mesuré les taux des différents produits chimiques connus pour posséder de telles actions, ainsi que leur fréquence au sein d’un échantillon de sujets dont on avait prélevé un échantillon de tissu adipeux (2). Ces molécules tendent en effet à s’accumuler dans le pannicule gras, ce qui peut contribuer à leur libération brutale a décours d’un régime provoquant une perte de poids trop brusque. Ces auteurs ont également noté que les taux mesurés dans le lait sont plus élevés, en raison de sa richesse en graisses, ce qui permet de solubiliser ces toxiques. Un autre travail, ayant fait appel à 458 volontaires, a montré que chez 75% dans d’entre le tissu adipeux renfermait divers pesticides dotés d’effets hormonaux, et ce à des taux non négligeables.
Un récent travail a confirmé cette fâcheuse tendance ; un groupe de chercheurs de l’Institut de Chimie Ecologique de Neuherberg a mesuré le taux de divers contaminants dans le placenta et dans le lait maternel de volontaires danoises et finlandaises (6). L’équipe du professeur Karl Schramm a relevé des valeurs record pour le DDE (dérivé de pesticide), mais elle a aussi confirmé la présence anormalement importante d’hexachlorobenzène, d’endosulfane, de diesdrine et de DDT. Les concentrations dans le lait sont corrélées à celles mesurées dans le placenta.
L’espèce humaine n’est pas la seule à pâtir de cette contamination. Elle touche en fait toute la chaîne alimentaire, à commencer par les poissons, directement au contact de cours d’eau ou de lacs ayant été pollués. Certaines espèces piscicoles s’avèrent d’ailleurs tellement fragiles qu’au lieu de les manger on s’en sert pour doser et étudier les effets des toxiques. C’est le cas des saumons de Norvège, dont l’élevage est voué, dans un travail à caractère très européen, à des objectifs un peu particuliers. L’intérêt des scientifiques penchés à leur chevet a porté plus particulièrement sur le « nonylphenol », un xenoestrogène capable de faire varier, dans le cerveau de ces poissons, l’expression de protéines très spéciales (4) : Celles capables de régler la production d’estrogènes, ainsi que le niveau d’activité d’un système de détoxication de la famille des cytochromes P450 (voir « Sport & Vie » n°). Des lots de poissons furent constitués, soumis soit à aucune molécule toxique, soit à des doses croissantes de ce xénoestrogène (de 5 à 50 ng/l- ce qui constitue des taux très faibles-). Les taux des enzymes furent déterminés après 3 et 7 jours d’exposition. Il ressort de ces investigations que l’expression des gènes qui codent pour ces protéines est significativement modifié sous l’effet du polluant, et que cela se traduit par une anomalie de la synthèse des stéroïdes chez ces poissons. D’où deux conclusions à ces résultats : la première consiste à proposer l’emploi à plus vaste échelle des salmonidés pour mesurer la pollution des cours d’eau. La rédaction de « Sport & Vie » veut bien contribuer à ce travail en récupérant les lots d’animaux « contrôle », surtout en cette période de l’année. L’autre conclusion, c’est que, selon les auteurs de cette étude : « les fortes concentrations relevées dans les cours d’eau et les surfaces aquatiques de l’Hémisphère Nord, font de ce risque de pollution pharmacologique un plus sérieux problème, en terme de risque pour l’Homme et les espèces animales, que ce qu’on pensait jusque alors ».
Shen et ses collègues (6) suggèrent en outre que, bien avant l’émergence de l’ère industrielle de l’agriculture, de semblables anomalies, certes moins fréquentes, pouvaient déjà s’observer. L’explication à ces faits troublants leur a été fournie lors de leurs analyses systématiques. C’est la faute à des « mycotoxines », c’est-à-dire à des molécules élaborées par des moisissures se développant sur des plantes comestibles. A l’inverse de la toxine botulinique, tristement célèbre, ces composés ne sont pas immédiatement toxiques ni mortels. Mais ils présentent, eux aussi, une analogie avec les estrogènes qui leur permet de se lier aux récepteurs hormonaux et de brouiller les signaux. De tels cas ont notamment été abondamment décrits en Chine.





LE RAT EST TRÈS SAIN…
L’une des conséquences possibles d’un effet hormonal de ces molécules serait d’apprécier, sur le plan anatomique, les modifications des glandes ou attributs sexuels. Opération difficile chez le saumon ou la truite, elle l’est beaucoup moins chez la rate. Un récent travail, mené sous la houlette de Linus Vandenberg, de l’Institut Universitaire de Médecine de Tufts, aux Etats-Unis, a porté sur le niveau d’exposition au bisphenol-A (BPA) (8). Cette molécule offre la particularité d’être délivrée à partir de matériaux dentaires, d’emballages de boissons et d’aliments ou encore de films plastiques. On en reçoit donc tous peu ou prou.
Des travaux préliminaires avaient montré que les effets de l’exposition prénatale à cette molécule persistaient, sur la glande mammaire de la souris, jusqu’à l’âge adulte. Bien au-delà de l’arrêt de l’exposition à ce polluant. Ce travail, publié en janvier dernier, a prolongé ces travaux en approfondissant le mode d’action du BPA. Passons les aspects techniques et expérimentaux, trop complexes, pour n’en retenir que les conclusions : Il est quasi certain que les anomalies de développement du tissu mammaire observées à la puberté et à l’âge adulte, chez ces rongeurs, trouvent leur origine dans l’exposition prénatale à ces toxiques.
Les extrapolations à l’espèce humaine demandent d’autres données. Notamment des relevés des épidémiologies à plus vaste échelle. Mais le doute semble de moins en moins permis. En outre, la possibilité qu’ont ces molécules d’influer sur les paramètres hormonaux ne devrait pas manquer de susciter des interrogations quant à leur potentiel cancérigène. D’ores et déjà, des données statistiques ont donc été recueillies, afin de voir s’il existe des corrélations entre le niveau d’exposition à ces « xénoestrogènes » et le nombre de cas apparus. Contre toute attente, aucun lien n’a été établi pour le cancer du sein (3, 9, 10), pas plus qu’en ce qui concerne le risque de lymphome (5). Certes, les effectifs recrutés dans le cadre de ces études sont sans doute un peu faibles pour identifier un phénomène assez rare. En effet, l’échantillonnage n’excède pas 300 sujets dans le meilleur des cas. Les dosages sont délicats, le recrutement et la tenue des registres s’avèrent fastidieux. Mais en l’état actuel des choses, on n’a bien sûr pas réalisé le tour de la question. Ainsi, cela ne permet pas d’écarter définitivement toute participation de ces molécules dans cette pathologie. On ne voit d’ailleurs pas comment il pourrait en aller autrement : Si l’AFSSA adopte une position pondérée vis-à-vis du soja, sur la base d’extrapolations prudentes, alors même que l’implication de cette plante dans d’éventuelles malformations n’est pas envisagée, il est difficile de penser que des molécules qui seraient davantage capables de fausser les processus de maturation tissulaire seraient sans effet sur le risque de cancer.
Pourtant, curieusement, on parle beaucoup moins des dangers des « xéno-estrogènes », dans les sphères médicales ou dans les médias, que de ceux liés aux dérivés du soja. Pourquoi ? Peut-être cela a-t-il à voir avec le fait que les principaux vecteurs de contaminants sont, chez l’enfant, le lait et ses dérivés. La possibilité que le soja, à cause des phyto-estrogènes, ne soit pas d’une totale innocuité est une aubaine pour un marché qui voit d’un mauvais œil la montée en puissance du soja et les discours remettant en cause les vertus universelles des laitages.
En déplaçant le débat des allergies vers les cancers ou les malformations, certains experts (pas forcément indépendants vis-à-vis de l’industrie laitière), redonnent la main aux gros groupes de l’industrie agro-alimentaire. Or qui, aujourd’hui, a intérêt à évoquer sur la place publique la richesse du lait en xéno-estrogènes ?
LES RÈGLES DE PRUDENCE :
Quoiqu’il en soit, face au manque de données à large échelle, et compte tenu du petit nombre d’études fondamentales (très parlantes cependant), menées sur la question, il est sans doute urgent de ne pas attendre pour se protéger au mieux. En regard des connaissances actuelles, on peut donner les conseils suivants :
- Évitez les aliments tout prêts sous emballage plastique.
- Abstenez-vous de réchauffer ces derniers au four à micro-ondes, car ce processus est susceptible de favoriser la formation de dérivés « xénoestrogéniques » et leur diffusion dans les aliments.
- Évitez l’eau du robinet, mais méfiez-vous des eaux embouteillées. De fait, transvasez-en rapidement le contenu dans des carafes en verre avant de les consommer.
- Privilégiez les fruits et légumes « bio » et, dans tous les cas, lavez bien les végétaux avant de les consommer ou de les cuisiner.
- Si vous consommez beaucoup de produits laitiers, privilégiez ceux qui soient « bio ».
- Faites de même avec les huiles car, dans le cas contraire, vous pourriez réintroduire dans votre assiette les pesticides que vous avez soigneusement éliminés en lavant les carottes ou la salade que vous noyez ensuite sous votre vinaigrette.
- Évitez de prendre ou de perdre trop de poids… car vous risqueriez de stocker, puis de libérer massivement, des molécules dont la durée de vie est très longue.
- Si vous travaillez la terre de manière conventionnelle, protégez-vous avec gants et masques.
- Et si vous habitez près de terrains agricoles régulièrement arrosés d’engrais et de pesticides, calfeutrez les orifices de la maison ou déménagez !
BIBLIOGRAPHIE :
(1) : CRETOL A (2005) : Le soja en nutrition humaine, notamment en prévention des maladies cardio-vasculaires. NAFAS, 3 (5) : 3-24.
(2) : FERNANDEZ MF, RIVAS A & Coll (2004) : Assessment of total effective xenoestrogen burden in adipose tissue and identification of chemicals responsible for the combined estrogenic effect. Anal.Bioanal.Chem., 379 (1) : 163-70.
(3) : IBARLUZEA JM, FERNANDEZ MF & Coll (2004) : Breast cancer risk and the combined effect of environmental estrogens. Cancer Causes Control., 15 (6) : 591-600.
(4) : LYSSIMACHOU A, ARUKWE A (2007) : Alteration of brain and interregnal SrAR protein, P450scc, and Cyp11beta mRNA levels in atlantic salmon after nominal waterborne exposureti the synthetic pharmaceutical estrogen ethynestradiol. J.Toxicol.Environ.Health A., 70 (7) : 606-13.
(5) : QUINTANA PJ, DELFINO RJ & Coll (2004) : Adipose tissue levels of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls and risk of non-Hodgkin’s lymphoma. Environ. Health Perspect. 112 (8) : 854-61.
(6) : SHEN H, MAIN KM & Coll (2007) : From mother to child: investigation of prenatal and postnatal exposure to persistent bioaccumulating toxicants using breast milk and placenta monitoring. Chemosphere, 67 (9) : S256-62.
(7) : STELLMAN SD, DJORDJEVIC MV & Coll (2000) : Breast cancer risk in relation to adipose concentrations of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in Long Island N.Y. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 9 (11) : 1241-9.
(8) : VANDENBERG LN, MAFFINI MV & Coll (2007) : Exposure to environmentally relevant doses of the xenoestrogen bisphenol-A alters development of the fetal mouse mammary gland. Endocrinology, 148 (1)) : 116-27.
(9) : ZHENG T, HOLFORD TR & Coll (1999) : DDE and DDT in breast adipose tissue and risk of female breast cancer. Am.J.Epidemiol., 150 (5) : 453-8.
(10) : ZHENG T, HOLFORD TR & Coll (2000) : Oxychlordane and trans-nonachlor in beast adipose tissue and risk of female breast cancer. J.Epidemiol.Biostat., 5 (3) : 153-60.
Denis Riché, pour “Sport & Vie”.- 2007
Photos : MCC
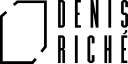
0 commentaires