Souvent, dans le domaine médical, on s’attache à traiter un symptôme à l’aide d’un produit ou d’une molécule, sans forcément prendre en compte la globalité ni la complexité du problème rencontré. Et parfois, la stratégie adoptée soulage l’anomalie pour la faire réapparaître un peu plus tard et plus fort.
BOUCHER LES TROUS AVEC UNE PASSOIRE :
Le premier exemple frappant de ce mode de raisonnement qui rappelle le système des dominos, c’est celui des problèmes digestifs chroniques, très fréquents dans le milieu des sports d’endurance, traités préventivement ou à des fins thérapeutiques à grands coups d’anti-inflammatoires. Ces produits sont intéressants pour traiter dans l’immédiat des symptômes douloureux et invalidants, mais beaucoup plus sujets à caution lorsqu’on regarde à long terme. L’auto-médication à base d’anti-inflammatoires pose d’autres problèmes, et ce d’autant qu’il s’agit d’une pratique très répandue.
Lorsqu’il procéda à un sondage dans le peloton des coureurs sur route au début des années 90, le physiologiste néerlandais Fred Brouns, spécialiste de la sphère digestive, eut la surprise de constater que près de 30% de athlètes de son pays, tous niveaux confondus et à l’image des autres européens, en consommaient à titre préventif (5). Notamment sur l’ultra. L’anticipation sur la casse musculaire suspectée de survenir au terme d’un effort intense, surtout de longue durée, ou le souci de masquer une petite gêne, voire une douleur, qui pourrait contraindre à renoncer à l’objectif préparé depuis plusieurs mois, motivent à l’évidence ce comportement qui, vu de l’extérieur, peut paraître curieux. Rappelons que l’inflammation se définit par plusieurs critères : c’est une réaction localisée d’un tissu, consécutive à une agression (blessure, infection, irradiation, etc…), qui provoque quatre signes principaux : rougeur, chaleur, tuméfaction (gonflement), douleur, et provoque un afflux de globules blancs et une accumulation de liquide dans les tissus, à l’origine de sensations douloureuses. Prologue à la reconstitution (en plus solide) des structures atteintes, une fois le nettoyage et les réparations opérées, l’inflammation est un processus nécessaire à l’adaptation des tissus. Ainsi après un marathon ou une longue séquence de course en descente, certaines fibres sont lésées, ce dont témoigne la forte élévation du taux sanguin de CPK, qui culmine 48 heures après l’effort en question, ou de la protéine C- réactive, qui témoigne de ce grand travail de nettoyage (21). Beaucoup d’études ont confirmé cette cinétique, avec les fameuses douleurs des ischios du « surlendemain », qu’on redoute d’ailleurs tant quand 24 heures après une épreuve on a déjà mal partout…
Certains travaux publiés au début des années 90, ont montré que la prise d’aspirine après l’effort minimisait les manifestations douloureuses habituellement rencontrées au terme d’un effort de 42 km et des poussières. Cela pourrait donc justifier, notamment à titre préventif, le recours aux anti-inflammatoires chez une population « à risque ». Dans certains sports comme le foot, ces médicaments font d’ailleurs partie intégrante de l’environnement des joueurs, toujours entre deux blessures et deux traumatismes. Le problème, c’est que certains d’entre eux lèsent les intestins, favorisant leur plus grande perméabilité…
MOINS DE 10% DES BESOINS :
Classiquement, en cours d’effort, la circulation sanguine fait l’objet d’une nouvelle répartition. Elle défavorise les intestins, dont l’irrigation tombe à moins de 10% de sa valeur de repos. Ceci se traduit, entre autres effets, par une diminution de l’apport énergétique aux entérocytes. Cela n’est pas sans conséquence ; en situation normale, l’une des fonctions de la muqueuse est d’assurer un rôle de barrière à l’encontre de tout pathogène potentiel. Cette relative étanchéité est assurée grâce à la présence d’architectures moléculaires particulières, nommées les jonctions serrées. Il s’agit d’un ensemble de protéines stabilisées par un cytosquelette, situées sur le côté des entérocytes (2). Leur fonctionnement est un processus dynamique, régulé par de nombreux facteurs. Certains sont des nutriments, comme les « oméga 3 » qui en assurent l’étanchéité (11). D’autres se rangent parmi les médiateurs de l’inflammation ou les radicaux libres, qui favorisent une plus grande perméabilité intestinale. Les anti-inflammatoires, eux aussi, peuvent intervenir à ce niveau. La protection superficielle du mucus gastrique, des intestins et des jonctions serrées repose en partie sur la présence de certaines prostaglandines dérivées des « oméga 3 », comme on l’a vu. Or leur synthèse fait appel aux mêmes voies enzymatiques que les molécules pro-inflammatoires. De ce fait, la prise chronique de ou répétée de ces médicaments, qui en bloquent la synthèse, fragilise ce mucus et les jonctions serrées, garantes de l’étanchéité. A terme, il s’ensuit une porosité accrue des intestins. On relève également un nombre bien plus élevé de lésions ulcéreuses au niveau de l’estomac : Les chiffres sont décuplés chez les utilisateurs réguliers d’anti-inflammatoires (19).
Ainsi à l’effort, l’ischémie qui provoque la mort de certains cellules du tube digestif, l’inflation de la production radicalaire, l’augmentation physiologique de la perméabilité conjuguent leurs actions à celle des anti-inflammatoires pour contribuer à la porosité et à l’inflammation intestinale. Selon les cas, elle s’exprimera dans le secteur digestif ou extra-digestif. Mais dans tous les cas, cette inflammation est la conséquence directe de la rupture de la barrière intestinale, éventuellement sous l’effet des anti-inflammatoires !
Pour déceler cette augmentation de la perméabilité, qui peut devenir pathologique et déclencher une inflammation, on peut rechercher la présence éventuelle, dans les urines, de molécules préalablement avalées par la bouche, et qui théoriquement ne sont pas absorbées ni métabolisées. Dès 1987, grâce à cette technique, on a pu décrire la réalité de phénomène. Il a ainsi été démontré que la perméabilité croît de manière exponentielle avec l’intensité d’effort. Deux ans après, un autre travail l’a confirmé (15). Au terme de 15 mn d’échauffement entre 60 et 85% de VO2 Max puis intervalles de (30’’- 30’’) à 120% ou 65%, il a été noté une augmentation du taux urinaire d’un dérivé inassimilable. Enfin, une étude récente montre une augmentation de cette perméabilité après l’effort, chez des sportifs ayant pris au préalable de l’aspirine (13).




LES ANTI-INFLAMMATOIRES COMME TERMITES :
La prise chronique ou répétée d’anti-inflammatoires, en fragilisant ce mucus, donne lieu à un nombre bien plus élevé de lésions ulcéreuses au niveau de l’estomac : Les chiffres sont décuplés chez les utilisateurs réguliers d’anti-inflammatoires (16). Les statistiques obtenues chez les sportifs le confirment d’ailleurs. Ainsi, selon Baska (1), 80% des athlètes qui, à l’arrivée d’un marathon, présentaient des selles sanguinolentes, ont consommé des anti-inflammatoires avant l’épreuve, alors qu’on compte seulement 24% d’utilisateurs dans le peloton. La même année, Worme, dans une étude menée auprès de triathlètes, trouve une fréquence d’utilisation d’anti-inflammatoires de l’ordre de 45% des effectifs (22). Le recours augmente avec les distances parcourues en compétition. Plus récemment, une vaste enquête prospective diligentée par la FF Tri confirmait définitivement cette tendance (14). Estimée globalement à 18,9%, la fréquence de l’auto-médication augmentait avec la difficulté des épreuves : 15,5% sur la distance olympique, et 44,7% sur les « Ironmen ». En outre, la température basse de l’eau (moins de 15° C) et les températures extrêmes (moins de 20 ou plus de 30° C) occasionnaient une surconsommation médicamenteuse chez les adeptes du triple effort.
Ainsi à l’effort, l’ischémie qui provoque la mort de certains cellules du tube digestif, l’inflation de la production radicalaire, l’augmentation physiologique de la perméabilité et les effets des anti-inflammatoires conjuguent leurs actions pour contribuer à la porosité et à l’inflammation intestinale.
C’est sans doute en se répétant que le phénomène de perméabilité intestinale rencontrée à l’effort permet le passage fréquent d’une quantité significative de peptides alimentaires ou de matériaux bactériens, au point de provoquer une perturbation profonde de nos défenses, dont l’inflammation sera alors l’une des manifestations. Selon les cas, elle s’exprimera dans le secteur digestif ou extra-digestif, pour toucher les muscles, les tendons ou les articulations. Tout dépendra en fait du point faible du sujet.
L’ARRÊT QUI FAIT MAL :
Cette inflammation peut donc être partiellement masqué par la prise d’anti-inflammatoires. Mais ensuite ? A l’arrêt de leur prise, l’installation de ce processus défavorable va conduire à une reprise de l’inflammation, voire à une accentuation de l’inflammation extra-digestive. Pour comprendre ce rebond, souvenons-nous du mode d’action des anti-inflammatoires ; l’inflammation est contrôlée par deux séries de molécules antagonistes, dérivées d’acides gras essentiels comprenant au moins 20 atomes de carbone, et nommées pour cette raison « eicosanoïdes ». Ces substances pro ou anti-inflammatoires sont issues de la transformation de ces acides gras par une série d’enzymes (cyclooxygénases) qui sont la porte d’entrée vers le contrôle de l’inflammation. Les acides gras précurseurs de l’inflammation ou au contraire inhibiteur de ce processus se trouvent en compétition sur cet enzyme, et l’équilibre basculera en faveur des uns ou des autres selon la nature des apports alimentaires. La plupart des acides gras de la lignée « oméga 6 » donnent naissance à des molécules pro-inflammatoires. Ceux de la série « oméga 3 » (principalement issus des poissons gras), ont l’effet inverse. Les anti-inflammatoires, ainsi que la cortisone, agissent en inhibant complètement l’action de ces enzymes. Conséquence? On ne fabrique plus de substances pro-inflammatoires. Ni d’anti-inflammatoires d’ailleurs. Mais ceux qu’on ingère font l’affaire. Par contre, à la cessation de la prise, c’est un rebond d’activité enzymatique qui surviendra. De quelle manière? Il est actuellement admis que le rapport « oméga 6″/ »oméga 3 » de notre alimentation est favorable à ceux-là, ce qui entretient une tendance « naturelle » à l’inflammation.
Au bout du compte, quels seront les effets possibles de ces anti-inflammatoires? Si on néglige de protéger l’écosystème intestinal par des mesures nutritionnelles appropriées (prise de probiotiques, apport de graisses de poisson, etc…), on va favoriser la perméabilité intestinale et bloquer les processus physiologiques pro et anti-inflammatoires, de sorte qu’à l’arrêt de la prise le risque de reprise, de récidive ou d’aggravation peut à moyen terme se trouver augmenté. Tout le problème consistera à évaluer le rapport entre le bénéfice et les effets secondaires de cette procédure. Justifiée en cas de tendite rebelle (et dans ce cas accompagnée d’un repos contraint qui, en l’absence d’effort, limitera les épisodes d’inflammation physiologique ou de perméabilité intestinale), elle paraît bien moins avantageuse lorsqu’elle est entreprise a priori, ou qu’elle s’inscrit dans une utilisation chronique. Dans ce cas, on ne sait plus, finalement, qui de la blessure initiale ou de la correction proposée continue à entretenir le cercle vicieux de la blessure récalcitrante. On a simplement déplacé le problème…
LES ANTI-DÉPRESSEURS QUI DÉPRIMENT…
La sérotonine est un neurotransmetteur encore très mystérieux qui fait actuellement l’objet de beaucoup d’attention. On a en tout cas remarqué en psychiatrie qu’une chute chronique du taux de sérotonine au repos correspondait à un état persistant de fatigue, voire de dépression. Une nouvelle vague de médicaments dits sérotoninergiques (qui miment l’action de la sérotonine) permet alors de rétablir l’équilibre de façon plus ou moins spectaculaire. Mais, en dépit d’effets parfois spectaculaires à court terme, ils ne résolvent rien au problème initial du manque de sérotonine. En fait, ces produits, à l’instar du « Prozac », allongent la durée de vie de la molécule, ce qui lui permet de produire une action au niveau du neurone post-synaptique, comparable à celle qu’on observerait si le cerveau pouvait en produire davantage. Cette prise ne règle en rien la question du déficit en sérotonine. Et à l’arrêt du traitement, il n’est pas rare de voir le patient replonger. L’hypoactivité sérotoninergique interpelle de plus en plus le corps médical. A quoi est-elle due ? Si l’on considère que sa fabrication, essentiellement intestinale et cérébrale, fait appel à des constituants de notre ration, il est tentant de regarder ce qui peut clocher. Le maillon faible se situe en général au niveau du fer (qui participe à la conversion du précurseur) soit carrément au niveau de celui-ci. Il s’agit d’un acide aminé essentiel, nommé le tryptophane, dont dérive la sérotonine. Pourquoi apparaît-il aussi souvent déficitaire ? Sans doute parce que cet acide aminé, le moins bien représenté dans notre alimentation, se situe au centre d’un carrefour métabolique important. Outre sa transformation en sérotonine dans le cerveau, qui est l’organe le dernier servi, il participe aussi à construction de gros complexe enzymatique dans le foie (le « Cytochrome P450 ») chargés de lutter contre tous les composés toxiques susceptibles de se répandre dans l’organisme: alcool, cigarette, café, thé, médicaments, pollution, hormones endogènes et exogènes, etc… On connaît au moins une vingtaine de sortes de « cytochrome P450 ». Chacune d’elle semble posséder une spécificité bien particulière pour un ou deux xénobiotiques précis (16). Historiquement, la mise en place de ce système témoigne de l’évolution, comme le rappelle le toxicologue Jean François Narbonne (16). Sur le plan phylogénétique, l’Homme, pour survivre, se nourrit de végétaux. Ceux-ci, pour s’en protéger, ont appris à élaborer des molécules toxiques pour notre organisme. Peu à peu des structures de détoxication se sont mises en place en réponse à ces poisons végétaux. Elles sont aptes à faire face aux diverses molécules naturelles rencontrées dans le règne végétal. Les cytochromes P 450 font partie de ces stratégies défensives de l’Homme. Progressivement, on a ainsi pu apprendre à reconnaître les molécules actives issues des plantes. Pour nos besoins, nous en avons changé quelques détails structuraux pour les rendre plus actives ou moins facilement dégradables. Ces produits « chimiques » contournent les moyens de défense naturels de notre organisme. Leur élimination demande donc un surcroît de travail et sollicite davantage les enzymes hépatiques. C’est notamment le cas lorsqu’on consomme des psychotropes ou du « Prozac ».
A ceci s’ajoute une autre caractéristique souvent négligée. Le cytochrome P 450 constitue une structure complexe où on trouve un noyau assez proche, structurellement, de l’hémoglobine. Il renferme notamment du fer (2, 7). L’un des autres cofacteurs en jeu est la vitamine PP qui, en cas de sollicitation excessive de cette voie va être obtenu par recyclage d’un acide aminé important, le tryptophane. 60 mg de tryptophane peuvent ainsi donner 1 mg de cette vitamine. Ainsi, en cas d’activation des fonctions hépatiques, une partie du tryptophane assimilé est détourné au profit du foie et sera donc moins disponible pour la synthèse cérébrale de sérotonine (7, 22). Or, le recours chronique au « Prozac » ou à tout autre psychotrope va mobiliser une partie du tryptophane de l’organisme pour sa dégradation. La disponibilité de cet acide aminé va alors diminuer d’un palier supplémentaire. La synthèse de sérotonine va s’en trouver encore plus déprimée. A l’arrêt de la cure, cette insuffisance accrue du tryptophane va entraîner un regain de la dépression, d’autant moins bien vécue que le patient semblait aller mieux. En outre, la vitamine B3 dont dérive le tryptophane est aussi un acteur de la synthèse cérébrale de la sérotonine, mais aussi de la dopamine et de la noradrénaline, qui sont les supports des deux autres grands métabolismes cérébraux avec lesquels la sérotonine interagit. Pour être précis, c’est au niveau de la première étape de leur synthèse, celle des enzymes nommées les « hydroxylases », que cette vitamine intervient. On comprend en tout cas facilement que la prise d’anti-dépresseurs ne règle en rien le problème de fond, souvent digestif et nutritionnel, mais qu’au contraire elle l’aggrave souvent. Certes, elle semble souvent justifiée sur le moment, mais n’oublions pas que la France détient le record mondial de prescriptions, ce qui laisse à penser que des prescriptions excessives soient pratiquées. Toujours est-il que les conséquences de cette prescription iront alors à l’encontre des effets recherchés, et à la cessation du traitement, on risque de voir ses patients sombrer dans une profonde dépression iatrogène.




LES ANTI-CHOLESTEROL AUX DÉGÂTS COLLATÉRAUX :
Dernier exemple choisi dans cet article, pas directement en rapport avec le sport, mais concernant sans doute une fraction non négligea ble de joggers, celui des médications « anti-cholestérol » classiques. Nous ne discuterons pas ici le bien-fondé de la démarche qui consiste, dans une logique de prévention des pathologies cardio-vasculaires, à abaisser le taux de cholestérol sanguin. Les limites de cette approche dans le contexte d’une maladie multifactorielle de cause inconnue sont cependant certaines et largement détaillées dans des ouvrages et articles de référence (6, 17, 20). Notons quand même que dans l’étude de Serge Renaud, qui reste le travail de référence sur la question, son approche alimentaire se montrait supérieure, relativement au risque de récidive, à l’efficacité des « statines » les plus efficaces. C’est de cette classe de molécules très largement prescrites dont nous voulons parler. Pour bien comprendre les problèmes conceptuels que peut soulever leur emploi, il est nécessaire de développer quelques aspects du métabolisme du cholestérol, l’un des plus cruciaux pour notre survie (2).
Rappelons qu’il s’agit d’un constituant important des membranes cellulaires, ainsi que du matériau servant à fabriquer les acides biliaires et toutes les hormones stéroïdes. Il ne s’agit pas d’une molécule essentielle au sens où on l’entend en nutrition, puisque notre organisme assure la synthèse de l’essentiel de ses besoins ; celle-ci se déroule surtout au niveau du foie et est sous l’influence de nombreux systèmes de contrôle. Cela paraît logique, il faut garantir à nos tissus l’apport à un taux approprié, ni trop ni trop peu, d’une molécule absolument cruciale. Son caractère indispensable est trop souvent méconnu : Entendre dire « docteur, j’ai du cholestérol ! » devrait en fait amener à répondre : « tant mieux ! » Mais cette réflexion, très fréquente, souligne bien notre méconnaissance de la question et l’ampleur du malentendu à propos d’une molécule plus bénéfique que néfaste. Certes, l’hypercholestérolémie est l’un des nombreux facteurs associés à la survenue de maladies cardio-vasculaires, mais ni le seul, ni le plus important.
Ces mécanismes de contrôle sont beaucoup étudiés depuis quelques années, l’idée étant que dans le cas des « hypercholestérolémies » ils s’avèrent moins performants. L’enzyme-clef, la HMG CoA réductase, est une protéine fabriquée à partir de la lecture d’un gène, au cours d’un processus qui se nomme la « transcription ». De nombreux mécanismes de contrôle s’opèrent à ce niveau. Comment cela se passe-t-il ? Certaines molécules se fixent sur la zone du chromosome qui correspond à ce gène, et empêche la fabrication de la protéine qui y correspond. D’autres font l’inverse, leur positionnement sur le chromosome favorisant la synthèse de la protéine associée à ce gène. On comprend que la compréhension de ce mécanisme en vue de sa maîtrise puisse susciter autant d’intérêt de la part des chercheurs (2). Or, on sait que cette expression est modulée par différents acteurs, parmi lesquels figure le contenu en cholestérol de la ration (3, 6). Plus on en mange, moins notre foie en fabrique à l’aide du « HMG CoA réductase ». En temps normal, environ 70% du cholestérol circulant résulte de cette synthèse endogène (2). C’est pour cela que l’intérêt d’une réduction drastique de son apport par notre ration se trouve, depuis un quart de siècle, fortement sujet à caution (12). Il serait même, à en juger à un très récent travail, carrément néfaste (*).
Revenons aux statines. Leur rôle consiste à inhiber cet enzyme, ce qui peut avoir comme effet de faire chuter la synthèse du cholestérol, et donc son taux circulant. Mais pas seulement. Normalement, la HMG CoA réductase permet la fabrication d’un intermédiaire, le « mévalonate ». Celui-ci peut donner naissance, simultanément, à plusieurs produits très différents : Outre le cholestérol, il permet la fabrication de l’hème (constituant de l’hémoglobine chargée de transporter le sang dans le sang, ainsi que de la myoglobine et d’autres protéines). Il favorise également la synthèse de sels biliaires, indispensables à une digestion correcte des nutriments lipophiles, notamment celle des vitamines A, D, E et K, celle des hormones stéroïdiennes, des lipoprotéines, et enfin d’un autre composé moins connu du public. C’est le « coenzyme Q10 » ou « ubiquinone », largement utilisé comme complément dans d’autres pays, et auquel on a par le passé consacré un papier pour évoquer ses vertus ergogènes très controversées (3, 4). La prise de « statines » exerce un effet inhibiteur qui s’exprimera vis-à-vis de la synthèse de l’ensemble des composés dont le mévalonate est le précurseur. Y compris par conséquent le coenzyme Q 10. Paradoxalement, cette stratégie de prévention des maladies cardio-vasculaires peut alors, potentiellement, aller à l’encontre du but recherché. Divers travaux ont en effet souligné que le coenzyme Q 10 pouvait être déficitaire chez des patients atteints d’angine de poitrine (8, 9). Une étude ayant consisté à complémenter un groupe de malades avec ce constituant a permis une meilleure protection du myocarde, à la fois en favorisant son oxygénation et en réduisant l’importance des dommages liés à l’attaque des radicaux libres (3, 4, 18). On suspecte que le déficit en ubiquinone puisse constituer un facteur de risque.
La synthèse des acides biliaires peut également se voir ralentie sous l’usage de ces médicaments. Pour quelle conséquence ? Une possible diminution de l’absorption de la vitamine E, et donc une vraisemblable chute de sa disponibilité. Or, la chute de son taux constitue l’un des facteurs de risque de maladie cardio-vasculaire les mieux corrélés au risque d’athéro-thrombose. Davantage qu’un taux de cholestérol élevé ! (6). De ce fait, l’usage chronique et sans discernement des statines enlève d’un côté ce qu’il ajoute de l’autre. Ce qui peut expliquer que le régime crétois se montre plus performant, sur le plan de la protection, que les statines les mieux cotées !
(*) : Ce travail très original a fourni des conclusions très iconoclastes ; il repose sur le fait que des apports nutritionnels de cholestérol au moment où l’enzyme « HMG CoA réductase » est à son maximum, peut en diminuer l’activité, et de ce fait pourrait, théoriquement, permettre d’abaisser le taux de cholestérol sanguin. Restait à démontrer cet effet paradoxal, ce que Jean Robert Rapin a fait, en faisant appel à un groupe de volontaires (17). Tous présentaient un taux de cholestérol sanguin au-dessus des normes. La moitié d’entre eux a reçu comme consigne de consommer au cours du petit déjeuner et du déjeuner un repas riche en cholestérol, œufs, bacon, fromage, à l’anglaise. Au bout de trois mois, il a enregistré chez l’ensemble des sujets une baisse significative du cholestérol. Ce processus physiologique de régulation n’a sans doute pas, par contre, affecté la formation du coenzyme Q 10 ni affecté les autres voies métaboliques dérivées du mévalonate. Comme quoi avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
Bibliographie :
(1) : BASKA R, MOSES F & Coll (1990) : Dig.Dis.Sci., 35 (2) : 276-9.
(2) : BIESELSKI HK, GRIMM P (2001) : « Atlas de poche de nutrition ». Maloine Ed.
(3) : BONARDELLI P, OLIANI C & Coll (1990) : Clin.Therap., 12 (6) : 547-55.
(4) : BRAUN P, CLARKSON PM & Coll (1991) : Int.J.Sports Nutr., 1 : 353-65.
(5) : BROUNS F (1993) : Sports Med., 15 (4) : 242-57.
(6) : BURCKEL A (1999) : « Les bienfaits du régime crétois ». « J’ai lu » Ed.
(7) : CHOS D, RICHE D (2001) : « Diététique et micronutrition du sportif », Vigot Ed.
(8) : FOLKERS K, VADHANAVIKIT S & Coll (1985) : Proc.Natl. Acad.Sci., 82 : 901.
(9) : GREENBERG SM, FRISHMAN WA (1988) : Medic.Clin.NA., 72 (1) : 243-7.
(10) : HALVORSEN FA, LYNG J & Coll (1986) : Scand.J.Gastroenterol., 21 : 493-7.
(11) : HILLIER K, JEWELL R & Coll (1991) : Gut, 32 : 1151-5.
(12) : KUMMEROW F & Coll (1977) : Am.J.Clin.Nutr., 30 : 664-73.
(13) : LAMBERT A, BROUSSARD D (2001) : A compléter.
(14) : LOPEZ A, PREZIOSI JP & Coll (1994) : Gastroenterol.Clin.Biol., 18 : 317-22.
(15) : MOSES F, RYAN B & Coll (1988) : Am.J.Gastroenterol., 83, 1055.
(16) : NARBONNE JF (2003) : Toxicologie alimentaire. Eléments de cours. DU « Alimentation santé et micronutrition », Univ. Pharmacie Dijon.
(17) : RAPIN JR (2003) : NAFAS, à paraître.
(18) : RENAUD S, DE LORGERIL M & Coll (1995) : Am.J.Clin.Nutr., 61 (Suppl.), 1360S- 7S.
(19) SANTUCCI L, FIORUCCI S & Coll (1992) : Dig.Dis.Sci., 37 (12) : 1825-32.
(20) : SRIVASTAVA KC, MUSTAFA T (1993) : Biomed. Rev., 2 : 15-29.
(21) : STRACHAN AF, NOAKES TD & Coll (1984) : Brit.Med.J., 289 : 1249-51.
(22) : TAXI J (1977) : « Comment fonctionne le système nerveux? », La Recherche en neurobiologie : 6 52.
(23) : WORME J, DOUBT T & Coll (1990) : Am.J.Clin.Nutr., 51 : 690-7.
(24) : WURTMAN R, LEWIS B & Coll (1991) : Med.Sports Sci., 32 (special issue) : 94 109.
Denis Riché – septembre 2003
Photos : Maryse S.
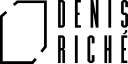
0 commentaires