Les instances médicales, convaincues de l’intérêt de la pratique sportive dans une perspective de prévention des maladies cardio-vasculaires, planchent régulièrement afin de définir le niveau d’activité optimale exerçant un rôle protecteur. Leur approche prend en compte notre mode de vie de plus en plus sédentaire. Or, au cours de notre évolution nous avons acquis un incroyable bagage génétique, hérité de nos ancêtres préhistoriques, qui nous prédispose à accomplir l’Ironman d’Hawaii chaque année. C’est du moins ce qui ressort d’une récente analyse (4).
VINGT FOIS MOINS QU’IL Y A 40 ANS…
Comme nous l’avons souligné dans un ancien numéro (« Sport & Vie » n°15, p 16 à 19), l’entrée dans l’ère industrielle, à l’origine de changements de société majeurs dont la sédentarité et l’élévation du niveau de vie ne sont pas les moindres, a conduit un nombre croissant de scientifiques à s’interroger sur l’impact bénéfique de l’activité physique. L’approche épidémiologique méthodique de Ralph PAFFENBARGER (11, 12), s’appuyant sur des études conduites auprès de dockers ou d’anciens étudiants de Harvard observés avec le recul d’une demi-vie, ont à l’époque révélé des données frappantes. Ainsi y a-t-on appris que le risque d’une première attaque cardiaque diminuait de moitié si ces sujets dépensaient 9500 calories par semaine sous forme d’activité physique, sportive ou d’ordre professionnel. En ne considérant que la dépense occasionnée par celle liée au loisir, qui offre la double particularité d’être mieux codifiée et de solliciter l’organisme à la fois en durée et en intensité, le chiffre-clé était alors de 3000 calories par semaine, ce qui pour un joggeur de 70 kg représente pas moins de 45 km de course par semaine. Trois fois moindre que la précédente s’agit-il d’une recommandation minimale plus réaliste? Gardons à l’esprit que même chez les plus sportifs d’entre eux la dépense calorique due aux tâches professionnelles dépassait de loin celle qu’on peut mesurer aujourd’hui. Ainsi, chez l’homme-type des pays occidentaux, le métabolisme de repos représente désormais 70% de la dépense énergétique quotidienne totale (contre 5 à 10% pour l’extra-chaleur), le reste correspondant à l’activité physique, qui se résume alors souvent à la marche dans les parkings pour se rendre aux véhicules ou à la séance de tondeuse à gazon du week-end (4).
Ces 9500 calories hebdomadaires supplémentaires, en tout cas, ont à une époque fait office de référence. Pour un athlète de 70 kg, cette valeur équivaut à 135 km de course à pied… activité que bon nombre de nos concitoyens jugeraient totalement irréalisable et surhumaine. A cet égard, l’évolution des recommandations s’avère très instructive. En 1995, l’American College of Sports Medicine (ACSM), lors d’une réunion de consensus, conseille à ceux qui désirent améliorer leurs performances athlétiques, une activité minimale de 3 à 5 séances par semaine, effectuées en continu à une intensité de 50 à 85% de VO2 Max, et sur une durée de 20 à 60 mn (4). L’une des clefs était que si l’intensité se situait à un niveau élevée, la durée pouvait être réduite. Plus d’un physiologiste et moult entraîneurs collaborant avec l’élite trouveront ces chiffres irréalistes, en particulier en ce qui concerne l’intensité préconisée aux compétiteurs. Par contre, dès lors qu’il s’agissait de promouvoir un état de santé optimal moins d’efforts pouvaient convenir, puisqu’il suffisait d’effectuer 30 mn d’activité par jour, pas forcément en continu, la marche se voyant ainsi conseillée. Dans ce cadre, les chiens et les boulangers peuvent alors jouer un rôle prépondérant pour la santé de notre population.
Une étude plus récente, menée à l’instigation du docteur CHAE et poursuivie pendant 12 ans, a évalué les habitudes de plus de 22.000 médecins, afin de mesurer l’impact de l’activité sur leur santé cardio-vasculaire (7). Elle en a tiré la conclusion suivante : « La durée n’a pas un effet majeur, on ne relève aucun bénéfice accru chez ceux qui effectuent un exercice pendant 11 à 24 mn comparativement à ceux qui accomplissent des sessions plus longues. Notre étude suggère, poursuit-elle, que l’accomplissement de sessions d’exercice soutenues de 11 à 24 mn une à deux fois par semaine peut exercer un effet préventif significatif. » Même si en faisant du sport plus souvent on accroît le bénéfice, ce travail suggère en tout cas qu’en dépensant 200 calories deux fois par semaine on protège efficacement ses artères. Comparons ces chiffres à ceux avancés par PAFFENBARGER : En l’espace d’une génération, on est passé de 9500 calories par semaine à 400, ce qui correspond à une réduction d’un facteur 20. A ce rythme, nos petits-enfants pourront se contenter de deux fois une mn par semaine! En révisant sans cesse à la baisse les conseils, alors même qu’on se dirige vers une société où chacun pourra consacrer plus de temps aux loisirs, on peut se demander si on va vraiment dans le bon sens. La récente publication de CORDAIN prend radicalement le contre-pied de ce consensus mou…
NOS ANCÊTRES LES NÉANDERTALIENS…
Pour lui, le raisonnement qui prévaut est faussé. En effet, il s’appuie uniquement des observations tirées des salles de sport, des stades ou des laboratoires, mais néglige l’influence majeure de la sélection opérée au cours de l’évolution. Il a donc publié un article examinant la façon dont cette évolution a façonné les potentialités athlétiques de l’Homme. Pour cela, il s’est appuyé sur le meilleur modèle disponible de l’activité de nos ancêtres, bien qu’on le sache imparfait, celui des chasseurs- cueilleurs qu’on a récemment étudiés. Pratiquement tous les écrits médicaux se posant la question de l’entraînement optimal pour un bon état de santé, envisagent celui-ci sous l’angle de la fréquence, de l’intensité, de la durée et du mode d’exercice, se référant à des mécanismes « immédiats » (c’est-à-dire intervenant au bout d’un délai de quelques mois) reliant l’exercice à la santé et à la forme (6). Cependant, si le mode de vie choisi, le développement et la diversité génétique (3) expliquent la grande variabilité des aptitudes physiques, le potentiel humain est génétiquement déterminé. Autrement dit, nos limites sont inscrites dans nos gènes, et ceux-ci sont modelés par l’histoire de notre espèce, à l’échelle de laquelle la civilisation industrielle contemporaine est ridiculement mince. Comme toutes les espèces, nos ancêtres ont développé des aptitudes physiques et des limitations qui lui sont propres, et ce pendant 2 millions d’années, jusqu’à l’apparition de l’agriculture il y a à peine 10 000 ans. Tout au long de cette période, ce furent des « chasseurs- cueilleurs » dont les contraintes physiologiques et environnementales ont modelé et sélectionné notre patrimoine génétique, d’où l’idée de s’intéresser à leur mode de vie dont on sait désormais beaucoup de choses.
Même si, sur le plan anatomique, l’Homme « moderne » est apparu il y a à peu près 100 000 ans, un véritable comportement d’homme « intelligent » ne remonterait, d’après les relevés fossiles, qu’à 50 000 ans. Des comparaisons de l’ADN mitochondrial de divers groupes ethniques indiquent que la constitution génétique de l’homme contemporain a relativement peu changé ces 50 derniers millénaires en dépit des énormes transformations sociales liées à l’agriculture et à l’industrialisation (18, 20). De ce fait, la relation entre la dépense calorique et l’activité motrice est toujours celle qui a été sélectionnée originellement dans cet environnement.
La vie moderne se caractérise par une très nette diminution de notre activité quotidienne, en tout cas nettement en-dessous celle qui était accomplie lorsque le génome humain actuel fut sélectionné. De surcroît, l’exercice physique aujourd’hui, pour la plupart des individus, est devenue une activité séparée des autres tâches de la journée. A l’inverse, à l’époque préhistorique et tout au long de l’Histoire, elle a constitué un aspect intégral, obligatoire de l’existence de nos ancêtres : chasser, cueillir, porter, creuser, échapper aux prédateurs dépendaient exclusivement de la forme et des aptitudes physiques des individus. La survivance jusqu’à nos jours de certaines « niches » ethnologiques, telles que les Inuits du Canada (14), nous offre de précieuses informations sur la façon dont nos ancêtres pré-agricoles se dépensaient, et plus encore sur le niveau d’activité pour lequel notre espèce est génétiquement constituée.
NOS AMIS LES BIPÈDES.
Le passage de l’Homme à la station verticale a eu un profond impact sur les caractéristiques physiques et le potentiel athlétique des descendants des Australopithèques, y compris nous-mêmes. La première espèce qui s’apparente à nous, « Homo habilis », disposait d’un plus gros cerveau et constitua certainement le premier hominidé à fabriquer des engins de pierre. Cette évolution lui a sans doute permis de tirer davantage de nourriture de sa chasse et de ses cueillettes et de là, grâce à cette disponibilité alimentaire accrue, a vraisemblablement joué un rôle majeur dans l’acquisition d’aptitudes cérébrales plus importantes (1). Le statut de bipède a favorisé une meilleure nutrition du cerveau. En effet, lorsqu’il court l’Homme, à l’égal des autres primates, dépense certes deux fois plus d’énergie que les autres mammifères (17) mais à l’inverse, lorsqu’il marche, il se montre bien plus économe que les quadrupèdes, ce qui lui permet d’économiser une précieuse énergie. Or l’évolution vers un cerveau plus développé, et plus actif sur le plan métabolique, nécessite un afflux d’énergie plus important vers ce tissu. D’ailleurs, les humains consacrent 20 à 25% de leur métabolisme de repos à ce seul organe, contre seulement 8% pour les primates non humains et 3 à 4% pour les autres mammifères. Simultanément, les besoins de certains sites anatomiques, tels que le tube digestif, ont décru.


L’ENTRÉE DANS LA VIE INACTIVE :
Les informations précises recueillies à ce propos nous révèlent que les activités physiques de nos ancêtres, à l’époque du Paléolithique, suivaient un rythme hebdomadaire bien particulier ; les hommes chassaient d’un à quatre jours non consécutifs par semaine, avec des journées de repos intercalées, alors que les femmes s’adonnaient à la cueillette de végétaux tous les 2-3 jours. Là ne s’arrêtaient pas leurs occupations : il leur fallait aussi fabriquer des outils, surveiller les enfants, dont le périmètre de jeu était très important et dont estime que lors de leurs deux premières années ils étaient portés sur pas moins de 1500 km. S’y ajoutait encore la découpe du gibier, la préparation des vêtements, le transport de l’eau, celui du bois pour le feu, et le déplacement des camps. Enfin les danses, qui n’avaient rien de slows langoureux, constituaient la principale activité récréative, plusieurs heures par nuit, plusieurs nuits par semaine, ce qui fera certainement regretter à quelques-uns de ne pas être nés à cette époque! Quoiqu’il en soit, tout ceci représentait une sacrée dépense calorique, qu’on sait relativement bien estimer. A titre d’illustration, on considère que les Occidentaux ont actuellement une dépense énergétique journalière totale qui équivaut simplement au métabolisme de repos des hommes préhistoriques. Cette nette réduction de la dépense explique sans doute l’augmentation de l’adiposité et la perte de masse musculaire associées à la sédentarité actuelle. Pour mieux caractériser cette tendance à l’oisiveté générale, considérez ce qui suit : pour qu’un Américain moyen arrive à approcher la dépense énergétique totale des cueilleurs-chasseurs, il devrait ajouter quotidiennement 17 calories par kg et par jour. Ceci correspond à l’accomplissement de 17 km de course ou de 24 de marche chaque jour.
Pour la première fois dans toute l’Histoire de l’humanité, nous vivons dans une société où ne sommes plus en mesure de nous confronter aux limites ultimes de notre patrimoine génétique, on subit même une sorte de « désadaptation » désastreuse, très voisine de celle rencontrée par les champions au moment de leur retraite sportive. A cet égard, le phénomène « Inuit » nous fournit de précieuses informations. Un groupe de scientifiques a décidé à la fin des années 60, de se livrer, tous les 10 ans pendant 30 ans, à une évaluation systématique des aptitudes physiques d’un groupe à la fois important et représentatif de cette ethnie (14). Trois séries de mesures furent ainsi obtenues, en 1970, puis en 80 et en 90. Entre-temps, la civilisation est arrivée à eux, les soumettant à une sédentarisation et à une occidentalisation radicales dont on a pu mesurer les conséquences catastrophiques (voir le tableau). L’arrivée généralisée des motoneiges, du mobilier de cuisine et du chauffage central s’est accompagnée, en l’espace de deux décennies, d’une prise de masse grasse, d’une diminution de la force et d’une chute de VO2 Max. La supériorité qu’ils manifestaient par rapport aux Américains, en 1970, sur le plan physique, est déjà bien moins évidente en 1990, même si un petit écart subsiste encore. On peut penser que le même phénomène ayant touché les populations occidentales avec l’avènement du monde industriel, il est fort possible que les recommandations actuelles, concernant le niveau d’activité physique souhaitable, soit une sorte de consensus mou imposé par l’indolence ambiante. CORDAIN n’hésite en tout cas pas à écrire : « D’un point de vue évolutionniste, c’est le mode de vie sédentaire des pays riches de l’époque contemporaine qui constitue un extrême, pas celui qui a prévalu pour l’Homme depuis nos origines jusqu’à l’ère industrielle. » L’essor de sports extrêmes comme le triathlon constituerait alors une sorte de retour aux sources…
TABLEAU : Evolution des aptitudes physiologiques des Inuits entre 1970 et 1990 (14) .
 Variables et âge des sujets Hommes
Variables et âge des sujets Hommes
On note que les quadragénaires de 1970 possédaient, en moyenne, une VO2 Max supérieure à celle mesurée en 1990 chez les représentants de la tranche d’âge 20-29 ans. Chez ces individus colonisés, la diminution de la puissance maximale aérobie liée à ce changement sociologique dépasse de loin la baisse inéluctable imputable à l’âge. Le même constat peut être établi à partir des chiffres relevés chez les femmes (non représentés ici).
UNE AFFAIRE D’ADAPTATION AU NÉANT :
On a vu que, si on se réfère aux recommandations de l’ACSM, il suffit d’effectuer 30 mn de marche à 5 km/h afin de rester en bonne santé. Cette activité correspond, pour un individu « standard » de 70 kg, à une dépense de 150 kcal, qui s’ajoutent aux 615 calories dont on considère qu’elles représentent une bonne estimation du coût de l’ensemble des activités ménagères et modérées de la journée (4). Ce total représente alors une dépense de l’ordre de 11 kcal/kg.j, ce qui reste bien en-deçà des estimations proposées pour certaines ethnies comme les Ache (20 kcal/kg.j), et sans doute aussi de la dépense journalière de nos ancêtres de l’Âge de Pierre, qui a fortement façonné notre patrimoine héréditaire.
Les chiffres plus élevés proposés par PAFFENBARGER, dans le cadre de ses travaux sur les dockers, font état d’une dépense de 9000 calories par semaine, chiffre englobant l’activité professionnelle et le sport. Pour notre homme de 70 kg, ces données représentent 137 kcal/kg par semaine (25 km de course par jour), ce qui correspond exactement aux chiffres avancés pour les ethnies de chasseurs-cueilleurs (4). Troublant, non?
Un point essentiel, toutefois, distingue le mode d’exercice de nos ancêtres du nôtre : Si on se réfère aux critères modernes d’entraînement, il manque l’efficacité, dans le sens où on l’entend aujourd’hui. L’essentiel du travail fourni par les hommes préhistoriques consistait en effet en un très gros volume d’exercices effectués à faible intensité, pour employer la terminologie en vigueur. Or, on sait bien qu’on ne devient pas forcément mieux adapté à l’effort en se contentant d’exercices à faible allure. On peut donc donc considérer que le bénéfice retiré du sport peut être comparable si on accroît l’intensité des exercices et qu’on y consacre moins de temps (voir l’encadré). On peut également s’attendre à en tirer encore plus de bénéfice si on greffe à ce gros travail de volume des séances plus intensives, même si « l’entraînabilité » des sujets, c’est-à-dire leur aptitude à répondre à l’entraînement par une progression des performances, varie beaucoup d’un sujet à l’autre selon leur patrimoine génétique (3). Les plus « entraînables » auraient ainsi été sélectionnés au cours de l’évolution. La modélisation de l’entraînement, s’appuyant sur cette approche évolutionniste, permet de comprendre que certaines grosses charges d’entraînement administrées aux triathlètes ou aux coureurs de grand fond semble être bien tolérées. Reprenant une étude ayant dressé les caractéristiques de concurrents américains de l’Ironman d’Hawaii, très bien détaillées dans un ancien article (5), nous avons estimé, grâce aux tables d’équivalence d’activité (13), qu’ils dépensaient près de 280 kcal/kg.semaine. Un calcul similaire, mené sur des données tirées d’une publication consacrée à un groupe d’ultramarathoniens, révèle une dépense moyenne, en période d’entraînement, située à 200 kcal/kg.semaine (9). C’est donc plus que pour les chasseurs de mammouths. Avec le recul conféré par une quinzaine d’années d’observations, il ressort que les adeptes des triathlons « longue distance », popularisés par des épreuves comme Nice ou Hawaii ne présentent pas, contrairement à ce qu’on craignait pour eux, de signes de traumatismes ou d’inadaptation à leur activité. Les marqueurs biologiques relevés chez eux laissent même à penser qu’ils sont plutôt bien adaptés à leur régime de forçat (10) et que la mort prochaine qu’on leur prédisait aux premiers temps de cette discipline, n’était pas plus fondée que les craintes énoncées à l’encontre des marathoniennes lorsqu’elles vinrent s’essayer sur les 42 km (10′). Conclusion? Respectez bien les principes de « progressivité », d' »alternance », sachez vous reposer, mais faites autant de sport que vous le voulez : Aucun travail ne vient suggérer qu’une telle débauche d’énergie, tant qu’elle ne s’appuie pas sur l’usage de produits illicites, puisse précipiter votre mort. Beaucoup d’entre nous seront de toute façon fatigués bien avant d’avoir brûlé de cette manière 9500 calories dans la semaine. Et si tel n’est pas le cas, il vous reste encore la possibilité de chasser, de tailler des silex et de passer des nuits entières à danser en cercle. Mais n’oubliez pas de prévenir la police!
LE TIERCE DE LA FORME.
Une étude publiée en 1986, synthétisant les multiples travaux consacrés à l’entraînement (19), a permis de caractériser les impacts respectifs de l’intensité, de la durée, de la fréquence des exercices au cours de la semaine, ainsi que celui du niveau initial du pratiquant. Il a fait appel à un traitement statistique complexe, par lequel on fixait un des paramètres en faisant varier les autres tour à tour. On regardait par exemple, pour une durée de séance donnée, quelle intensité améliorait le plus les performances. On reproduisait la procédure avec la fréquence des sessions d’entraînement. Cette approche a permis de traduire en courbes très parlantes la multitude de chiffres introduits dans cette analyse (voir ci-contre). Il en est ressorti de surcroît des informations aux impacts pratiques énormes. Lesquelles? Les effets les plus nets s’observent lorsqu’on emploie des intensités élevées. Ainsi, un exercice de plus de 35 mn effectué à une intensité intermédiaire produit le même effet qu’une séquence plus intense mais plus brève. Le gain maximal s’observe avec des intensités comprises entre 90 et 100% de VO2 Max. On note aussi que la fréquence constitue le second paramètre significatif, les passages de 3 à 4 séances hebdomadaires, puis de 5 à 6 s’accompagnant des améliorations les plus nettes, à intensité moyenne égale. Le volume, par contre, n’exerce pas d’effet majeur tant qu’il reste dans la moyenne.
Reste à discuter la spécificité de l’activité : Si l’objectif de la pratique se situe au niveau de la compétition, il convient de privilégier la forme d’exercice qui y correspond. Par contre, si on pratique le sport pour rester en bonne santé, tout exercice convient, pourvu qu’on sollicite suffisamment l’organisme. Et à cet égard, les chiffres de l’ACSM représentent vraiment le « minimum syndical ».
(1) : AIELLO L, WHEELER P (1995) : Current.Anthropol., 36 : 199-221.
(2) : BLAIR S, KOHL H & coll (1992) : Ann.Rev.Publ.Health, 13 : 99-126.
(3) : BOUCHARD C, BOULAY M & Coll (1988) : Sports Med., 5 : 69-73.
(4) : CORDAIN L, GOTSHALL R & Coll (1998) : Int.J.Sports Med., 19 : 328-35.
(5) : HOLLY R, BARNARD A & Coll (1986) : Med.Sci.Sports Exerc., 18 (1) : 123-7.
(6) : KATCH F, Mc ARDLE W (1985) : « Nutrition, masse corporelle et activité physique. », Vigot Ed., 278 p.
(7) : KRUCOFF C (1997) : Intern. Herald Tribune, Dec.18 : 11.
(8) : LEONARD W, ROBERTSON M (1992) : Am.J.Hum.Biol., 4 : 179-95.
(9) : LUDBROOK C, CLARK D (1992) : Nutr.Res., 12 : 689-99.
(10) : MARGARITIS I (1998) : IIIème rencontre médicale de triathlon, 6/6/98, Balaruc les Bains.
(10′) : NOAKES T (1994) : « Lore of running », Oxford Univ. Press : 804 p.
(11) : PAFFENBARGER R, WING A (1983) : Am.J.Epidemiol., 117 : 245-57.
(12) : PAFFENBARGER R, HYDE R (1984) : Clin.Sports Med., 3 : 297-308.
(13) : RICHE D( 1998) : « Guide nutritionnel des sports d’endurance », Vigot Ed. : 367 p.
(14) : RODE A, SHEPHARD R (1994) : Eur.Appl.Physiol., 69 : 516-24.
(15) : RODMAN P, Mc HENRY H (1980) : Am.J.Physiol. Anthropol., 52 : 103-6.
(16) : TANAKA H (1994) : Sports Med., 18 (5) : 330-9.
(17) : TAYLOR C, HEGLUND N & Coll (1982) : J.Exp.Biol., 97 : 1-21.
(18) : VIGILANT L, STONEKING M & Coll (1991) : Science, 253 : 1530-7.
(19) : WENGER H, BELL G (1986) : Sports Med., 3 : 346-56.
(20) : WILSON A, CANN R (1992) : Sci.Am., 266 : 68-73.
Denis RICHE, pour « Sport & Vie » – 2011
PHOTOS : MCC
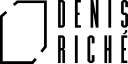
0 commentaires