FAUT-IL SE PASSER DES ANTI-INFLAMMATOIRES ?
A l’heure où les instances rechignent à alléger le calendrier des matches, une récente étude révèle, dans le milieu du foot, une épidémiologie des blessures très inquiétante.
DES CHIFFRES ALARMANTS
D’après une vaste étude menée en 2008, par le Dr Jiri Dvorak, directeur de la commission médicale de la FIFA, on peut avoir un aperçu du tribut payé par les joueurs aux blessures et bobos en tous genres (12). Ce travail ne concernait pas la recherche de produits interdits, mais cherchait plutôt à établir des statistiques de consommation de médicaments apparemment autorisés et de compléments alimentaires. L’étude se fonde sur 2944 rapports de médecins d’équipes nationales, ayant participé aux deux dernières Coupes du Monde. Ces rapports consignaient l’ensemble des médicaments et compléments alimentaires consommés lors des 72 dernières heures précédant chaque rencontre se tenant dans le cadre de ces deux événements mondiaux. On a donc une idée très précise des modes d’utilisation (et de prescription) des médicaments par l’élite du sport le plus universel e la planète. Parmi les résultats relevés, un frappe plus particulièrement les esprits ; D’abord l’ampleur du problème. 10.384 substances ont été, en tout, utilisées avant les rencontres (soit 1,8 substance par joueur et par match). Parmi ces prises, on note 4450 médicaments (soit 43% du total). A eux seuls, les anti-inflammatoires non stéroïdiens représentent plus de 20% du total. De fait, il apparaît que plus de la moitié des joueurs participant à cet événement mondial prennent des anti-inflammatoires au moins une fois pendant le tournoi et plus de 10% en consomment à chaque match (156 joueurs sur 1472). De plus, il ressort de cette étude que le niveau de performance des équipes n’était pas corrélé aux quantités d’anti-inflammatoires prescrites (encore heureux !). Par contre, plus les joueurs possédaient de temps de jeu plus, statistiquement, ils consommaient d’anti-inflammatoires. Ces données prospectives indiquent que la réalité de l’omniprésence des traumatismes dans ce sport est donc bien réelle voir la figure 1).
Il est tentant de mettre ceux-ci sur le compte des chocs subis lors des rencontres. Mais pas seulement, beaucoup de blessures surviennent en dehors des phases de jeu, et apparaissent alors davantage comme des signes de désadaptation ou de surmenage que comme la preuve de la violence de ce jeu. C’est vrai aussi dans d’autres disciplines, comme l’athlétisme par exemple. Ainsi, le récent forfait du hurdler Ladji Doucouré aux Championnats du Monde est-il dû une blessure survenue lors d’une séance de musculation, sans doute entreprise sur un état de « préfatigue » anormalement important. Les tennismen, et non les moindres, paient aussi un lourd tribut aux blessures. Rafael Nadal confiait ainsi lors de l’interview accordée le 10 juin dernier avant Wimbledon : « Cela fait plusieurs mois que je joue avec des douleurs aux genoux et je ne peux simplement pas continuer comme ça. La douleur limitait certains de mes mouvements de mon corps, et ça m’a affecté mentalement aussi ». Nadal. Pour sa part, le médecin de la Fédération espagnole de tennis, le docteur Angel Ruiz-Cotorro, a déclaré que Nadal avait une tendinite aux deux genoux. « Cela fait près d’une année que je prends des anti-inflammatoires quotidiennement », a poursuivi le prodige ibérique. « Cà ne pouvait pas durer ainsi ».
Dans le foot, comme dans l’ensemble des disciplines pratiquées au plus haut niveau, les cadences infernales semblent expliquer ces statistiques impressionnantes. Les conclusions de l’étude diligentée part la FIFA font d’ailleurs écho à d’autres chiffres, mis en avant par la presse au moment où éclata l’épidémie de cas de « S.L.A » chez d’anciens joueurs du Calcio (*). Une récente enquête prospective révèle d’ailleurs que 86% des joueurs du championnat transalpin confessent être des utilisateurs réguliers d’anti-inflammatoires (11). La prise est-elle préventive, curative, les deux à la fois ? Difficile à dire ; toujours est-il que ces chiffres corroborent l’idée d’une épidémiologie des blessures mal prise en charge par les instances internationales.
LE DENI MATIN, MIDI ET SOIR
Cette prépondérance des anti-inflammatoires, ne constitue pas l’apanage exclusif des joueurs de foot, et ne résulte pas seulement des agressions subies par l’entremise des crampons adverses. Voyons ainsi les statistiques relevées dans des disciplines où les coups et les chutes sont rares. Par exemple, des données plus anciennes révélaient ainsi que, sur des Ironmen, près de 45% des partants révélaient avoir consommé des anti-inflammatoires avant le départ de l’épreuve (14). A titre préventif, par crainte de souffrir ? Par prudence, face à ces petits bobos apparus lors de la préparation très lourde. Il semble évident que pour mener à bien un tel projet le candidat à l’Ironman ou au marathon accumule les micro-traumatismes qui peuvent mettre en péril le projet sportif. Or, autant un match raté peut être suivi, une à deux semaines plus tard, d’une reprise de la compétition, autant déclarer forfait juste avant une épreuve d’ultra peut repousser aux calendes grecques la réalisation du projet, de sorte qu’on préfère parer au plus pressé et être coûte que coûte au départ. Les charges de travail nécessaires sont par ailleurs telles que, très vite, l’idée de faire sauter une ou deux séances ou de couper complètement pendant une semaine est synonyme, pour beaucoup, d’espoirs ruinés. D’où l’acceptation de plus en plus largement répandue d’un entraînement effectué sur de la fatigue ou sur une douleur. La prise d’anti-inflammatoires se banalise alors au moindre pépin la moindre douleur, et le rituel des petites pilules avalées matin, midi ou soir se banalise.
Si on se place dans une perspective beaucoup plus large, on devrait plutôt considérer que la blessure n’est pas « la faute à pas de chance »… mais au contraire l’aboutissement d’un long déni. La plupart des sportifs la vivent comme une fatalité ou comme un élément imprévisible qui les frappe injustement. Ils sont, de fait, rendus complètement aveugles face aux petits signes que leur corps a pu leur adresser au préalable. Ainsi, pour qu’un sprinteur se blesse au cours d’une séance de musculation, ce qui ne va pas de soi il faut, pour comprendre et prévenir, plutôt regarder la vulnérabilité et les antécédents que de s’interroger sur une possible mauvaise exécution, dans une salle remplie d’appareils, d’un geste mille fois répété. Or, dans le cas de Doucouré, nos confrères de l’Equipe ont recensé pas moins de 12 blessures au cours des cinq dernières années (**). Le problème de fond reste donc, à ce jour, irrésolu.
Peut-être faudrait-il plutôt considérer que la récidive survient quand les capacités d’adaptation sont dépassées. C’est alors toute l’approche qu’il faudrait revoir, y compris la gestion de l’alimentation et du repos.
(*) : Parmi les causes suspectées on a ainsi parlé de la surconsommation d’anti-inflammatoires parmi les futures victimes de la SLA, sans qu’on sache clairement quelle était la nature du lien à établir, si lien il y a avait.
(**) : « L’Equipe », 5 août 2009.
LA SOLUTION SE TROUVE DANS LES MEMBRANES
La plupart des différentes classes de médicaments destinées à combattre l’inflammation agissent en freinant la production de certaines molécules plus particulièrement impliquées dans son amplification. Ces dernières appartiennent à la famille des prostaglandines « pro-inflammatoires ». Rappelons que, à partir des acides gras des lignées « oméga 6 » et « oméga 3 », nos tissus fabriquent des dérivés qui, pour les uns sont plutôt pro-inflammatoires et, pour les autres, plutôt anti-inflammatoires. Comment cela se passe-t-il ? Dès que la cellule subit une agression, des signaux sont émis et parviennent notamment à une enzyme, la « phospholipase A2 », qui se trouve activée. Celle-ci agit spécifiquement sur les acides gras polyinsaturés qu’elle rencontre dans les membranes de ces cellules. Elle peut ainsi reconnaître comme substrats des molécules dont les noms abrégés (par commodité), sont DGLA, EPA ou encore agir sur un autre de ces acides gras polyinsaturés, l’acide arachidonique. Son rôle consiste à les en détacher pour les rendre disponibles pour d’autres enzymes qui, elles, élaborent véritablement les prostaglandines et autres prostacyclines ou thromboxanes (qui sont des molécules apparentées). Les noms de ces molécules, qui forment la grande famille des « eicosanoïdes », dépendent du type de tissu où on les synthétise. On parle de prostaglandines lorsqu’on les élabore dans les cellules somatiques, de leucotriènes lorsque la synthèse se fait dans les globules blancs, ou de thromboxanes lorsque les molécules actives se forment dans les plaquettes. En matière d’inflammation, la classe la plus importante est celle des prostaglandines. Ces secondes enzymes, qui prennent le relais de la « phospohlipase A2 », sont très étudiées dans la pharmacologie de l’inflammation. Elles se nomment les « cyclooxygénases », nom barbare abrégé sous le terme « COX ». Nous y revenons plus loin.
Si ces différentes familles d’acides gras polyinsaturés (« oméga 3 » et « oméga 6 ») cohabitaient en proportions harmonieuses, l’activation de l’enzyme arracheuse, la phospholipase A2, se solderait par une synthèse à des taux équilibrés des dérivés pro-inflammatoires (les prostaglandines de la série 2) et de ceux dotés d’effets anti-inflammatoires (les séries 1 et 3). Les dérivés de la série 2 sont formés à partir de l’acide arachidonique, sous l’effet d’enzymes nommées les « COX 2 ». Ces enzymes sont la cible de médicaments spécifiques, les « anti-COX 2 » (*). A l’inverse, les dérivés de la série 1 (plutôt anti-inflammatoires) dérivent de l’acide di hommo-gamma-linolénique (abrégé DGLA) alors que les dérivés de la série 3 sont issus de la transformation de l’EPA via l’action des « COX 3 ». Ces trois molécules sont difficilement fabriquées, et leurs taux fluctuent essentiellement en fonction de nos choix alimentaires. C’est là que les ennuis commencent ; en effet l’EPA, dans notre alimentation, provient surtout des poissons bleus, plus rarement des viandes (celles de la filière « Bleu Blanc Cœur » nourries au lin), des gibiers ou des œufs « oméga ». Pour sa part, dans le contexte de l’alimentation moderne, l’acide arachidonique se trouve dans la plupart des aliments d’origine animale. Quant au DGLA, seules quelques plantes peu utilisées dans notre alimentation, telles que l’onagre ou la bourrache, en fournissent un peu. Bref, on perçoit déjà que nos choix alimentaires spontanés et les changements introduits par l’industrie agro-alimentaire ne vont pas dans le sens d’un équilibre correct entre ces différentes familles. Les dérivés de la série 2, pro-inflammatoires, ont tendance à largement prédominer. Il s’ensuit que des dérivés « pro-inflammatoires » risquent d’être majoritaires, ce qui va amplifier et pérenniser l’inflammation.
(*) : On leur attribue des dégâts « collatéraux » moins importants que ceux dus aux anti-inflammatoires de première génération.
COMMENT AGISSENT LES ANTI-INFLAMMATOIRES ?
Historiquement, l’aspirine (dont le principe actif est l’acide acétyl-salicylique, dérivé d’un des constituants de la saule) a été le premier anti-inflammatoire employé à vaste échelle. C’est en 1937 que le chercheur américain John Vane démontra, à l’aide d’une méthode de dosage biologique très fine pour l’époque, que cette molécule inhibait la synthèse des prostaglandines, en agissant essentiellement sur les COX. En inhibant ces enzymes elle permet de réduire la production des prostaglandines des séries 1 et 2, mais n’a pas d’action sur les dérivés de l’EPA ; Autrement dit, elle bloque beaucoup plus la synthèse des dérivés pro-inflammatoires que de ceux à action anti-inflammatoires. La confirmation de cet effet fut apportée en 1963 par un autre physiologiste, Henri Collier, qui démontra de plus que son action s’exerçait aussi à l’encontre des prostaglandines présentes au niveau de la paroi gastrique et de la muqueuse intestinale, où elles jouent un rôle protecteur. En quelque sorte, une meilleure compréhension des mécanismes d’action avait permis de mettre le doigt sur un effet secondaire redouté du corps médical et des utilisateurs chroniques de l’aspirine. De par son action ciblée sur les COX 1 et COX 2, elle reste un médicament relativement sélectif, mais doté d’une puissance pas toujours suffisante pour enrayer totalement le processus. L’aspirine diffuse rapidement dans l’ensemble de l’organisme, et son élimination varie beaucoup en fonction des doses données. Sa rapidité d’intervention est la clef de son efficacité. Par contre, une légère augmentation des doses administrées peut engendrer une très forte élévation de sa concentration sanguine, ce qui expose, pour des prises supérieures à 4 grammes par 24 heures, à un risque d’accident par surdosage.
Une autre molécule figurant au hit-parade des anti-inflammatoire, notamment en phase aigüe, est la cortisone. Cette molécule de la famille des stéroïdes exerce un champ d’actionS beaucoup plus étendu. Cela tient à la nature même de son intervention. Le dérivé hormonal se lie directement à un récepteur localisé dans le cytoplasme. Le complexe va alors de positionner sur le noyau et influer sur la lecture de certains gènes. Si l’acide acétyl-salicylique agit comme « inhibiteur » sur l’enzyme, la cortisone agit pour sa part sur les gènes dont dépendent certaines protéines. Cela la dote d’un grand nombre de cibles différentes, d’une aptitude à influer sur divers mécanismes en jeu dans l’inflammation, et pas seulement sur le contrôle de la synthèse des prostaglandines. Cela donne une réelle amplification de son effet, et explique son incroyable succès dans toutes les poussées inflammatoires, dans les maladies auto-immunes, mais aussi dans toutes les situations mettant directement en danger la vie de l’individu.
Concrètement, Les conséquences sont beaucoup plus nombreuses, sur le plan moléculaire, qu’avec l’aspirine. La prise de cortisone provoque une inhibition de la perméabilité vasculaire phénomène qui, habituellement, permet le recrutement des globules blancs vers le site de l’inflammation et contribue à l’embrasement du processus. Elle inhibe l’expression de la cytokine pro-inflammatoire qui se nomme l’IL-1. Cela signifie que la lecture de son gène, nécessaire à l’augmentation du taux d’IL-1 dans la cellule (et au recrutement des lymphocytes en jeu dans l’inflammation), se trouve altérée. Elle inhibe spécifiquement la production des prostaglandines de série 2, et inhibe également l’activité de la « phospholipase A2 ». De ce fait, au pays des prostaglandines pro-inflammatoires, c’est le désert total. Et ce n’est pas tout, elle est encore capable de bloquer la sécrétion de plusieurs cytokines mises en jeu dans le cadre de l’inflammation : l’IL-1, l’IL-6 et le TNF-alpha. Enfin, elle inhibe la prolifération des lymphocytes B et exerce un effet immuno-suppresseur à l’encontre des lymphocytes T. A court terme, cela court-circuite l’implication des globules blancs dans l’inflammation. Mais à long terme, la prise chronique de cortisone peut provoquer un état de profonde dépression immunitaire, à même de favoriser, chez des sujets prédisposés, la survenue d’un cancer. Laurent Fignon ne nous contredira pas sur cette question…
Récemment, le corps médical a développé des anti-inflammatoires non stéroïdiens susceptibles de ne pas présenter autant d’effets délétères sur la muqueuse intestinale, ceci en affinant de plus en plus leur impact. Désormais, on vise spécifiquement les « COX 2 », en laissant quasi intact le fonctionnement des COX 1 et COX 3. Conséquence ? Plus d’effet pro-inflammatoire, mais maintien d’une tendance anti-inflammatoire. Une autre innovation est en cours de développement avec le « varespladib ». Il s’agirait, selon les informations recueillies sur le Lancet du 21 février 2009, d’un puissant inhibiteur de la « phospholipase A2 ». Son administration se traduirait par l’absence de tout précurseur des COX, qu’elles fussent 1, 2 ou 3. Avantage : Pas d’inflammation et surtout pas de dépression immunitaire, ni d’effets propres aux corticoïdes, obligeant l’observance stricte d’un régime sans sucre ni sel. Inconvénients ? Sans doute nombreux, puisque l’effet anti-inflammatoire des dérivés des séries 1 et 3, maintenu sous aspirine ou cortisone, n’existerait plus dans ce cas-là. C’est ce qui explique que les études cliniques sont encore insuffisantes pour tenter d’évaluer son intérêt en thérapeutique.
IL EXISTE DES ALTERNATIVES
La connaissance des molécules en jeu dans l’inflammation explique les avantages réels que procurent certaines alternatives thérapeutiques, souvent qualifiées de « douces ». Leur intérêt existe plutôt en cas d’inflammation modérée ou chronique. Elles ne sauraient se substituer à la cortisone en cas de poussée inflammatoire violente ou de toute autre situation ou le pronostic vital se trouve engagé à très court terme. Elles représentent par contre une alternative intéressante dans toutes les situations où, passée la crise violente –comme dans la polyarthrite rhumatoïde ou la Maladie de Crohn par exemple, on propose habituellement un protocole de corticothérapie au long cours, à doses dégressives, prudemment diminuées au fil du temps, mais susceptibles de provoquer un état de déficit immunitaire durable, surtout s’il s’y associe d’autres médicaments tels que les inhibiteurs du TNF-Alpha (« Imurel » par exemple) ou carrément des inhibiteurs de la synthèse des acides nucléiques, comme le « méthotrexate », ce qui peut accentuer cette dépression immunitaire.
Quelles sont ces alternatives ? On peut d’abord « orienter » l’action de la phospholipase A2, et de là celle des COX en augmentant les apports en EPA (compléments d’huiles de poisson) de DGLA (huiles d’onagre ou de bourrache) ou une association des deux, à des taux supérieurs à ce que délivre habituellement l’alimentation. Cela permet peu à peu de modifier la répartition entre les différentes familles d’acides gras polyinsaturés dans les membranes cellulaires, et d’obtenir davantage de dérivés 1 et 3, dotés d’effets anti-inflammatoires (9, 10). Il est également possible d’avoir recours à des molécules comme la curcumine, très appréciée en médecine ayurvédique, et qui fait l’objet d’un nombre considérable de publications. Ce constituant est capable, à l’instar de la cortisone d’interagir avec des gènes et de freiner l’expression de certains acteurs de l’inflammation. La curcumine, pour sa part, n’a pas d’impact défavorable sur l’immunité (9), et n’a pas d’effet hormonal nécessitant de suivre un régime sans sel ni sucre, contrairement à la cortisone. Ainsi, il paraît tous les mois des thèses mettant en exergue son intérêt en pratique médicale dans ce contexte. Les adeptes de la phytothérapie, notamment avec le recours aux « extraits de plante standardisées », peuvent y marier avec bonheur la saule (heureux retour vers l’histoire) où d’autres plantes comme la scrofulaire ou le cassis, elles aussi dotées d’effets inhibiteurs à l’encontre des COX ou de la phospholipase A2. La grande différence avec les médicaments est leur facilité d’élimination par le foie, et de beaucoup moins importants effets secondaires (ce qui s’explique par un meilleur métabolisme des principes actifs de ces plantes). Enfin, certains extraits de plantes contiennent des modulateurs des « Heat Shock Proteins » (abrégées « HSP » et désignées sous l’expression « protéines du stress »). Ces « HSP » jouent un rôle majeur dans le contrôle de l’inflammation et dans l’aptitude à freiner sa propagation. Leur apport (sous forme de compléments) dans le cadre d’une corticothérapie ou au tout début d’un épisode inflammatoire va alors se révéler très précieux.
Pour résumer, à côté des traitement médicaux classiques, il existe des approches permettant de moduler l’inflammation, par des dérivés d’acides gras (les précurseurs des prostaglandines des séries 1 et 3) mais aussi par d’autres mécanismes (**), par des modulateurs des HSP, par l’apport de curcumine, et enfin par l’utilisation de certaines plantes telles que la saule, le cassis ou la scrofulaire (entre autres), qui renforcent l’action des thérapies classiques, et permettent d’en diminuer la durée et la posologie, et donc leurs effets secondaires.
(**) : Il existe une autre famille de molécules dotées d’effets anti-inflammatoires, tirées des acides gras de la lignée « oméga 3 ». Il s’agit des familles des résolvines ou des « protectines », qui interviennent pour interrompre ou « résoudre » l’inflammation. Elles sont tirées de l’autre acide gras à longue chaîne, le DHA, doté par ailleurs d’une multitude d’actions favorables sur notre organisme.
C’EST QUOI, L’INFLAMMATION ?
L’une des manifestations récurrentes des blessures chroniques (qui traînent) ou des récidives est incontestablement la présence d’une inflammation. Ainsi est-elle souvent perçue comme un fléau, d’où l’idée logique (dans ce contexte) de prescrire des anti-inflammatoires au moindre signe évocateur : douleur, rougeoiment, gonflement, chaleur. Ce recours s‘inscrit dans cette stratégie visant écourter la durée d’immobilisation du sportif. L’objectif recherché est d’arrêter le plus vite possible l’inflammation. En effet, une idée reçue fait qu’on la voit comme un phénomène uniquement néfaste et globalement inutile, puisqu’il restreint l’athlète dans ses aptitudes, et empêcherait l’optimisation d’un entraînement de haut niveau, où le « biquotidien » est de plus en plus souvent proposé comme modèle de progression. De plus, beaucoup d’entraîneurs pensent que l’inflammation peut provoquer deux types de problèmes. D’abord, elle serait le prélude à la blessure. D’où l’intérêt porté par certains coaches pour les bains de glace immédiatement après l’effort. En arrêtant l’inflammation, cette pratique réduirait, à leurs yeux, le risque de blessure. On verra plus loin que c’est plutôt l’inverse qui se produit lorsqu’on court-circuite l’inflammation ou qu’on nie son existence en faisant « comme si » elle n’existait pas, en maintenant les mêmes charges de travail. L’autre problème suspecté concerne la durée de récupération. Si l’inflammation survient, elle crée une gêne, un inconfort, voire une douleur, qui limitent la possibilité de cumuler les sollicitations. Par exemple, le pic de douleur survenant après un effort de longue durée, comme en course à pied, culmine 48 h après en avoir fini. Ce sont les fameuses « DOMS » (Delayed Onset Muscular Soreness), qui résultent des dégâts apparus lors de l’effort, et que les processus inflammatoires visent à réparer. Quasi impossible de courir ce moment-là ! Si l’inconfort est jugulé, l’athlète peut se réentraîner normalement beaucoup plus tôt. Dommage ! En effet, la douleur et l’inconfort qui accompagnent ce phénomène ont un double intérêt : Elles signalent que la réparation survient, et elles restreignent les possibilités d’effort réalisés en même temps, ce qui rend cette réparation, finalement, plus efficace (5).
On devrait donc, en théorie, accepter l’existence de cette période d’inactivité ou d’activité réduite, et la voir comme une phase utile, nécessaire la reconstruction des tissus lésés. L’exemple de cette adaptation est apporté par la réalisation de séquences de course rapide effectuées en descente. Elles ont come conséquence d’occasionner des lésions au niveau des fibres, du fait que cet effort fait largement appel des contractions dites « excentriques » (le muscle doit se contracter au moment où il subit un étirement, et cette double contrainte occasionne des micro-lésions). Or, une fois la douleur dissipée et la réparation réalisée, est-il possible de supporter des contraintes « excentriques » plus importantes que celles subies lors d’une première séance (5). Par exemple, on supportera des vitesses et des durées de course en descente plus importantes. Grâce à l’inflammation et la réparation qui l’a accompagné.
Cette période d’activité allégée, propice l’assimilation est pourtant jugée « contre-productive » aux yeux de plus en plus de coaches et de dirigeants, qui ne paient pas leurs athlètes et leurs joueurs pour qu’ils se reposent. Ainsi, d’aucuns considèrent, dans le sport moderne, que la réalisation de séances rapprochées, voire réalisées en état de « préfatigue », contribueraient à la progression. Et cet objectif impose des cadences qui obligent composer avec l’inflammation, voire la masquer dans le but hypothétique de rendre la préparation plus performante. Il s’agit d’un contresens. En effet, l’inflammation constitue, à l’origine, un phénomène physiologique. Elle s’inscrit dans les mécanismes de protection dont l’objectif est double : réparer les structures tissulaires qui peuvent l’être et éliminer ce qui ne fonctionne plus ou présente trop de dégâts. Pour cela, le système immunitaire se trouve sollicité, dans la mesure où, au niveau des cellules lésées, des éléments « anormaux » se trouvent libérés et suscitent une réponse instantanée. Ainsi, l’immunité repose sur les barrières naturelles et sur la mise en jeu d’une réaction inflammatoire précoce à toute agression quelle qu’en soit la cause (physique, chimique, infectieuse, tumorale, auto-immune, etc.). Cliniquement quatre signes caractérisent l’inflammation : rougeurs, chaleur, gonflement et douleur. Pour schématiser, on peut résumer cette « logique » d’intervention en affirmant que c’est un mal pour un bien (9).
POURQUOI CA DURE ?
On tend à confondre cette inflammation « utile » avec l’inflammation chronique, ennemie du sportif, celle qui s’instaure et traîne, et occasionne des arrêts d’activité. Or, elle n’a rien à voir. Elle devient chronique pour des raisons bien précises ; habituellement, l’inflammation comprend trois étapes. L’initiation, l’amplification et la résolution. Cette dernière correspond au retour à la normale. Quand tout se passe bien, l’inflammation, et les symptômes qui l’accompagnent régressent dans un court délai. On peut illustrer ceci avec les lésions musculaires liées à la course à pied. Du fait qu’elle comprend des contractions excentriques, elle s’accompagne de micro-lésions, apparaissant en cours d’effort. L’initiation de l’inflammation se fait à l’arrêt, le processus culmine 48 h plus tard (avec les fameuses « DOMS » tant redoutées des marathoniens), avant de disparaître peu à peu, au point que l’athlète bien préparé pourrait (en théorie) supporter un nouvel effort musculaire dans la semaine. Or, sans cette inflammation les tissus endommagés ne se régénèreraient pas. Sans inflammation, pas de réparation. A fortiori, grâce à ce phénomène, on reconstruit en « plus dur ». Vouloir écourter (sinon supprimer) ce mécanisme, au prétexte de pouvoir enchaîner des séances dans un laps de temps plus court, est une grossière erreur. Car en niant la réalité de ces délais physiologiques, avec l’impression trompeuse d’agir de manière cohérente (l’athlète n’a pas mal aux membres), on expose au risque de blessure. D’ailleurs, de récentes données confirment que la prise d’anti-inflammatoires allonge la durée nécessaire la cicatrisation des tissus, comparativement d’autres méthodes telles que les ultrasons par exemple (13).
Chez un sportif de haut niveau, notamment dans le football ou le rugby, confronté à des blessures récurrentes, on conçoit que les contraintes du calendrier puissent jouer un rôle certain, d’autant que dans l’intervalle situé entre deux rencontres viennent souvent se greffer des séances avec opposition ou avec un engagement physiologique non négligeable. Même sans prendre des tampons, un rugbyman qui s’entraîne régulièrement subir des dommages. Ainsi, un joueur de 100 kg qui court quasi quotidiennement casse des fibres, forcément. Au point qu’on puisse s’interroger, dans cette discipline, sur le bien-fondé de la prédominance de la course à pied comme forme de préparation aérobie. Néanmoins, la biologie vient tempérer cette analyse. Dans le cadre du suivi en biologie et micronutrition menée auprès des sportifs de haut niveau, on dispose d’un intéressant marqueur, la « CRP ultra-sensible », qui nous informe sur l’existence éventuelle d’une inflammation aigüe ou chronique. Comme on l’a évoqué dans le dernier numéro, ces investigations ont été menées simultanément en juillet 2007auprès d’une équipe du Top XIV et auprès d’une équipe de foot de Ligue 2. On aurait pu s’attendre, alors que les rugbymen entreprenaient un gros travail foncier durant la longue trêve imposée par la préparation de la Coupe du Monde, à ce qu’ils présentent davantage d’anomalies sanguines en rapport avec l’inflammation que les footeux qui sortaient de la coupure estivale. Or, on a constaté l’inverse. Sans doute grâce à la véritable période de régénération dont ont pu bénéficier les joueurs de rugby, deux à trois semaines de « vraie » coupure », ils ont eu le temps de « réparer ». Certes, 38% des joueurs présentaient une valeur de la CRP us supérieure à la norme. Mais les 2/3 des joueurs de foot étaient, au même moment dans ce cas. Sans avoir pris de coups dans le feu de l’action, ni avoir couvert un kilométrage de marathonien. Alors quoi ? La faute à une trêve moins longue sans doute.
Des données récemment publiées, et portées notre connaissance le jour de la parution du dernier numéro de « Sport & Vie », corroborent cette tendance (6). Le professeur Simon Reinke, cardiologue du centre hospitalo-universitaire de Berlin, s’est intéressé aux séquelles biologiques « invisibles » causées par la pratique sportive intensive, et aux possibilités de prédire les conséquences, à terme, sur la santé des athlètes. Leur travail a consisté mesurer l’état d’inflammation et le stress oxydatif enduré par dix joueurs de Bundesliga, juste en fin de saison, durant la coupure et lors de la phase de reprise. Reinke et ses collègues ont noté que, en réponse aux contraintes du Championnat, les muscles présentaient une hypo perfusion et que ce processus s’inversait durant la période de repos, ce qui aboutissait un stress inflammatoire et un turnover des protéines tous deux augmentés. Les scientifiques allemands ont notamment montré que le taux d’IL-8 (cytokine pro-inflammatoire) s’accroissait de 50% durant la phase de repos et persistait un niveau supra normal durant toute la période préparatoire au nouveau championnat. Pour Reinke et ses collègues, ces données, bien qu’obtenus sur un effectif restreint, laisseraient à penser que lors de la préparation d’avant-saison les joueurs créent des conditions propices une blessure ultérieure. Si après une longue période sans traumatisme, axée sur le repos, la majorité des représentants des sports collectifs, au plus haut niveau, présentent une inflammation supérieure la normale, c’est que d’autres phénomènes contribuent à la pérenniser, à la faire flamber, au point de la rendre chronique.
L’HUILE SUR LE FEU
Il existe en fait des facteurs susceptibles d’aggraver l’inflammation. Pour deux raisons ; la première c’est que, comme pour d’autres processus physiologiques, l’inflammation met en jeu des « messagers », et que ceux-ci dérivent de constituants tirés de notre assiette. On devine donc que d’éventuels déséquilibres pourraient contribuer à ce que se perpétue cette situation. La seconde, c’est qu’il peut y avoir un second foyer d’inflammation, à distance, de sorte que les mécanismes enclenchés par chacun des deux foyers (celui situé à distance, par exemple au niveau d’une dent ou de l’intestin et celui concernant l’épaule ou le genou douloureux), s’amplifient mutuellement et finissent par se mettre en boucle. La question n’est alors plus de savoir quelle agression a pu s’accompagner d’une éventuelle lésion tissulaire, quel placage, quel raffut ou quelle béquille, chez le rugbyman, a occasionné cette inflammation chronique, mais plutôt de déceler par quelle anomalie la chronicité est apparue. Ces pyromanes moléculaires sont aujourd’hui de mieux en mieux connus et étudiés.
Le premier facteur aggravant concerne les graisses, ou plutôt un fréquent déséquilibre, biologiquement avéré, touchant l’alimentation de la plupart des sportifs. Ce point fait référence à une notion devenue familière aujourd’hui, celle de l’équilibre entre les acides gras de la lignée « oméga 6 » et ceux de la famille « oméga 3 » (4). Rappelons qu’il s’agit des représentants dans deux familles lipidiques très voisines, sur le plan chimique, indiscernables visuellement, mélangées en proportions variables dans les différents aliments qui constituent notre ration, mais sont pourtant dotés de caractéristiques opposées. On en a déjà parlé maintes reprises dans ces colonnes, mais leur importance majeure, dans cette affaire, mérite qu’on y revienne brièvement ici. Certains acides gras de ces deux lignées entrent dans la composition des membranes cellulaires. Ce sont aussi les précurseurs de substances très importantes, qui sont les médiateurs cellulaires de l’inflammation (prostaglandines, leucotriènes), de la régulation du tonus vasculaire, de l’agrégation plaquettaire (thromboxanes) et même de la réponse anaphylactique (allergie). Dans le cas qui nous intéresse ici, même s’il est de plus en plus fréquent de rencontrer des athlètes souffrant à la fois de tendinite, de sinusite et d’allergie, on s’attardera uniquement sur la situation des prostaglandines. Il en existe plusieurs familles qui dérivent d’acides gras différents. Ainsi, l’acide arachidonique, appartenant à la lignée « oméga 6 » donne naissance aux PG2, qui se présentent comme de puissants médiateurs de l’inflammation, de la vasoconstriction et de l’agrégation. Par contre, un autre acide gras de la lignée « oméga 6 », l’acide di homo gamma-linolénique (abrégé « DGLA »), et un dérivé de la famille « oméga 3 » , l’EPA, donnent naissance aux prostaglandines de séries 1 et 3 (abrégées PG1 et PG3) qui ont en commun leurs propriétés modérément anti-inflammatoire, vasodilatatrice et anti-agrégante (10).
Lors d’une stimulation de la cellule, la réponse sera entièrement dépendante de la proportion de chacun de ces acides gras membranaires. Elle est liée à deux facteurs principaux. C’est d’une part l’activité de l’enzyme clef qui permet la transformation des chefs de file en dérivés supérieurs (elle se nomme la « delta 6-désaturase »). Divers acteurs en modulent l’activité. Pour ne pas compliquer le tableau, indiquons seulement que les déficits en fer, en magnésium, la présence d’un herpès, une ingestion excessive de glucides constituent autant de situations qui contrarient le fonctionnement de cette enzyme. Pour faire simple, si elle marche bien, on a beaucoup de chance !
Ce sont d’autre part les apports alimentaires. Or, l’un des problèmes habituellement rencontrés est la prépondérance de l’acide arachidonique, au sein des phospholipides membranaires. Ceci survient aujourd’hui, la plupart du temps, en présence d’une ration « occidentale » telle que l’adoptent spontanément une majorité de sportifs. Cette prépondérance de le l’acide arachidonique n’est pas seulement la conséquence d’un flagrant délit de « délinquance alimentaire », liée à une ingestion immodérée de viande, d’œuf ou de saucisse, mais plus certainement, le résultat d’un changement brutal survenue relativement à l’alimentation animale. Pour faire simple, les « oméga 3 » contenus dans les chairs animales proviennent des planctons (pour les poissons) ou de l’herbe et du lin (pour les animaux terrestres) qu’ils avalent. L’élevage a bouleversé la donne au point que, dans les bilans réalisés en 2007, 88% des joueurs étaient déficitaires en EPA ou DHA et 79% en excédent d’acide arachidonique (9). Pléthore de pyromanes, pénurie de pompiers ! De ce fait en 2009, dans la plupart des cas, l’acide arachidonique y apparaît à un taux 20 fois supérieur à celui du DGLA. Il s’ensuit alors un déficit en éléments anti-inflammatoires… et ce de manière chronique ! Il ne reste plus qu’à mettre le feu. Dans le sport moderne, source d’inflammation, les occasions ne manquent pas.
LE MICROBE QUI MET EN ETAT D’ALERTE
Une autre source d’activités « pyromane » se trouve située dans notre intestin. L’écosystème, constitué de notre muqueuse, de notre microflore et du système immunitaire intestin, intervient comme première ligne de défense contre les agresseurs. C’est une fonction d’autant plus précieuse que notre muqueuse offre 300 m² de surface d’échange, ouverte à toutes les agressions possibles. Ce système immunitaire se montre d’une grande complexité, et il doit à la fois assurer cette défense et la tolérance vis-à-vis de nos cellules, des aliments, de notre propre microflore, du fœtus, des greffes… Bref, il s’agit d’un organe dont le fonctionnement doit faire l’objet d’une régulation très fine, régulation en grande partie dévolue à des molécules informationnelles. Celles-ci, à l’égal des neuromédiateurs du cerveau ou des hormones du système endocrine donnent un sens à la réponse immunitaire. Ces molécules se nomment les cytokines. Notre système immunitaire en fabrique en réponse à certaines sollicitations. Notre microflore possède aussi cette capacité, comme divers autres organes (notamment le muscle ou le tissu adipeux). Pour résumer, certaines cytokines élaborées à partir de notre système immunitaire ou de notre flore (en général les deux interagissent) vont déclencher une réponse immunitaire, dont l’une des conséquences est la survenue d’une inflammation. Celle-ci vise à éliminer l’ennemi. Elle dépend des mêmes mécanismes de contrôle et des mêmes acteurs que précédemment (prostaglandines, etc…). De plus, les cytokines peuvent diffuser vers les autres tissus, et leur arrivée sur le site endommagé (l’épaule, le genou, la cheville, etc…) va s’ajouter à celle déjà produites localement en réponse aux lésions liées l’activité. Cela peut être sans dégât majeur. Mais pas toujours ; dans le cas de certains antigènes (mycoses, herpès par exemple), ou en présence de fragments des membranes des bactéries de notre flore, les « endotoxines » (3), la réponse immunitaire déclenchée peut être très violente, au point de déraper. On qualifie ces situations d’états de « dysfonctionnements immunitaires » (1). Le lien empirique établi entre problèmes dentaires et blessures peut s’inscrire dans ce cadre. Dans ce contexte, non seulement l’inflammation devient chronique et amplifie celle liée à l’agression du tissu articulaire ou tendineux, mais de plus elle porte sur la muqueuse intestinale, qui laisse alors passer dans la circulation des macromolécules qui, leur tour, vont déclencher une réponse immunitaire en raison de leur nature chimique. Les réponses adverses certaines protéines alimentaires apparaissent dans ce cadre, souvent secondairement à cette perméabilité. Il s’agit par exemple de protéines alimentaires devenues « complices » de l’inflammation. Elles peuvent alors aller se déposer sur un tissu (comme une BMW immatriculée en Colombie, s’arrêtant sur une aire d’autoroute avec 600 kg de bagages). Le système immunitaire agit alors comme les Brigades « volantes » des douanes, qui interpellent le conducteur suspect et déclenchent une réponse « inflammatoire » son encontre. C’est ce qu’on qualifie d’inflammation dite « à distance » (moi). De banale (quoique chronique) dans le cas de certaines blessures récurrentes du sportif, elles peuvent occasionner d’authentiques pathologies, à l’instar des maladies auto-immunes. Ceci explique le lien parfois constaté entre surconsommation de laitages et problèmes tendineux. Même si ce lien n’est pas de causalité, plutôt de coïncidence. Ce qui explique aussi pourquoi l’éviction drastique (et souvent trop systématique) des laitages peut aider sans résoudre totalement. Ce peut être une pièce du puzzle, mais absolument pas tout le tableau (8).
LES VEGETAUX QUI FONT GREVE
On peut encore évoquer d’autres facteurs d’aggravation éventuelle, lesquels s’expriment plus particulièrement dès lors que l’alimentation- comme chez beaucoup de sportifs- est trop pauvre en végétaux frais, fruits, légumes, jus de fruit. Deux mécanismes peuvent en découler, dans un contexte davantage ancré dans la chronicité que l’instantanéité : Ce n’est pas parce qu’on mange trop peu de fruits et légumes deux jours de suite qu’on va connaître des problèmes. C’est plus en les évitant plus ou moins jour après jour que l’impact de cette habitude funeste va s’exercer. Cela se fait sur deux plans. Le premier est lié au caractère acidifiant de la ration qui va en découler. Chaque aliment possède un potentiel d’acidification de l’organisme (ou inversement, pour quelques-uns, d’alcalinisation), qui peut être quantifié grâce à un critère connu sous le nom de « PRAL » (abréviation de l’expression anglaise : « Potential of Renal Acid Loading ») (7). Plus le score de ce paramètre est positif, plus l’aliment acidifie. Or, en consommant trop peu de fruits, de légumes, de fruits secs de pommes de terre, et surtout trop abondamment de viande, de fromage ou de céréales, on crée un état d’acidité qui s’ajoute à celui lié à l’exercice. Celui-ci en constitue d’ailleurs un pourvoyeur d’importance variable d’un individu à l’autre. Mais toujours est-il qu’une ingestion chroniquement insuffisante de fruits et légumes crée une acidose qui sera délétère au niveau tendineux. Pourquoi ? Cela tient en grande partie à l’anatomie-même de ces tendons ; ceux-ci fonctionnent quasiment en vase clos. Ainsi, à chaque minute, ils reçoivent 0,10 cm³ de sang par gramme de tissu, soit dix fois moins qu’un muscle au repos et 200 fois moins qu’un muscle en plein effort. Ce débit ridicule diminue encore après une période d’immobilisation prolongée. D’où l’inefficacité de la méthode, pourtant répandue, de plâtrage des tendinites. Certaines parties du tendon sont particulièrement mal loties. Dans le cas du tendon d’Achille, par exemple, on a démontré l’existence d’une zone aride située entre 2 et 6 cm près de l’insertion du tendon sur l’os du talon (calcanéum). Les choses peuvent même se corser lors d’un effort prolongé, surtout si le sportif, soumis à des conditions climatiques difficiles ou naturellement peu enclin à boire, laisse s’instaurer un déficit hydrique. Quel lien avec la tendinite ? Les déchets ont tendance à s’accumuler lorsque la cellule manque d’eau. Leur concentration augmente, notamment celle de l’acide urique qui aura alors tendance à « précipiter ». Rappelez-vous ces expériences de chimie où il s’agissait d’ajouter goutte à goutte une substance réactive à un liquide contenu dans un tube à essai. Au début, les deux produits se mélangeaient harmonieusement. Puis il arrivait un moment où l’ajout d’une seule goutte du réactif changeait complètement la donne. On retrouvait alors toute la substance sous forme solide au fond de l’éprouvette. Plus question d’en solubiliser un milligramme de plus. En langage de chimiste, c’est le signe qu’on dépasse le stade de « concentration critique » au-delà de laquelle toute nouvelle molécule ajoutée favorise le processus de cristallisation. Si l’on répète cette expérience à plusieurs reprises, on s’apercevra que la quantité de réactif nécessaire à la précipitation n’est pas toujours la même. Elle varie selon les conditions de l’expérience: pression, température et aussi l’acidité de la solution. L’acide urique se solubilise moins bien dans une solution déjà acide et sa précipitation spontanée survient à des concentrations nettement plus basses, d’où la formation de micro-calculs qui vont alors constituer autant de « corps étrangers » que notre système immunitaire va attaquer et, peu enclin à l’éliminer dans un bref délai, va agresser d’une inflammation de plus en plus conséquente… qui va se chroniciser.
Le deuxième problème lié à une ingestion trop faible de végétaux frais est qu’elle s’accompagne d’une consommation souvent insuffisante d’éléments protecteurs nommés les anti-oxydants ? Quel est leur lien avec les tendinites ? Au cours des processus inflammatoires les cytokines libèrent des molécules agressives, les « formes radicalaires oxygénées » ou « radicaux libres », qui attaquent les éléments lésés ou les corps étrangers qui déclenchent leur activation. Ils sont également formés en quantité accrue lors d’efforts anormalement intenses ou rapprochés (2). Certes, l’exposition régulière ces entités très réactives déclenche des adaptations. Sous l’effet d’un stress oxydatif chronique (notamment dans la mitochondrie où il s’en forme 100 à 200 fois plus qu’au repos), certains gènes sont davantage lus, ce qui se traduit par une teneur plus élevée des protéines qui en dépendent. Les gènes en question sont ceux des enzymes anti-radicalaires. Un entraînement régulier semble donc conférer une protection accrue, condition que les cofacteurs de ces enzymes soient eux aussi présents. Il existe donc une limite à cette adaptation, variable d’un sujet l’autre, mais que des scientifiques japonais ont récemment mis en évidence. Au cours de ce travail, le professeur Hattori et ses collègues de l’Université de Nagoya, ont procédé la mesure du stress oxydatif dans le sang de 70 coureurs d’ultra nippons. Ils avaient pris part une épreuve disputée sur deux jours. Au soir de la première étape, le stress oxydatif moye était plus élevé. Comme si, ensuite, l’adaptation s’était mise en œuvre. Mais ces auteurs ont également trouvé une corrélation entre le stress oxydatif moyen et le temps mis terminer l’épreuve. Autrement dit, plus le stress occasionné augmente, plus les dégâts s’accroissent. Hattori pense d’ailleurs que le niveau de défense anti-oxydante mesuré au repos serait un élément prédictif des performances plus précis que VO2 Max ! On imagine les conséquences cde ce phénomène, en termes de blessure, si la planification des entraînements et des épreuves est mal conduite !
Revenons au cas de l’inflammation, qui aboutit une formation accrue d’entités radicalaires (2). Dans ce contexte, les radicaux libres peuvent déborder du cadre de leur mission et agresser les cellules saines ou en cours de reconstruction. Si les éléments protecteurs sont insuffisamment présents, l’agression radicalaire est incomplètement compensée et la réparation ne peut pas se faire.
A cette insuffisance en éléments végétaux s’ajoute un fréquent déficit en un autre élément protecteur très souvent déficitaire : le sélénium. Cette anomalie qui résulte de la conjonction de plusieurs phénomènes, dont une consommation éventuellement insuffisante de viande, volaille et poisson. La culture alimentaire varie fortement d’un sport l’autre, et on imagine volontiers rencontrer davantage de rugbymen carnivores que de marathoniens viandards ! Pour autant, cette culture ne met pas forcément les adeptes de l’ovale l’abri d’un déficit en cet élément. En effet, l’une des clefs permettant d’assurer la satisfaction des besoins en sélénium est la richesse des sols où poussent les plantes dont on se nourrit ou dont on nourrit les animaux que nous mangeons. En France, la rareté de nos sols en cet élément ne les met pas pour autant à l’abri de ce déficit (9), d’où l’importance d’une évaluation biologique du statut en Se, d’autant qu’il joue un rôle protecteur crucial vis-à-vis du risque de cancer.
En conclusion, quand on cherche optimiser le contenu de l’assiette dans une logique de prévention de la blessure, on peut envisager une approche globale de l’inflammation qui peut, selon les éléments recueillis sur les questionnaires fonctionnels, les habitudes alimentaires, la stratégie hydrique à l’effort ou au repos, la biologie, les antécédents immunitaires personnels et familiaux, être véritablement personnalisée et efficace. Elle pourra, selon les circonstances, reposer sur des apports alimentaires ajustés, une stratégie hydrique adaptée, et éventuellement une complémentation ciblée, portant sur les différentes options possibles. Il s’agit, en cette fin d’été 2009, d’une approche encore clairement avant-gardiste.
BIBLIOGRAPHIE
(1) : CATER II RE (1995) : Med.Hyp., 44 : 507-15.
(2) : HATTORI N, HAYASHI T & Coll (2009) : Int.J.Sports Med., 30 (6) : 426-9.
(3) : HUNTER K & Coll (2001) : Activation of immune defense against infectious disease. Mode of action of beta-glucan immunopotentiators, Research summary release, Department of Microbiology, University of Nevada School of Medicine.
(4) : MAROON JC (2006) : Surg.Neurol., 65 : 326-31.
(5) : NOAKES T (2006) : “Lore of running”, Oxford Univ.Press.
(6) : REINKE S, KARHAUSEN T & Coll (2009) : Plos One, 4 (3) : 1-7.
(7) : REMER T, MANZ F (1995) : J.Am.Diet.Ass., 96 : 791-7.
(8) : RICHE D (2003) : NAFAS, 2 (3) : 17-29.
(9) : RICHE D(2008) : “Micronutrition, santé et performance”, De Boeck Ed.
(10) : RYAN M, ZIMMERMAN B (1974) : Prostaglandins, 6 (3) : 179-92.
(11) : TAIOLI E. (2007) : Br J Sports Med 2007;41:439–41.
(12) : TSCHOLL P, JUNGE A, DVORAK J (2008) : Brit.J.Sports Med., 42 : 725-730.
(13): WARDEN SJ & Coll (2006) : Am.J.Sports Med., 34 : 1094-102;
(14): WORME JD, DOUBT TJ & Coll (1990) : Am.J.Clin.Nutr., 51 : 690-7.
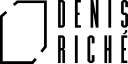
0 commentaires