Une question taraude les paléontologues et tous les spécialistes de la préhistoire. Quels facteurs ont permis l’évolution qui a abouti à un cerveau humain aussi performant ? Parmi les pistes avancées, l’une des plus solides semble être celle des « Oméga 3 », abondants dans les poissons…que notre ancêtre Lucy n’a sans doute jamais vus de toute sa vie…
DE L’OXYGÈNE ET DU GRAS :
Certains auteurs remontent jusqu’à l’ère du Paléolithique pour trouver les explications aux problèmes de santé publique qui émergent aujourd’hui. A juste titre semble-t-il, à en croire les conclusions de Loren Cordain et de ses collègues (4, 8). D’autres n’hésitent pas à s’engager pour des voyages encore plus lointains dans la machine à remonter le temps, à l’instar du professeur Michael Crawford, de l’Imperial Collège de Londres. Comprendre la biologie du XXIème siècle, nécessite, selon lui, de revenir trois milliards d’années en arrière. Impossible hélas, pour ces voyageurs téméraires, de poser un pied sur notre planète alors inhospitalière, à moins d’avoir emmené avec eux leur bonbonne d’oxygène. Pourquoi ? Parce que, comme il le souligne dans un récent article, l’air était trop pauvre en oxygène (6). Crawford considère que ce contexte permet d’expliquer que durant 2,5 milliards d’années, si peu de changement soient survenus au niveau de notre ADN. La faute à un environnement peu propice, écrit-il. Tout a changé il y a environ 600 millions d’années, moment charnière où, la pression partielle de l’oxygène ayant augmenté, des formes de vie liées à la respiration sont devenues « thermodynamiquement » possibles. Les fossiles datés de cette époque témoignent d’ailleurs de cette évolution assez rapide. Les paléontologues ont tous pointé du doigt la soudaine diversité de l’ère cambrienne, en même temps que de subtils détails devenaient perceptibles, à l’intérieur des cellules. Parmi les plus frappants, ils relevaient la présence de membranes, ce qui n’était possible que grâce à la présence de lipides constitutifs. Cette présence était indissociable, selon eux, de l’aptitude des organismes à utiliser l’oxygène et à évoluer en complexité. C’est à cette époque-là que la cellule s’est modernisé et a acquis sa structure actuelle. A l’instar d’un loft dernier cri où un espace est dévolu à la cuisine, où un autre constitue une pièce de vie, et où un troisième est dédié à la salle de bains, des frontières intérieures séparent dans des espaces bien définis les différentes activités de la cellule, le noyau, la mitochondrie, les systèmes réticulo-endothélial, bref, tous ces constituants aux noms compliqués qui font le cauchemar des élèves de biologie. Or, pour résumer la théorie de ces Britanniques, les lipides auraient joué un rôle majeur dans l’évolution de la vie.
A ce stade de leur réflexion, nos lecteurs qui n’auraient pas encore déserté doivent vraiment se demander ce que de telles considérations peuvent bien faire dans un article paru dans une revue de nutrition. Et c’est là que la réflexion de Crawford nous y ramène de manière fort originale : De tous les acides gras qui ont permis la constitution de membranes et l’utilisation de l’oxygène, l’un a plus particulièrement joué un rôle aussi prépondérant que son nom est compliqué à retenir. Il s’agit de l’acide docosohexaenoïque, qu’on pardonnera aux nutritionnistes de surnommer le « DHA ». En quoi est-il différent ? Il possède 6 doubles liaisons, ce qui lui confère l’aptitude unique d’insérer 6 atomes d’oxygène dans sa structure (5). Grâce à cette particularité, il a clairement servi à moderniser les cellules.
Sa présence dans les membranes aurait également contribué à l’émergence de nouveaux photorécepteurs, plus fins et sensibles, bien utiles pour se déplacer à l’aube, à la nuit tombante, ou pour déceler l’ombre d’un prédateur. Pour Crawford, ces photorécepteurs plus sophistiqués ont précédé l’évolution de tous les autres systèmes de signalisation de notre organisme, mais aussi de l’ensemble du système nerveux et du cerveau. Merci aux « oméga 3 » !
On sait aujourd’hui que, en plus de ce rôle structurel, ils interviennent comme éléments modulateurs de l’expression de certains gènes, phénomène désigné par le mot à la mode d’« épigénèse ». Ainsi, le DHA agit-il sur pas moins de 57 gènes différents, au niveau cérébral, et cette action s’exerce plus particulièrement durant la grossesse (16), pourvu- évidemment- que ce DHA ne manque pas à ce moment-là. Crawford prend l’exemple des grands mammifères et des singes de la savane africaine pour appuyer sa théorie : Une brutale chute du taux de DHA dans le cerveau de ces animaux, confrontés à une évolution de leur écosystème sus la pression de l’homme, a provoqué une altération de leurs capacités cérébrales, et sans doute cela a-t-il joué, au même titre que les fusils, un grand rôle dans le déclin de ces espèces (6). D’où deux questions : qu’en était-il des apports en DHA de nos ancêtres du paléolithique ? Et que penser des conclusions du chercher niçois Gérard Ailhaud (1), qui s’alarme de la chute très prononcée du rapport oméga 3/oméga 6 du lait maternel humain, tel qu’il l’a progressivement noté depuis une trentaine d’années ?
UNE DENRÉE RARE ET PRÉCIEUSE
Les études nutritionnelles menées depuis le milieu des années 70, ont conduit à populariser une idée reçue, qui comme toutes les idées reçues recèle une forte part d’erreur ; le DHA proviendrait principalement des animaux marins du fait que, effectivement, c’est dans les chairs des poissons des mers froides qu’on en a relevé les taux les plus abondants (12), et qu’il en existerait par ailleurs peu d’autres sources significatives. Avant d’aller plus loin, et de présenter les hypothèses qui en ont découlé, il n’est pas inutile d’effectuer un petit détour rapide du côté des « oméga 3 », pour mieux comprendre ce dont il retourne ici. Soulignons qu’il s’agit d’une famille d’acides gras porteurs de plusieurs doubles liaisons (on les qualifie de « polyinsaturés »), ce qui signifie qu’elles peuvent fixer plusieurs molécules d’oxygène, (comme on l’a évoqué au début de cet article). La première de ces doubles liaisons se situe au niveau du 3ème atome de carbone de la longue chaîne que constituent ces acides gras. Leurs ennemis intimes, les « oméga 6 », se caractérisent pour leur part par la localisation de leur première double liaison sur le 6ème atome de carbone. Un détail, direz-vous ? Comme le fait, pour un Coréen, de naître du côté Nord ou du côté Sud. On se retrouve alors avec des voisins qui se ressemblent mais adoptent des philosophies radicalement opposées. Ainsi, les »oméga 3 » donnent-ils naissance à des dérivés dotés d’effets anti-inflammatoires, alors que ceux issus de la transformation des « oméga 6 » exercent principalement un effet pro-inflammatoire.
Revenons à nos « oméga 3 ». Le chef de file est une molécule dite « essentielle », ce qui signifie qu’on ne peut pas la fabriquer. Il s’agit de l’Acide Alpha-Linolénique (ALA), à partir duquel les mammifères élaborent d’autres molécules comme le DHA. Ce dernier, si vous nous suivez toujours, peut de ce fait provenir soit de la transformation de l’ALA par nos tissus, soit directement de l’apport de DHA par certains aliments qui en contiendraient, en particulier les poissons bleus. Cette nuance est importante lorsqu’on envisage les théories en vigueur sur l’évolution.
L’acide alpha-linolénique, qu’on trouvait à des taux élevés dans le sang des Crétois à la fin du siècle dernier (avant Homo Sapiens Macdonaldus), est apporté par certaines plantes comme le lin, le pourpier, les noix. Or les poissons bleus n’en mangent pas. Alors comment fabriquent-ils le DHA ? Comme l’explique le scientifique rennais Pierre Weil dans son ouvrage « Tous gros demain ? » (19), ils l’élaborent à partir du plancton (source d’ALA), mangé par le poisson mangé par le poisson, et ainsi de suite… et converti par la machinerie métabolique de ceux-ci en DHA. Si on suit le cheminement, pour être à l’abri du manque et optimiser le développement de notre matière grise, il nous suffirait de faire dans nos cellules, avec ces espèces végétales, la même chose que ce que les animaux marins réalisent avec le plancton : fabriquer du DHA. Hélas, contrairement aux espèces marines, l’Homme serait moins efficace dans cette opération… d’où la conclusion apparemment évidente avancée par le Canadien Stephen Cunnane, du Centre de Recherche sur le Vieillissement de Sherbrooke : selon lui, sans apport de produits marins, le cerveau de l’Homme n’aurait pas pu atteindre le développement actuel (7).
CE N’ÉTAIENT PAS DES « PÊCHEURS- CUEILLEURS »…
A ce stade de l’article la position de Stephen Cunnane, sans doute amateur de pêche au saumon dans les grands lacs du Canada, semble incontestable et, en regard des reportages alarmistes diffusés par « Thalassa » sur l’épuisement des ressources piscicoles, on peut se demander si l’évolution ne pourrait pas repartir en sens inverse. Ce serait faire fi d’autres données, et des travaux extrêmement sérieux que conduit depuis des années Ben Carlson. Il n’hésite pas à mettre les pieds dans le plat et à rappeler certaines évidences. D’abord sur l’accès au poisson ; bien qu’étant capables de marcher sur de longues distances (jusqu’à mille km par an selon les estimations, voir l’article de GG), ces populations n’en étaient pas moins limitées dans leurs déplacements, au point, très certainement, de ne pas avaler les 300 à 400 g hebdomadaires de poissons bleus que nous recommandent nos experts. Dans certaines régions reculées, il se peut même que nos ancêtres n’aient jamais vu la mer. Pour expliquer ce paradoxe, il tord le cou à une seconde idée reçue. La prépondérance du poisson comme source d’oméga 3 constitue une réalité contemporaine, mais qui n’a pas plus de 4 générations d’ancienneté. Tout a basculé au cœur des années 70, comme l’a révélé Pierre Weil au grand public en se référant à l’exemple de la France (très représentatif de ce qui s’est passé partout, ces années-là, dans le monde occidental : A cette époque, de plus en plus de Français ont mangé de plus en plus de fromage. Il a fallu davantage de lait l’hiver, de manière à répondre à cette demande accrue. Or, jusque à ces années-là, l’essentiel de la production de lait s’effectuait au printemps. En cette saison, les vaches trouvaient des les prés l’herbe grasse (riche en « oméga 3 »), qui leur permettait de synthétiser un lait de qualité. Le vêlage se faisant au printemps, les vaches produisaient beaucoup moins de lait ensuite.
Pour contourner ce problème, l’industrie laitière a pu compter sur la « révolution fourragère », survenue en même temps qu’une plante a connu un important essor sur notre sol : le maïs. Comme l’explique Pierre Weil, dans les années d’après-guerre, la France vise à assurer son autosuffisance alimentaire. La culture du maïs remonte progressivement vers le nord et conquiert les régions d’élevage. A la même période apparaît l’ensilage, qui permet de conserver des fourrages. La plante va, grâce à cet ensilage, pouvoir être distribuée toute l’année aux vaches dont, simultanément, la période de vêlage va être décalée vers l’automne. L’essentiel de la production laitière surviendra alors l’hiver, au moment où les vaches se nourrissent de maïs et non plus d’herbe. Mais c’est là que le bât blesse. « Il y a juste un petit problème, explique le Pr Weil. Dans l’herbe grasse, il y a beaucoup de graisses qui appartiennent à la famille « oméga 3 ». Dans le grain de maïs, il y a des graisses aussi, mais de la famille « oméga 6 ». Anciennement, l’hiver, on donnait du lin aux vaches. Or cette plante se caractérise par sa richesse en « oméga 3 » (19).
En une trentaine d’années, ces changements dictés par la pression économique ont eu des effets dévastateurs. Or, à l’époque du paléolithique, point de silo, ce qui explique que le gibier terrestre renfermât d’abondantes quantités d’acides gras « oméga 3 », y compris du DHA. Selon Carlson, elles étaient suffisantes pour permettre au cerveau de se développer, sans même avoir eu accès au thon ou à la sardine (3). Des travaux, cités par le professeur James Langdon du Département de Biologie de l’Université d’Indianapolis (13), indiquent que le lait maternel des femmes issues de populations ayant conservé un mode de vie ancestral de chasseurs- cueilleurs, nourries de viandes riches en DHA, en contenaient à des taux optimaux (*). Pour autant, aucun Prix Nobel n’est encore sorti des forêts d’Amazonie… En France, où le taux de DHA du lait maternel chute de manière spectaculaire, certains spécialistes tirent la sonnette d’alarme, à l’instar de Gérard Ailhaud. Le chercheur niçois voit plutôt d’un mauvais œil (riche en « oméga 3 ») cette dégradation du statut en DHA du lait maternel.
LA SÉDENTARITÉ A DU BON…
Avec le modèle paléolithique, qui recommande une place importante aux fruits, aux légumes, et aux viandes (voir l’article de GG), il est de bon ton de voir les céréales, les laitages et les aliments cuits comme des agresseurs potentiels, du fait que ces aliments ne correspondraient pas au registre alimentaire associé à notre capital génétique. Cette vision manichéenne de l’alimentation, permettant de ranger les denrées en deux catégories, les bonnes d’une part, et les mauvaises d’autre part, nous paraît devoir supporter deux critiques majeures : mort aux dogmes !
La première renvoie à cette notion d’épigénèse. Pour l’expliquer simplement, on peut indiquer qu’avec un même patrimoine génétique on ne va pas forcément exprimer les mêmes potentialités que son ascendance. Ainsi, certains travaux ont montré qu’après deux générations d’obèses, les descendants des survivants des camps de la mort, dotés par Dame Nature d’une aptitude à adapter un métabolisme très économe, puis confrontés d à l’abondance alimentaire, ont su ajuster l’expression de leurs potentialités génétiques pour faire face à ce changement d’environnement (9). Comment ne pas admettre que si cela a fonctionné en l’espace de seulement un demi-siècle, sur seulement trois générations, cela n’ait pas pu également se mettre en place depuis le paléolithique ? Pensez-vous qu’un pédiatre aurait pu entendre sans broncher, en 1945, répéter par une grande majorité de professionnels de lasanté que le lait et les céréales seraient dangereux pour la santé ? La mosaïque de nos gènes nous dote de cette aptitude constante au changement en réponse… aux changements ! De surcroît, cette adaptation a tout autant concerné les animaux. Les vaches du siècle dernier auraient au moins autant de mal à reconnaître leur pitance, dans leur ration journalière scientifiquement étudiée, que Sieur Godefroy de Montmirail à partager le repas de sa fillotte. Comme le notait avec justesse Jean Seignalet dans son livre « L’alimentation ou la troisième médecine » (17), pour mettre le doigt sur cette évolution très importante : »En toute rigueur, il ne suffit pas seulement de manger paléolithique. Idéalement, plutôt que du bœuf, il faudrait du taureau sauvage de Camargue.». De quoi mourir de faim en bonne santé !
La seconde amène à entrer dans les arcanes de la biologie de nos cellules. Depuis le début de cet article, nous insistons sur le rôle (avéré) de certains lipides dans l’évolution du cerveau. Mais d’autres acteurs y participent également, notamment les protéines, dont certaines exercent des rôles essentielles dans nos neurones (16). Sans leur présence, nous aurions un cerveau certes gras, visqueux, mais idiot ! Or, leur arrimage dans les membranes n’est rendue possible que grâce à l’intervention d’un acide gras, l’acide myristique, dont l’action peut se comparer à celle d’un hameçon (11). Il permet ainsi de fixer des protéines très spécialisées sur les neurones, mais aussi dans tous les replis des membranes, telles qu’on les voit dans les fossiles des premiers êtres pluricellulaires. Cet acide myristique est considéré, ainsi que de récentes publications l’indiquent, comme un acteur-clef de l’évolution de notre cerveau (11, 15). Et où en trouve-t-on le plus ? Dans les laitages (16). Indiscutablement, la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs, l’émergence de l’élevage et l’introduction des laitages ancestraux ont servi notre cerveau. Vous nous suivez toujours ?
LA PRÉFRONTALISATION DU CERVEAU HUMAIN.
Les physiologistes qui se sont mis en tête de comprendre le fonctionnement du cerveau ont successivement proposé des modèles anatomiques, fonctionnelles, voire psychanalytiques, qui sont aujourd’hui réunies dans un tout relativement cohérent avec la théorie des « trois cerveaux » de Mc Lean. Elle repose sur le concept d’une complexification croissante du cerveau au fil de l’évolution, et amène à distinguer trois parties aux rôles et origines distinctes. La plus archaïque, localisée au niveau du tronc cérébral, est le cerveau « reptilien » qui se cantonne, on l’a deviné, aux tâches les plus simples et vitales à notre survie, boire, manger, copuler. Il possède autant de conscience politique qu’un crocodile ! La seconde est le système limbique. Elle constitue une structure un peu plus élaborée, orientée vers des tâches simples utiles à l’espèce, et met en connexion les stimuli extérieurs, les émotions. Cependant, elle ne nous offre qu’une palette de réponses limitée et dénuée de subtilité. La partie la plus élaborée est constituée du cortex préfrontal. C’est celle-ci qui est apparue le plus tardivement au cours de notre évolution. Elle distingue, en fait, par les fonctions qu’elle recouvre, l’Homme de l’animal, ce qui explique que les scientifiques consacrent tant d’énergie à identifier les facteurs qui ont permis une telle évolution structurelle et plus encore, fonctionnelle. Grâce à elle, le langage, la fabrication et l’utilisation d’outils de plus en plus élaborés, des tâches aussi difficiles que l’envoi de « SMS » ou la création d’un nouveau langage dédié à l’outil précédent, la culture, l’humour et ce que les scientifiques qualifient de « plasticité comportementale », nous ont différenciés des autres espèces. Selon Ben Carlson, du Département d’Anthropologie de l’Université d’Atlanta, cette évolution est très liée aux contraintes nutritionnelles de l’environnement. De son point de vue, tout a été possible dès lors que les « oméga 3 », et plus particulièrement le « DHA », ont été davantage disponibles (2).
(*) : Pierre Weil s’est engagé activement dans la lutte contre le déficit généralisé en DHA. Plusieurs de ses travaux se sont avérés très instructifs. D’abord, il a montré qu’en apportant du lin à des poules on obtenait des œufs plus riches en DHA, information qui aurait bien plu à nos ancêtres, une poule étant moins dure à chasser qu’un buffle (18). Ensuite, il a montré que si on nourrissait des animaux avec une ration riche en lin, et qu’ensuite on donnait cette viande à des hommes, les membranes de leurs cellules sanguines renfermaient davantage de DHA (14). D’autres auteurs ont très récemment fait le même constat, cette fois après avoir enrichi l’alimentation de jeunes poulets avec de l’huile de colza (10). Il existe donc une alternative à la dégénérescence intellectuelle de la génération »malbouffe » !
BIBLIOGRAPHIE :
(1) : AILHAUD G (2007) : Cah.Nutr.Diét., 42 (2) : 67-72.
(2) :CARLSON BA,KINGSTON JD (2007) : Am.J.Human.Biol., 19 (1) : 132-41.
(3) : CARLSON BA,KINGSTON JD (2007) : Am.J.Human Biol., 19 (4) : 585-8
(4) : CORDAIN L (2002) JANA, 5 (3) : 15-24.
(5) :CRAWFORD MA, BLOOM M & Coll (1999) : Lipids, 34 (Suppl.) : S39-47.
(6) : CRAWFORD MA, BROADHURST CL (2012) :Nutr.Heath, 21 (1) : 17-39.
(7) : CUNNANE SC, PLOURDE M & Coll (2007) : Am.J.Human Biol., 19 (4) : 578-81.
(8) : EATON SB, NELSON DA (1991) : Am.J.Clin.Nutr., 54 (1 Suppl.) : 281S-287S.
(9) FROGUEL P, SEROG P, PAPILLON F (2001) : « La planète obèse », Nil Ed.
(10) GALLARDO MA, PEREZ DD & Coll (2012) : Biol.Res., 45 (2) : 149-61.
(11) : HAYASHI N, TITANI K (2010) : Proc.Jpn Acad.Ser.B.Phys.Biol.Sci., 86(5) : 494-508.
(12) LAGARDE M, GUICHARDANT M & Coll (1981) : Prog.Lipid.Res., 20 : 439-43.
(13) : LANGDON JH (2006) : Brit.J.Nutr., 96 (1): 7-17.
(14) : LEGRAND P, SCHMITT B & Coll (2010) : Lipids, 45(1) : 11-9.
(15) : MARTIN DD, BEAUCHAMP E & Coll (2011) :Biochimie, 93 (1) : 18-31.
(16) : RICHE D (2008) : “Micronutrition, santé et performance”, De Boeck Ed.
(17) : Seignalet J (2001) : « L’Alimentation ou le troisième médecin », FX de Guibert Ed.
(18) : SHAPIRA N,WEILL P & Coll (2008) :Isr.Med.Assoc.J., 10(4) : 262-5.
(19) : WEILL P (2007) : “Tous gros demain?”, Plon Ed.
Denis Riché, pour « Sport & Vie ».- 2012
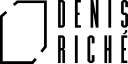
0 commentaires