TRIBUNE : TOUT ACTE ALIMENTAIRE CONSTITUE UN CHOIX POLITIQUE.
On attribue (à tort ou à raison), la citation suivante à Hippocrate : « que ton alimentation soit ta seule médecine ». Quand bien même l’interprétation qu’on en fait aujourd’hui nous éloignerait de sa pensée originelle, il n’en reste pas moins que cet aphorisme a guidé, comme un phare dans la nuit, des générations de nutritionnistes ou de médecins. Ce principe a également orienté les politiques de santé publique, jamais avares d’injonctions culpabilisantes telles que « ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé », ou « évitez de grignoter la journée ». La démarche est plus subtile qu’on le pense : En replaçant le choix du citoyen au centre de la problématique de la santé, il en résulte que la maladie incomberait plutôt aux comportements individuels qu’à des éléments extérieurs.
Allons un peu plus loin et posons-nous la question suivante : De quelle manière un aliment peut-il influer sur notre santé ? On peut désormais affirmer qu’il agit de trois façons distinctes :
– Il délivre des nutriments qui permettent le bon déroulement des processus qui se tiennent dans nos cellules. Ceci commence par l’apport d’énergie à notre corps et s’achève par le contrôle de l’expression de nos gènes, en passant par l’activité du cerveau ou l’influence sur l’humeur, la connaissance, et la prise de décision, qui dépendent du contenu de notre assiette. Notre santé, évidemment, est liée à des facteurs bien plus nombreux que la simple satisfaction des besoins en calories, glucides, protéines ou lipides. Plus que ces considérations classiques, la couverture de besoins cruciaux en vitamines, minéraux, en « oméga 3 » ou en éléments modulateurs de nos gènes, s’avère essentielle. Or, qui en a entendu parler par les experts ?
– Il nous fournit aussi, et de plus en plus depuis une quarantaine d’années, des « toxiques » de tous genres, perturbateurs endocriniens, dérivés de métaux lourds, molécules cancérigènes diverses et variées. Leur effet isolé à court ou à long terme, ainsi que l’influence de leurs apports cumulés, soulèvent beaucoup de questions, d’autant plus pressantes que l’évaluation biologique de leur impact, contrairement à ce qu’on connaît avec la recherche de déficits, est emplie d’incertitudes. Qu’est-ce qu’une valeur acceptable, comment identifier les impacts spécifiques de telle molécule sur notre santé, qui ne soit pas attribuable à telle autre, comment enfin établir la frontière entre des valeurs « normales » ou pathologiques ? Avouons-le, beaucoup de questions restent en suspens, et le resteront d’autant plus que l’évaluation toxicologique, pour l’essentiel, reste l’apanage des industriels eux-mêmes. Or, a-t-on déjà vu un cancre se mettre tout seul au coin ?
– Enfin, un aliment possède des propriétés « immunitaires », à savoir que tout se qui entre dans notre tube digestif, avant même de gagner le reste de notre organisme, se trouve confronté à notre écosystème intestinal. Le monde bactérien qui y réside et les acteurs immunitaires qui y sont nombreux, doivent garantir l’équilibre entre les deux pôles de notre immunité : nous protéger d’une part, tolérer d’une part. De ce point de vue notre « microbiote », comme on dit aujourd’hui, tient un rôle de chef d’orchestre dans cette organisation complexe, et encore imparfaitement connue.
Précisément, qu’observe-t-on depuis une quarantaine d’années ? Plusieurs évolutions défavorables sont survenues :
– Dans une logique de rendement, et en arguant de vouloir nourrir tout le monde, certains ont développé l’agriculture intensive, désorganisé les équilibres végétaux et économiques planétaires, au prix de déforestations dont on commence à payer le prix. L’une des conséquences reconnues en est l’appauvrissement de toute la chaîne alimentaire. Cela concerne aussi bien des oligo-éléments protecteurs tels que le sélénium, que des acteurs clef comme les « oméga 3 »., majoritairement déficitaires dans la population On sait que cette raréfaction contribue à des problèmes de poids plus nombreux et de survenue de plus en plus précoce (le pédiatre Gérard Ailhaud a ainsi pointé dès 2006 les conséquences de la baisse des « oméga 3 » dans la filière alimentaire). Portant sur des éléments qui optimisent notre immunité et protègent du cancer ou des « erreurs de lecture » des programmes de l’épigénèse, ces changements brutaux ont fait payer un tribut déjà lourd aux plus jeunes. L’espérance de vie des générations postérieures à 1980 commence d’ailleurs à décroître, en rupture avec le gain constant connu par les baby boomers.
– Par ailleurs, une autre agression est survenue, avec l’usage immodéré et parfois sans discernement des antibiotiques. En effet, ceci a eu pour conséquence l’appauvrissement transgénérationnel de notre microbiote. Les chercheurs de pointe considèrent que cet appauvrissement, qui n’est pas sans rappeler celui de la faune de nos forêts, contribue sans contestation possible, sans en être responsable exclusif, à un grand nombre de problèmes de santé publique actuels: obésité infantile, autisme, troubles « dys » des enfants, flambée des maladies auto-immunes, de cancer, troubles fonctionnels divers et variés, auxquels on donne toujours de nouveaux noms (fibromyalgie, endométtiose, etc…). Cela renvoie encore à l’accentuation des soucis de fertilité, que le monde médical continue désespérément d’aborder sous l’angle « hormonal ».
– Or, ces bouleversements majeurs ne se sont pas déroulés avec l’assentiment de tous. A-t-on entendu parler d’un référendum, par exemple, qui aurait demandé si on souhaitait l’abandon des bouteilles de verre pour adopter celles, plus pratiques, à base de plastique, dont le seul inconvénient serait de provoquer des cancers chez les enfants ? Nous a-t-on demandé de valider le changement d’alimentation du bétail, pour éventuellement rendre plus accessible et moins onéreux les produits qui en dérivent, mais au risque de favoriser l’obésité, les allergies, ou les divers troubles cognitifs de nos enfants ? Quant à ceux qui ont établi les constats alarmistes de ces fléaux de santé publique, ont-ils pris les décisions qui s’imposaient, tant dans le domaine de l’agriculture, que de l’approche de la santé ou de l’éducation, du transport, de l’obtention des denrées alimentaires, ou encore dans celui de la gestion des ressources en eau, en air, en sol, en poissons, en abeilles ?
– Oui tout ce qui a trait à l’alimentation constitue un acte politique, et la possibilité que les générations à venir retrouvent l’espoir de bénéficier d’une santé optimale, sur une planète préservée, ne peut passer que par un paradigme radicalement différent, non plus fondé sur le profit de quelques-uns au détriment de tous, mais sur le bien-être du plus grand nombre. La logique économique consumériste qui prévaut en 2021 s’est trouvée soutenue par une philosophie nous interdisant de nous questionner sur les conséquences environnementales de chacun de nos actes contribuant ainsi à un statut quo où chacun a eu sa part de responsabilité. Comme dit un proverbe indien: « Quand l’homme Blanc aura mangé le dernier poisson, sali la dernière rivière et respirera un air souillé, il comprendra alors que l’argent n’est rien ». Faisons mentir ce présage.
Denis Riché.
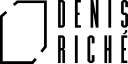
0 commentaires