Dans l’arsenal des outils dont dispose le sportif moderne, la biologie n’est pas le moins performant. Mais c’est aussi celui qui se prête le plus à des spéculations, à des extrapolations hasardeuses ou à des contresens monumentaux. Depuis une dizaine d’années, je m’appuie sur des outils biologiques qui permettent de toucher du doigt la « charge interne » subie par l’organisme de l’athlète. Explications…
DE LA DETECTION DE LA MALADIE A LA SUSPICION DU DYSFONCTIONNEMENT :
L’intérêt pour les marqueurs biologiques résulte d’un long cheminement, parfois tortueux, qui répond à un seul objectif très clair : comment assurer un statut nutritionnel optimal aux sujets que nous recevons en consultation de micronutrition, qu’il s’agisse de sportifs soucieux de réaliser leur plein potentiel à travers leurs performances, d’autres en quête d’une solution pour résoudre leurs problèmes récurrents, ou d’un quadra dynamique préoccupé par les antécédents familiaux de cancer ? A chaque fois, le raisonnement est le même : Si chaque cellule de chaque tissu de notre organisme dispose de l’ensemble des nutriments nécessaires à son fonctionnement, alors la probabilité que s’instaurent des perturbations, mineures ou non, reste faible. Cette volonté d’optimisation, qui a longtemps occupé la sphère de la nutrition, a débouché sur le concept d’apports nutritionnels conseillés ou de recommandations aux populations. De fait, il s’agit de la nutrition de la prévention des maladies. Les apports conseillés sont supposés mettre à l’abri des grands fléaux la majorité des représentants de la population concernée. La maladie grave ou la santé, cette façon de voir ne connaît aucune alternative médiane. L’idée qui a gouverné ce mode de pensée était la suivante : Si d’une part on connaît les quantités de chaque nutriment à apporter et que, d’autre part, on sait évaluer de manière précise le contenu des rations, alors on pourrait garantir le maintien d’un bon état de santé par l’entremise d’une ration idéale, exempte de déficit. Ainsi, une large frange des diététiciennes et des nutritionnistes continuent de croire que « une alimentation suffisamment équilibrée et diversifiée couvre les besoins de la majorité de la population ». Pour eux, les critères de l’alimentation équilibrée et diversifiée, pour tous, sont clairement établis et dénues d’ambiguïté.
En fait, il y a loin de la coupe aux lèvres, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, celles inhérentes aux modalités de recueil des informations. Le fait d’être sondé change-t-il notre manière de manger ? Un sondage à un instant « t » reflète-t-il de manière fiable la manière de manger sur la période « p » qui l’a précédé ? On considère généralement que c’est le cas. C’est pourtant souvent faux, tant cette manière de procéder recèle de nombreuses approximations, que reconnaissent d’ailleurs les experts, puisqu’ils invalident régulièrement pour cette raison des travaux pas suffisamment rigoureux sur le plan méthodologique. Ensuite, celles liées à la base de données renseignant sur la composition des aliments. Celle sur laquelle on s’appuie pour définir la richesse des denrées est souvent constituée de chiffres moyens, non évolutifs. Par rapport aux valeurs qui y figurent, il peut exister, sur un échantillon z d’aliments, des écarts de 5 à 10%. Pas grand-chose direz-vous. Mais c’est là qu’il faut envisager la troisième réserve qu’on peut apporter vis-à-vis du dogme de l’alimentation équilibrée qui conviendrait à tous. Imaginons un sujet qui, mangeant de manière « quasiment » parfaite, couvre en fait quotidiennement 95% de ses besoins en un nutriment donné. De fait, la lecture de ses habitudes alimentaires ne nous renseigne pas sur cette situation, car l’écart à l’idéal correspond à la marge d’erreur accordée à ce type de recueil. Autrement dit, « quasi idéal » et « idéal » se ressemblent. Il s’agit pourtant de deux situations aux conséquences radicalement opposées. Imaginez en effet maintenant que cette situation d’apport situé à 95% des besoins se prolonge sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout se passe alors comme si, tous les jours, cet homme dépensait 5 Euros de trop par rapport à son budget. A un moment donné, quelques années plus tard, il se retrouvera en situation d’interdit bancaire. Le jour où cette mauvaise nouvelle tombera, cette personne se dira certainement : « je ne comprends pas, j’ai tout le temps fait attention, il doit y avoir une erreur ! ».On comprend sa surprise! Pourtant, à ce stade d’un déficit lentement constitué, cumulé au fil du temps, il peut exister un réel écart entre ce dont ont besoin les tissus pour réaliser leurs missions et ce dont ils disposent. Un tel exemple se rencontre souvent. C’est ce qui se voit par exemple avec le fer. Telle coureuse à pied, informée des risques de déficit liés à la nature de sa discipline et à son statut de femme réglée, veille à manger de la viande ou des produits d’origine animale à chaque repas. Elle se sent donc théoriquement à l’abri d’un manque. Aussi, quelle n’est pas sa surprise lorsque, comme cela arrive souvent au quotidien, on lui découvre une ferritinémie très basse, témoignant d’un effondrement de ses réserves martiales. Que se passe-t-il ? On se situe en fait au chapitre 17 ou 18 de son histoire, et les perturbations rencontrées à ce moment-là résultent de cet écart minime, impossible à déceler initialement, et qui s’inscrivant dans la chronicité conduit au final à un réel problème biologique.
La dernière réserve porte sur l’incertitude-même qui entoure la notion de « besoin ». La grande hétérogénéité des populations humaines se manifeste sur de nombreux caractères. Exprimer, par exemple, que le Français moyen chausse du 41 ou possède 6/10 à l’œil gauche et 7/10 à l’œil droit ne signifie en rien que tous les hommes résidant sur notre territoire doivent acheter les mêmes modèles de souliers ou de montures. Pour cette raison, cette hétérogénéité propre à l’humain ne permet pas de garantir que la couverture des besoins théoriques « statistiques » satisfasse effectivement l’intégralité des besoins de chaque individu de la population. Le problème, précisément, se posera chez ceux qui, chaussant du 47, ne trouvent que des modèles 42. Les individus dont l’organisme nécessiterait par exemple, que leur ration leur délivre 700 mg de magnésium par jour (alors que l’homme « moyen » en requiert seulement 400), exprimeraient donc des signes de perturbation fonctionnelle alors que, soumis à une enquête alimentaire rigoureuse, on affirmerait qu’ils « couvrent leurs besoins ».






DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE A LA POLICE SCIENTIFIQUE :
Si vous avez bien suivi ce raisonnement, on comprend donc que l’analyse minutieuse du contenu de l’assiette ne permet pas de déduire quoi que ce soit concernant la santé de l’individu concerné. Constat plutôt dérangeant pour les nutritionnistes, contraints, à cause de cela, de changer de paradigme et de raisonner davantage en termes de « probabilité d’apports insuffisants » qu’en termes de diagnostic nutritionnel. Précisément, cette peu glorieuse incertitude fait tâche dans le paysage actuel où, notamment dans le milieu du sport, on souhaite une réponse individualisée.
Une dernière réflexion doit être introduite pour relativiser la portée d’une décision fondée sur la seule analyse des apports alimentaires. Classiquement, le regard nutritionnel porté sur l’assiette juge l’orthodoxie des choix. Untel est en « flagrant délit de délinquance alimentaire » parce que ses apports en magnésium, en zinc ou en sel, par exemple, ne correspondent pas aux recommandations consensuelles des experts. Certes, mais pour quelles conséquences ? Que devrait redouter, concrètement, l’individu qui pêcherait par niveau d’apport qui, pour certains micronutriments, serait inférieur aux recommandations? Allez expliquer à un jeune en bonne santé (ou s’affirmant comme tel) en quoi ce n’est pas bon de n’apporter que 350 mg de magnésium, ou pourquoi il devrait veiller à ce que les lipides délivrent 30% plutôt que 33% de l’apport calorique journalier. En fait, probabilité statistique de déficit et conséquence objective d’un manque nutritionnel dans la cellule ne sont pas équivalents. Quand on s’intéresse aux fonctions et, selon le modèle de la « physiologie du grain de sable » aux dysfonctionnements, ce qui présente un intérêt c’est d’établir un lien entre les choix alimentaires du sportif et les répercussions éventuelles qu’ils vont avoir sur les fonctions physiologiques (*). Ces répercussions, se traduisant en perturbations progressives des cellules, des tissus et des fonctions, vont influer défavorablement sur l’état de santé des sujets mais aussi, vu sous l’angle sportif, sur les performances. De fait, ce sont les mêmes manques qui nous intéressent, selon qu’on s’adresse aux sportifs, aux sujets âgés ou aux couples confrontés à ce qu’on nomme pudiquement l’infertilité. Ce sont les mêmes défaillances et les mêmes manques en nutriments qui contribuent à ces états.
Forts de ce constat, nous avons décidé au début des années 90, avec le docteur Didier CHOS, d’aborder la question sous un autre angle. Le raisonnement tenu fut le suivant : Si un individu tire de son assiette l’intégralité de ce dont il a besoin, qu’il arrive par conséquent, compte tenu de son capital génétique unique, à faire fonctionner de manière optimal chacune de ses cellules, alors la probabilité qu’existe un déficit est faible. Les troubles fonctionnels seront peu nombreux. Plus il s’éloignera de cet état idéal, en raison d’apports insuffisants, plus il exprimera de troubles fonctionnels, et plus ils seront manifestes. Cela concernera notamment l’immunité, les fonctions cérébrales, le sommeil, la douleur, l’inflammation, la protection cellulaire, les processus hormonaux…On devine que les répercussions seront à la fois nombreuses et spécifiques à chacun de nous. L’expertise micronutritionnelle consistera alors, à l’instar d’un fin limier enquêtant sur un meurtre, à comprendre le sens des indices observés, à en déduire les liens existant entre elles et le contenu de l’assiette, et enfin à en déduire les changements alimentaires à proposer. Mener cette enquête policière ne suffira pas toujours. Certaines hypothèses demanderont à être affinées : « Je suspecte un élément immunitaire dans cet état de fatigue chronique. Les questionnaires ne me renseignent pas suffisamment. Où trouver les réponses à mes questions ou même seulement des bribes de réponse ? » C’est là que les marqueurs biologiques entrent en jeu. On peut les comparer à la police scientifique. Là où la brigade criminelle aura réussi à retrouver des empreintes, les experts fourniront le nom du coupable.
Ainsi présentée, la biologie ne se substitue pas à la consultation médicale, au recueil de symptômes et à leur interprétation. Ainsi, elle ne se montrera d’aucun secours à celui qui, faute d’avoir initié une piste, attendra que la vérité sorte du sang et prescrira un bilan plutôt lourd : « Je ne sais pas ce que vous avez, on va faire un bilan sanguin ! » Cette phrase assoit souvent le constat d’une défaillance dans la prise en charge. Dans cette logique déprimante de l’alternative à la réflexion médicale, on voit poindre une certaine manière tout aussi désastreuse d’envisager la correction des anomalies biologiques. C’est ce que je surnomme la « complémentation du cantonnier ». Elle consiste à repérer tous les « trous » figurant dans les données biologiques, et à les combler un par un pour restaurer une normalité, certes arithmétique, mais certainement pas un état stable physiologique. Or, sans traiter les causes, on s’expose à reproduire les mêmes effets. Illustrons ceci avec un exemple classique, déjà évoqué ci-dessus : celui du déficit en fer. Imaginons qu’au cours d’un bilan biologique réalisé auprès d’une coureuse se plaignant de fatigue, on découvre une chute de la ferritine, témoignant d’une baisse des réserves en fer. Souvent il sera proposé, dans une démarche classique, de tenter de restaurer les réserves, en préconisant une supplémentation martiale. En micronutrition, la réflexion ira plus loin. Pourquoi ce déficit ? Est-ce un problème d’apport insuffisant, de pertes excessives ? Dans ce dernier cas, il faudrait alors s’interroger sur la charge de travail ou sur le possible intérêt du recours à des activités alternatives (vélo, natation) grâce auxquelles on réduirait les impacts. Est-ce sinon un problème d’ordre digestif, entravant une assimilation correcte du fer, fût-il d’origine animale ou végétale ? Ou encore faudrait-il suspecter un déficit en cuivre (ce qui affecterait l’assimilation du fer), une particularité concernant le métabolisme de l’hepcidine (l’hormone chargée de régler le débit d’entrée dans le fer au niveau de l’intestin), voire des problèmes hormonaux provoquant des saignements exagérés au moment des règles ? On le voit, beaucoup de pistes sont à explorer, et la réponse individualisée peut porter sur plusieurs points à la fois. Encore faut-il définir à l’avance ce qu’on veut explorer, et pourquoi on le fait.
LA BIOLOGIE DE L’ADAPTATION, OU TOUCHER DU DOIGT LA « CHARGE INTERNE » :
Il n’est pas simple, chez un sujet modérément actif, dans le contexte de l’alimentation actuelle, de garantir une nutrition optimale, c’est-à-dire suffisamment proches de ses besoins intimes, pour faire en sorte qu’aucun « maillon faible » ne se manifeste. Cà l’est encore moins chez le sportif. Pourquoi ? En raison de l’existence de processus propres à l’activité physique, et qu’on nomme les « adaptations ». Il s’agit de l’ensemble des modifications qui surviennent au cœur de nos tissus, en réponse aux effets de l’entraînement. Ces transformations surviennent de manière chronique, à long terme, et ne sont pas sans impact sur le fonctionnement intime de la cellule. Plus l’engagement physique est important, et plus les limites d’adaptations seront proches d’être atteintes. Le souci, avec les sportifs, c’est que les conséquences du plafonnement et des compensations qui peuvent s’ensuivre, se manifestent plus rapidement, et de manière plus importante, que chez le commun des mortels. Cela explique pourquoi il s’agit, à mes yeux, d’un véritable modèle expérimental où se joue, en accéléré, l’histoire de la dysfonction et de la maladie.
Revenons au sportif. Chez lui, la plupart des molécules exerçant des rôles fonctionnels, comme les minéraux, les vitamines, les anti-oxydants, les acides gras polyinsaturés ou les acides aminés essentiels, font l’objet, dans ce contexte, d’un turn-over accéléré. D’où un risque potentiel, celui que les apports journaliers et les réserves disponibles ne suffisent plus, à un instant «t », à garantir le maintien de fonctions cruciales qui seront par exemple la neutralisation des radicaux libres, le contrôle de l’inflammation, l’optimisation du métabolisme, le renouvellement des neurotransmetteurs ou encore la pleine efficience de nos défenses immunitaires. L’idée derrière ce concept de « biologie préventive » consiste à repérer les premières modifications de certains paramètres biologiques pertinents, signifiant que l’organisme est en état instable et cherche à s’adapter coûte que coûte. On se place alors dans une perspective dynamique qui se situe au-delà de la seule concordance d’un marqueur avec les normes qui lui correspondent. Cela amène aussi à envisager simultanément plusieurs indicateurs, dans une perspective plus dynamique. Prenons un autre exemple pour illustrer cette idée. Considérons que, chez un coureur à pied, on trouve un taux de ferritine situé dans la norme basse. Une lecture « statique » de ce résultat conduirait à ne rien faire, au prétexte que son statut est (encore) normal. Imaginons maintenant qu’on lui adjoigne un autre marqueur, l’haptoglobine. Ce paramètre renseigne sur l’importance du phénomène d’hémolyse, c’est-à-dire de celui de destruction des globules rouges. Plus sa valeur est basse, plus on a perdu un grand nombre d’hématies. Si en début de saison ce coureur possède à la fois une haptoglobine basse et une ferritine « normale basse », cela signifie qu’il va devoir beaucoup piocher dans ses réserves de fer (mais aussi de vitamines B9 et B12 entre autres), pour réussir à maintenir son taux de globules rouges. On peut sans risque prédire, en tout cas, que dans un délai très court ses réserves martiales vont tomber dans l’anormalité. On aura donc tout intérêt à anticiper.
Imaginons maintenant qu’il ne s’agisse plus d’un coureur mais d’un cycliste, c’est-à-dire d’un sportif n’étant pas soumis à l’action défavorable de l’onde de choc générée, à chaque foulée, lors de la réception du pied sur le sol. Comment comprendre alors cette situation qu’on rencontre, dans près de 30% des cas, chez des cyclistes professionnels au moment non pas où ils achèvent leur saison, mais reprennent l’entraînement pour préparer la suivante ? Trois champs de réflexion sont à défricher. Le premier concerne bien sûr la cohérence de la charge de travail. Clairement, dans de telles situations, les coureurs n’ont pas pu remettre le compteur à zéro entre les deux saisons successives, et ce malgré une assez longue coupure. On peut penser que les limites d’adaptation ont été atteintes, et cela amène en outre à poser une question pernicieuse : Si l’entraînement destiné à améliorer les qualités aérobies nécessite d’effectuer un gros travail en endurance et que, au final, le coureur possède moins de globules rouges et dispose d’une quantité moindre de fer pour faire fonctionner les enzymes mitochondriales, on peut s’interroger sur la justesse de la programmation et le sens de ce qu’il fait (**).
On peut pousser le raisonnement plus loin. Qu’est-ce qui peut contribuer à une fragilisation des membranes des globules rouges ? Fatalement on va s’attarder sur deux notions, directement liées aux apports nutritionnels. La première concerne la souplesse des membranes, fortement conditionnée par la richesse en acides gras « oméga 3 qui, par ailleurs contribuent à contrôler l’inflammation. Quelles huiles, quels poissons, quelle assimilation, seront autant de questions à soulever. La seconde porte sur les facteurs d’agression, notamment les radicaux libres, et sur les éléments protecteurs, nommés les anti-oxydants. Le résultat de ce combat sans merci que se livrent ces deux armées dépendra du niveau d’entraînement, de facteurs environnementaux (exposition aux ultra-violets., à la chaleur, altitude, pollution, inflammation, infection), des apports en éléments protecteurs (fruits, légumes, huiles) et du capital génétique. Au final, bien malin qui peut prédire a priori le vainqueur entre les radicaux libres et les anti-oxydants, et très aventureux celui qui considère qu’il suffirait de manger cinq fruits et légumes par jour pour être « obligé » d’être en bonne santé. Ajoutons que, en raison d’un environnement changeant, le vainqueur d’aujourd’hui ne sera pas forcément celui de demain. Car l’environnement, la disponibilité en nutriments, le niveau d’agression changent constamment : sitôt une bataille gagnée, une autre commence, qui elle peut être perdue ! On comprend donc tout l’intérêt qu’il y a, dans cette démarche, à disposer de marqueurs fiables, donnant une idée du vainqueur de cette Guerre de Cent Ans oxydative, émaillée de batailles où chacun s’impose tour à tour. L’un de ceux qui nous intéressent le plus, dans ce contexte, se nomme le taux des « anticorps anti LDL oxydées ». Que peut signifier une élévation de ce paramètre ? Si l’attaque radicalaire est ponctuelle ou peu supérieure au « bruit de fond », les dérivés anormaux formés par l’attaque de certains transporteurs du cholestérol dans le sang sont éliminés et il n’en persiste, de manière chronique, aucune trace dans l’organisme. Par contre, si le cumul d’agression radicalaire aboutit à la présence permanente de molécules porteuses d’anomalies, ces LDL oxydées finissent par être reconnues par le système immunitaire comme « anormales ». Il va alors diriger des anticorps contre elles. La quantité de gendarmes formés à ce combat renseigne assez bien sur l’effet chronique du cumul d’épisodes radicalaires. Le taux d’anticorps dirigés contre ces LDL oxydées constitue donc le reflet de l’état de dépassement de la protection cellulaire.
La plupart de nos observations et des publications sur cette question ont en commun de montrer une grande hétérogénéité des valeurs d’anticorps anti-LDLox au sein de ces populations de sportifs. Ces valeurs sont peu prévisibles sur la base des habitudes alimentaires. En clair, certains avalent leurs cinq fruits et légumes syndicaux par jour et montrent un état oxydatif chronique. D’autres en avalent moins et gèrent mieux ces agressions. Il s’agit donc typiquement d’une situation pour laquelle le recours à la « police scientifique » va s’avérer utile. Et pour cause : Cette perturbation est associée à un risque cardio-vasculaire accru. Autrement dit, chez certains, la pratique régulière du sport pourrait augmenter le risque cardio-vasculaire en raison d’une augmentation du taux de LDL oxydés. Et les sujets « positifs » ne sont pas prévisibles a priori sur la base d’un quelconque autre critère…
Au final, il a été possible d’identifier différents marqueurs représentatifs de pistes possibles de désadaptation. On peut les comparer à des portes qu’on entrouvre pour entrer dans une pièce afin d’y rechercher des indices. Selon qu’elles se révèlent intéressantes ou non, on pourra éventuellement approfondir certaines recherches. Par exemple, si on découvre une très forte inflammation, on va tenter d’en comprendre l’origine. Ces différentes pistes, regroupées dans un bilan qu’on a baptisé le « profil des maillons faibles », vont permettre d’optimiser les apports alimentaires, le protocole de complémentation, l’environnement, la charge de travail, les orientations de la préparation, dans le but d’optimiser la réponse du sportif. Ce caractère éminemment individualisé du conseil et les ajustements qui en découlent vont permettre de résoudre enfin le casse-tête des entraîneurs : Comment faire coïncider la charge externe (c’est-à-dire l’impact attendu de la préparation) et la charge interne (qu’on peut assimiler aux déflagrations subies), et bien sûr trouver la meilleure stratégie pour optimiser la réponse et la progression ? Il me paraît déjà évident, alors qu’on en est qu’au tout début de cette démarche, que cette réflexion va amener à dépoussiérer, déboulonner et revisiter certains dogmes de l’entraînement. Car on a déjà tiré une conclusion extrêmement dérangeante pour les entraîneurs, voire provocatrice : Créer les conditions optimales de réponse à l’entraînement compte finalement plus que le contenu de l’entraînement lui-même. Garantir un statut biologique optimal prévaut sur les orientations à venir de la programmation. Lorsque, après correction d’un déficit en coenzyme Q10, un athlète aguerri progresse de 1,5 km/h à un test de détermination de la vitesse Maximale Aérobie, il s’améliore plus que par l’intermédiaire de n’importe quelle forme d’entraînement connue ! Cà paraît pourtant évident : dans la même discipline, quasiment tous les représentants de l’élite pratiquent le même entraînement. Pourtant, ce sont toujours les mêmes qui gagnent… Le dernier du Tour de France possède une valeur de VO2 Max qui n’est pas « significativement différente » de celle du vainqueur. Malgré cela, il finit à trois heures ! La vérité est donc ailleurs, au cœur de la cellule et des tissus….




DES PERSPECTIVES NOVATRICES :
D’ores et déjà, les résultats relevés auprès des clubs de football de Ligue 1 ou les cyclistes professionnels, ont montré des faits troublants :
- Une forte proportion de déficits en coenzyme Q10 (70% des 204 sportifs ayant déjà été évalués). Cette molécule a deux grandes fonctions dans la cellule musculaire. Un comme anti-oxydant et un autre comme cofacteur de l’utilisation de l’oxygène. En cas de déficit, le sportif plafonne et « toxine » très vite du fait qu’il se trouve en acidose. Typiquement, lors de l’atteinte du niveau maximal d’effort, il ne se trouve pas en détresse respiratoire mais en incapacité musculaire à maintenir l’effort demandé. Il sature très vite, et se trouve limité au niveau du temps de soutien au seuil et au-delà.
Le coenzyme Q 10 provient pour partie des apports alimentaires, et tout déséquilibre entre les entrées de glucides (féculents, boisson d’effort, fruits, etc…) et la sortie (dépenses) crée une situation qui favorise ce déficit. Par ailleurs, certains aliments comme les sardines, les maquereaux, certaines viandes en délivrent, et leur ingestion insuffisante peut contribuer à ce déficit.
Une inflammation très présente au moment de la reprise de l’entraînement, chez plus de 60% des sportifs. Notons que le pourcentage tombe à 25% chez les sportifs ayant bénéficié d’un suivi lors de la saison écoulée. Cette amélioration témoigne en faveur d’un suivi de qualité, mais la persistance de cet état défavorable chez un sportif sur 4, en dépit d’un accompagnement individualisé, suggère que les charges de travail et les contraintes compétitives ne permettent pas une récupération satisfaisante.
- Une hémolyse excessive, concernant près d’un sportif sur 3 ou 4, le taux le plus élevé étant relevé chez les cyclistes. Ce processus, étonnant compte tenu des caractéristiques de leur discipline, met en lumière l’impossibilité rencontrée par de nombreux adeptes de la Petite Reine à se régénérer complètement entre deux saisons.
- Un stress oxydatif élevé chez 30% des sportifs, à l’issue de la trêve compétitive, ce qui laisse à penser qu’ils se trouvent en vulnérabilité et à risque de blessure ou d’infection.
- De très nombreux déficits (plus de 80 % de scores trop bas), en vitamine B9 et en sélénium, chez les footballeurs pros dont le bilan a été réalisé. Cette insuffisance chronique et généralisé de ces molécules semble témoigner d’un manque de diversité alimentaire, d’un appauvrissement marqué des denrées et, en ce qui concerne cette vitamine, sans doute aussi d’une dégradation accrue sous l’effet de l’exercice. Compte tenu de leurs interventions dans le contrôle de l’expression des gènes, dans l’immunité, et dans la synthèse des globules rouges (pour la vitamine B9), on mesure l’impact à terme de cette « bombe à retardement » biologique.
- Beaucoup de ces données s’avèrent étonnantes et méritent d’être confirmées ; mais ces éléments confirment plusieurs choses : nos aliments son appauvris, les rations manquent souvent de diversité, les contraintes de l’entraînement crée des états de désadaptation et, au final, le statut biologique et le statut nutritionnel en pâtissent très fréquemment. De fait, aujourd’hui, je suis convaincu que les conditions idéales de réponse de l’organisme ne sont qu’exceptionnellement, et tout à fait involontairement assurées. Il me paraît également évident que : « une alimentation diversifiée et équilibrée », telle que la prônent les experts, ne constitue une condition ni nécessaire ni suffisante à l’obtention ou à la restauration d’un état de santé optimal. L’enjeu des années à venir consistera à permettre l’accès à cet état au plus grand nombre, qu’il s’agisse ou non de sportifs. Cette approche biologique devrait nous y aider.
(*) : Pour compliquer encore cette question, notons que selon le déroulement de la grossesse, sa place dans la fratrie, la proximité éventuelles des grossesses précédentes, un enfant peut hériter, à la naissance, d’importants déficits. Par exemple en iode ou en acides gras « oméga 3 ». Pour peu qu’ensuite les choix opérés par ses parents, la diversité des menus l’amènent à avaler tous les jours l’intégralité ce dont il a besoin, il deviendra impossible de soupçonner l’existence d’un déficit. Un exemple nous est fourni par ces enfants qui ont toujours été en surpoids sans manger mal ni trop, et dont on découvre, à l’âge adulte, qu’ils présentent un important déficit en iode. Comment comprendre cette situation ? Ils ont parfaitement géré leur compte. Mais dès son ouverture on leur avait laissé un important découvert, qu’ils n’ont jamais pu combler. Dans un tel cas de figure, bien sûr, le contenu de l’assiette ne permet pas de connaître le statut nutritionnel. « Manger équilibré » ne réglera rien !
(**) : On observe également fréquemment la baisse d’une molécule, le coenzyme Q10, qui garantit à la cellule une bonne utilisation de l’oxygène. Ainsi, ce déficit affecte les potentialités aérobies du coureur. Or, pour posséder un taux correct, ce dernier doit passer par des phases d’anabolisme glucidique, ce qui signifie qu’à certains moments il doit disposer d’un taux élevé de glucides dans la cellule, de façon à réaliser la synthèse du Co Q10. Sans cela, il sera impossible d’assurer cette synthèse. On a constaté qu’un apport énergétique insuffisant et des charges de travail trop lourdes, avec trop peu de phases d’assimilation, empêchent l’obtention de ces phases d’anabolisme glucidique. Ces habitudes conduisent alors à un effondrement de ce paramètre. A l’inverse, sa correction permet de restaurer la puissance aérobie. Toujours est-il que quand on cumule déficit en fer, hémolyse excessive et déficit en Co Q10, il est illusoire d’espérer tirer un quelconque bénéfice de son entraînement, quel qu’il fût !

Le petit plus de Denis :
Article écrit vers 2006, au moment de l’initiation de la collaboration avec Chelsea et durant les 4 années de rédaction (2004-2008) de : « Micronutrition, Santé et Performance ».
Les bases conceptuelles d’une approche similaire dix ans plus tard, mais dont certains marqueurs, réactualisés, ont changé.
Le suivi biologique dynamique évolue en permanence, et on pourrait facilement ajouter deux ou trois paragraphes à cet article initial.
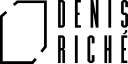
0 commentaires